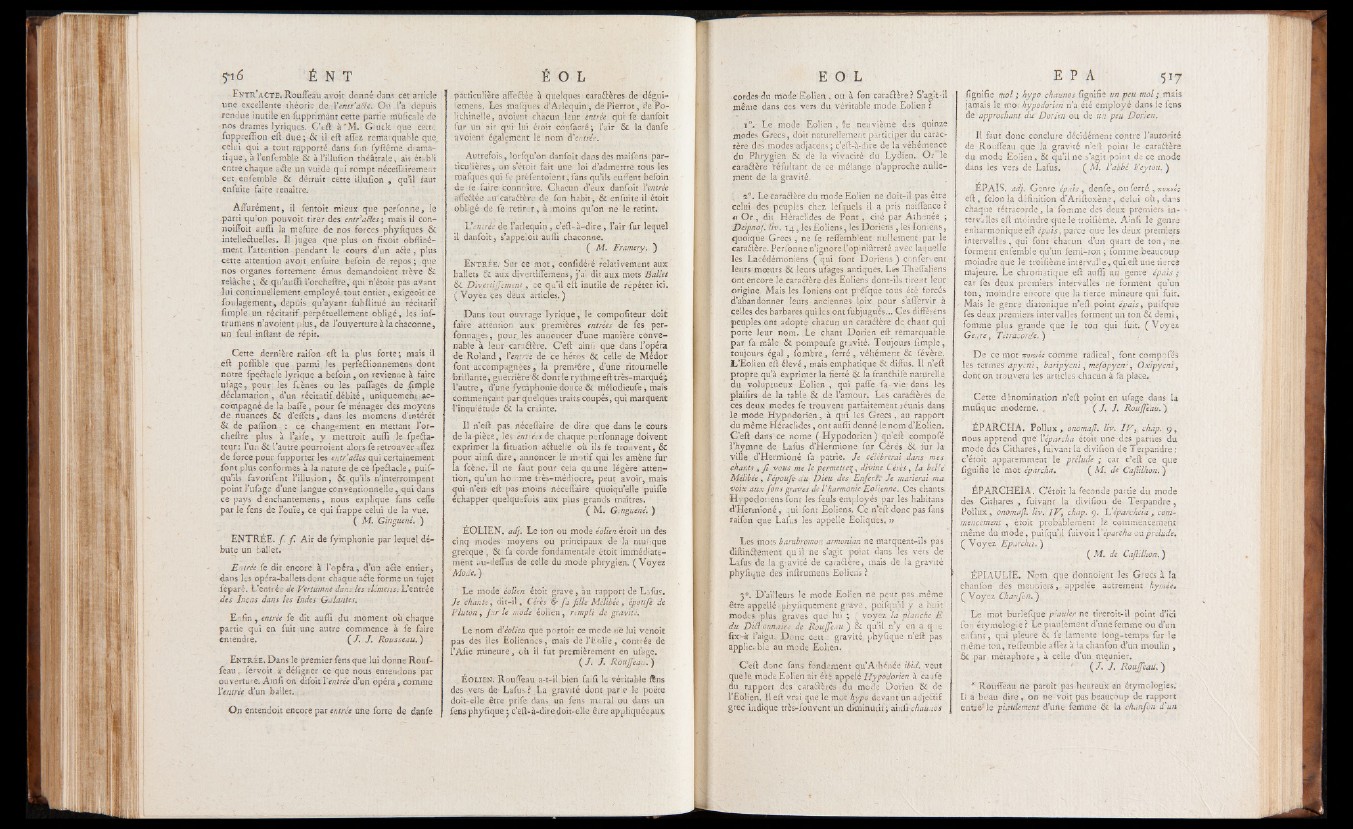
5“16 É N T
Entr’acte. Rouffeâii avoit donné dans cet article
une excellente théorie d e . Ventracle. On l’a depuis
rendue inutile en fupprimànt cette partie mùficale de
nos drames lyriques. C ’eft à 'M . G u itk que cette
fuppreflion eft d u e ; & il eft allez remarquable que.
celui qui a tout rapporté dans Ion fyftême dramatique
5 à l’enfemble & à l’illulion théâtrale ■, ait établi
entre chaque a&e un vuide qui rompt néceffairement
cet enfemble & détruit cette illufion , qu’il faut
enfuite faire renaître.
Affurément, il fentôit mieux que perfonne, le
parti qmonpouvoir tirer des entr axes ; mais il con-
noiffoit aulîi la mefure de nos forces phyfiques &
intelleéluelles. Il jugea que plus on fixoit obftiné-
men t.l’attention pendant le cours d’un a éle, plus
cette attention avoit enfuite befoin de repos ; que
nos organes fortement émus demandoient trêve &
relâche qu’auffî l’orcheftre, qui n’étoit pas avant
lui continuellement employé tout entier , exigeoit ce
foulagement-, depuis qu’ayant fubflitué au récitatif
fimple un récitatif perpétuellement o blig é, les inf-
trumens n’avoient plus, de l’ouverture à la chaconne,
un feul inftant de répit.
Cette dernière raifon eft la plus forte; mais il
eft poflible que parmi les perfeélionnemens dont
notre fpeélaçie lyrique a befoin, on revienne à faire
u fage , pouç les fcènes ou les paffages de ftmple
déclamation , d’un récitatif.débité, uniquement, accompagné
de la baffe, pour fe ménager des moyens
de nuances & d’effets, dans les momens d’intérêt
& de paflion : ce changement en mettant l’or-
cheftre plus à l’aife,, y mettroit aufli le- fpeâa -
teur : l’un & l’autre pourroient alors fe retrouver affez
de force pour, fupporter les entraides qui certainement
font plüs conformes à la nature de ce fpeélacle, p.uif-
qu’ils favorifent l’illusion, & qu’ils n’interrompent
point l’ufage d’une langue conventionnelle, qui dans
ce-pays d enchantemens, nous explique fans ceffe
par le fens de l’ou ïe , ce qui frappe celui de la vue.
( M. Ginguené. )
EN TR É E , fi f . A ir de fymphonie par lequel débute
un ballet.
Entrée fe dit encore à l’op é ra , d’un aéle entier;
dans les opéra-ballets dont chaque aéle forme un fujet
féparé. L’entrée deVertiimnè dans.les eUme ns .-L’entrée
des Incas dans les Indes Galantes.
E n fin , entrée fe dit aufli du moment où chaque
partie qui en fuit une autre commence à fe faire
entendre. ( / . / . Rousseau. )
E n t r é e . Dans le premier fens que lui donne R ouf-
feau r férvoit à' défigner ce que nous entendons par
ouverture. Arafi on difoitXentrée d’un opéra , comme
Xentrée d’un ballet... .
On entendoit encore par entrée une forte de danfe
É O L
particulière àffeélée à quelques caraélères de dégui-
femens. Les mafques d’Arlequin; dé Pierrot, de P(o-
HchineHe, a voient chacun leur entrée qui fe danfoit
fur un air qui lui éroit confàcré ; l’air & la danfe
avoient également le nom cl 'entrée.
Autrefois., lorfqu on danfoit dans des maifons particulières,
on s’étoit fait une loi d’admettre tous les
mafques qui fe préfentoient, fans qu’ils euffent befoin
de ïè faire conncître. Chacun d'eux danfoit Ventrée
àffeélée aif caraéière de fon habit , & enfuite il étoit
obligé de fe retirer, à moins qu’on ne le retînt;
U entrée de l’arlequin, c’eft-à-dire, l’air fur lequel
il danfoit, s’appeloit aufli chaconne.
( M . Fram e ry . )
Entrée.- Sur ce mot, confédéré relativement aux
ballets & aux divertiffemens, j’ai dit, aux mots F a l l e t
& D iv e r t ijJ 'em e n t , ce qu’il eft inutile de répéter ici.
( Voyez ces deux articles. )
Dans.tout ouvrage lyrique , le compofiteur doit
faire atténtion aux premières entrées de fes per-
fonnages, pour, les annoncer d’une manière convenable
à leur éaraélërë. C’eft ainh que dans l’opéra
de Roland, Ventrée de ce héros & celle de Médor
font accompagnées, la première, d’une ritournelle
brillante, guerrière & dont le rythme eft très-marqué;
l’autre, d’une fymphonie douce & mélodieufe, mais
commençant par quelques traits coupés, qui marquent
l’inquiétude & la crainte.
Il n’eft pas néceflaire de dire que dans le cours
de laq>ièce, les entrées de chaque perfonnage doivent
exprimer la fituation aéluelle ou ils fe trouvent, &
pour ainfi dire, annoncer le motif qui les amène fur
la fcène. Il ne faut pour cela quune légère attention,
qu’un ho urne très-rmédiocre, peut avoir, mais
qui n’eii eft pas moins néceflaire quoiqu’elle puifle
échapper quelquefois aux plus grands maîtres.
( M. G in g u en é . )
ÉOLIEN, a d j. Le ton ou mode éo lien étoit un des
cinq modes moyens ou principaux de la mufique
grecque , &. fa corde fondamentale étoit immédiatement
«iu-deffus de celle du mode phrygien. (Voyez
M o d e .') .
Le mode éo lien étoit grave, au rapport de Lafus.
J e c h a n t e , dit-il, Cérès & f a f i l l e M é lib é e , ép o u je de
P lu t o n , fur'le mode éolien, r tm p li d e gravité.
Le nom d’éo lien que portoit ce mode ne lui venoit
pas des îles Eoliennes , mais de l’Eolie, contrée de
l’Afle mineure, où il fut premièrement en ufage.
( J . J . R o ü jf e a u . )
Éolien. Rouffeau a-t-il bien fai fi le véritable fins
des vers de Lafus ? La gravité dont parie le poëte
doit-elle être prife dam un fens moral ou dans un
fens phyfique 3 c’eft-à-dire doit-elle être appliquée aux
E o L
cordes du mode Eolien, ou à fon caraéière ? S’agit il
même dans ces vers du véritable mode Eolien ?
i°. Le mode Eolien , 1e neuvième des quinze
modes Grecs, doit naturellement participer du caractère
des modes adjacens; c’eft-à-dire de la véhémence
du Phrygien & de la vivacité du Lydien. Or le
caraéière 'réfultant de ce mélange n’approche nullement
de la gravité.
g • a0. Le caraéière du mode Eolien ne doit-il pas être
celui des peuples chez lefquels il a pris naiffance ?
« O r , dit Héraclides de Pont, cité par Athénée ;
D e ip n o f . l iv . 14, les Eoliens, les Doriens, les Ioniens,
quoique Grecs, ne fe reffemblent nullement par le
caraéière. Perfonne n’ignore l’opiniâtreté avec laquelle
les Lacédémoniens (qui font Doriens) confervent
leurs moeurs & leurs ufages antiques. Les Theffaliens
ont encore le. caraéière des Eoliens dont-ils tirent leur
origine. Mais les Ioniens ont préfqüe tous été forcés
d’abandonner leurs anciennes Ipix pour s’affervir à
celles des barbares qui les ont fubjugués... Ces différens
peuples ont adopté chacun un caraéière de chant qui
porte leur nom. Le chant Dorien eft remarquable
par fa mâle & pompeufe gravité. Toujours fimple,
toujours égal, fombre, ferré, véhément & féyère.
L ’Eolien eft élevé, mais emphatique & diffus. Il n’eft
propre qu’à exprimer la fierté & la franchife naturelle
du voluptueux- Eolien , qui paffe fa vie dans les
plaifirs de la table & de l’amour. Les caraélères de
ces deux modes fe trouvent parfaitement réunis dans
le mode Hypodorien, à qui les Grecs, au rapport
du même Héraclides, ont aufli donné le nom d’Eolien.
C ’eft dans ce nome ( Hypodorien) qu’eft compofé
l’hymne de Lafus d’Hermione fur Cérès & fur la
ville, d’Hermioné fa patrie. J e célébrerai d a n s m e s
c h a n t s , f i v o u s me le p e r m e t t e d i v in e C é r è s , la b e lle '
M é l ib é e , lé p o u f e -d u D i e u d es E n fe r ? ? J e marierai ma
V o ix a u x fio ns g ra ve s de l'h arm on ie E o lie n n e . Ces chants.
Hypodonens font les feuls employés par les habitàns
d’Hermioné, qui font Eoliens. Ce n’eft donc pas fans
taifon que Lafus les appelle Eoliquës. v
Les mots barubromon armonian ne marquent-ils pas
diftinélement qu'il né s’agit point dans les vers de
Lafus de la gravité de caraéière, mais de la gravité
phyfique des inftrumens Eoliens?
30. D’ailleurs le mode Eolien ne peut pas même
être appellé phyfiquement grave, puifqu’il y a huit
modes plus graves que lui ; ( voyez, la p la n c h e E
d u D i f t o n n a i r e de R o u f f e a u ) & qu’il n’y en a q=e
fix>«r l’aigu. .Donc cette gravité, phyfique n’eft pas
applicable au mode Eolien.
C’eft donc fans fondement qu’Athénée ib ïd . veut
que le mode Eolien ait été appelé H y p o d o r ie n à caufe
du rapport des caraélères du mode Dorien & de
l’Eolien. Il eft vrai que le mot h y p o devant un acljeélif
grec indique très-fou vent un diminutif; àinfi c h a u a o s
E PA 517
fighifie m o l ; h y p o ch a u n o s fignifiè u n p e u m o l ; mais
jamais le mor hypodorien n’a été employé dans le fens
de app roch an t d u D o r ie n ou de u n p e u D o r ie n .
Il faut donc conclure décidément contre l’autorité
de Rouffeau que la gravfté n’eft point le caraéière
dp mode Eolien, & qu’il ne s’agit point de ce mode
dans les vers de Lafus. ( M . l ’ abbé F e y to u . )
ÉPAIS, a dj. Genre ép a is , denfe, ou ferré , 7rvx.vôs
eft , félon la définition d’Ariftoxène, Celui où, dans
chaque tétracorde, la fomme des deux premiers intervalles
qft moindre que le troifième. Ainfi le genre
enharmonique eft é p a i s , parce que les deux premiers
intervalles, qui font chacun d’un quart de ton,'ne
forment enfemble qu’un femi-ton ; fomme .beaucoup
moindre que le troifième intervalle, qui eft une tierce
majeure. Le chrorhatique eft aufli un genre é p a is ;
car fes deux premiers intervalles ne forment qu’un
ton, moindre encore que la tierce mineure qui fuit.
Mais le genre diatonique n’eft point é p a i s , puifque
fes deux premiers intervalles forment un ton & demi,
fomme plus grande que le ton qui fuit. ( Voyez
G e n r e , T étraco rd e. )
De ce mot noxvôs comme radical, font compofés
les termes a p y e n i , b a r ip y e n i , m e fio p y c iv , O x i p y c n i ,
dont on trouvera les articles chacun à fa place.
Cette dénomination n’eft point en ufage dans la
mufique moderne. . ( J . J . R o u f f e a u .)
ÉPARCHA. Pollux , onomafi. l iv . I V 3 cha p . 9,
nous apprend que Véparcha étoit une des parties du
mode des Cithares, fui van t la divifion de T erpahdre :
c’étôit apparemment le p r é lu d e ; car c’eft ce que
fignifiè le mot épa r ch a . ( M . de C a f iilh o n . )
ÉPARCHEIA. C’étoit la fécondé partie du mode
des Cithares., fuivanr la divifion de Terpandre,
Pollux, onomafi. l iv . I V , cha p . 9. L 'é p a r c h e ia , commen
cemen t , étoit probablement le commencement
même dù mode, puifqu’il fuivoit Véparcha ou p r é lu d e .
( Voyez E p a r c h a . )
' . ( M . de C a f i ilh o n .)
ÉPlAULÎE. Nom que donnoient les Grecs à la
chanfon des meuniers, appelée autrement hy/née•
( Voyez C h a n fo n .)
Le mot burlëfque p ia u le r ne tireroit-il point d’ici
fon étymologie ? Le piaulement d’une femme ou d’un
enfant, qui pleure & fe lamente long-temps fur le
même ton, reffemble-affez à la chanfon d’un moulin ,
6c par métaphore, à celle d’un meunier.
( J . J . R o u f fe a ii. )
* Rouffeau ne paroît pas heureux en étymologies;
Ii a beau dire, on ne voit pas beaucoup de rapport
entré5le p ia u lem e n t d’une femme & la ch a n fo n d 'u n