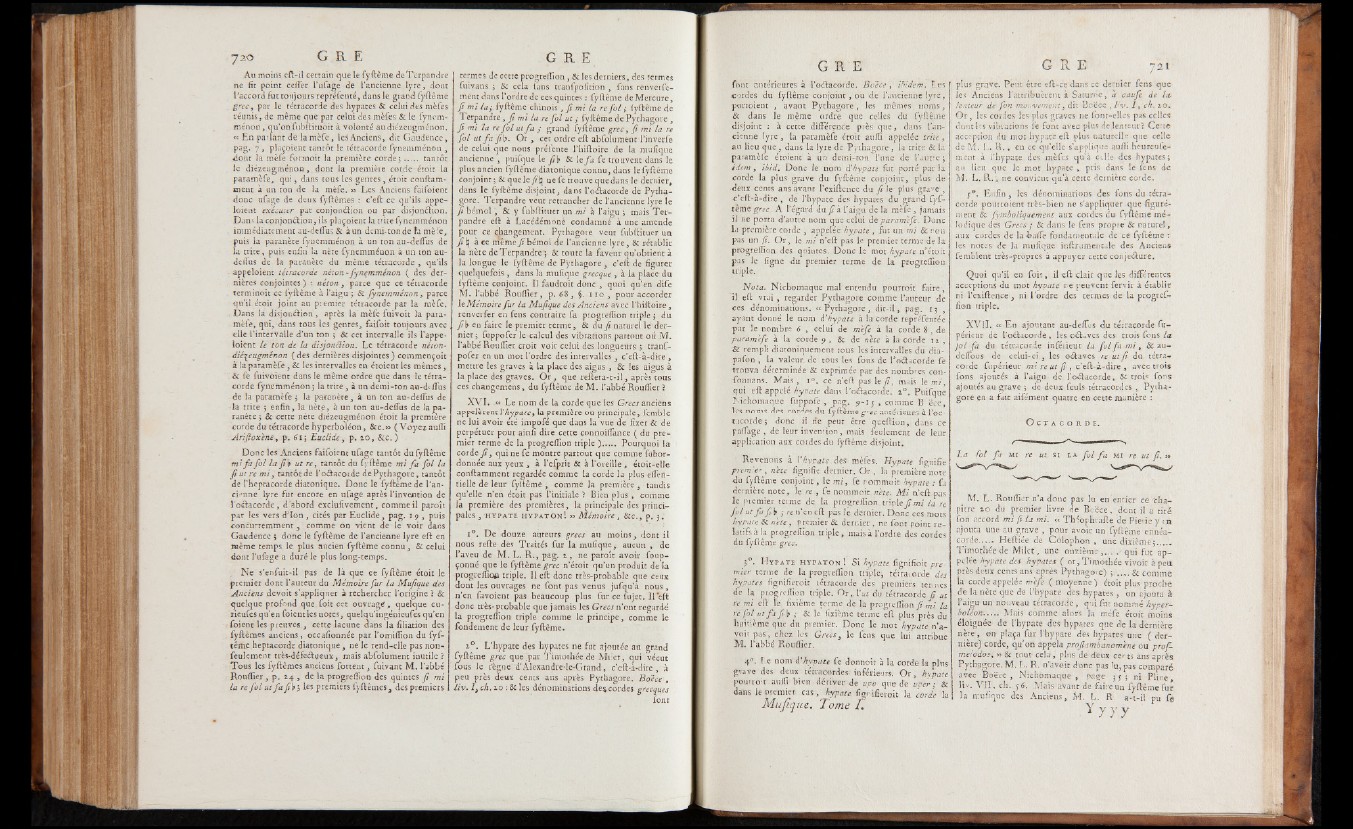
Au moins eft-it certain que le fyftême de Terpandre
ne fie point ceffier l’ufage de l’ancienne ly re , dont
l ’accord fut toujours repréfenté, dans le grand fyftême
grec, par le tétracorde des hypates & celui des mèfes
réunis, de même que par celui des mèfes & le fynem-
ménon, qu’on fubftituoit à volonté au diézeugménon.
« En parlant de la mèfe , les Anciens, dit Gaudence,
psg. 7 , plaçoient tanrôt le tétracorde fynemménon ,
rlont la mèfe formoir la première corde ; ...... tantôt
le diézeugménon , dont la première corde éroir la
paramèfe, qui , dans tous les genres , .étoit conftam-
ment à un ton de la mèfe. j* Les Anciens faifoient
donc ufage de deux fyftêrnes : c’eft ce qu’ ils appe-
loient exécuter par conjonction ou par disjonction.
Dans la conjonction, ils plaçoient la trite fynemménon
immédiatement au-deffus & à un demi-ton de !a mèfe,
puis la paranète fynemménon à un ton au-deffus de
la trite, puis enfin la nète fynemménon à un ton au-
deffus de la paranète du même tétracorde , qu’ils
appeloient tétracorde néton-fynemménon ( des dernières
conjointes) ; néton , parce que ce tétracorde
terminoit ce fyftême à l’aigu ; & fynemménon, parce
qu’il éroir jo in t au premier tétracorde par la mèfe.
Dans la disjonction, après la mèfe fuivoit la paramèfe,
qui, dans tous les genres, faifoit toujours avec .
elle l’intervalle d’un ton ; & cet intervalle ils Pappe-
loient le ton de la disjonction. Le tétracorde nétoti-
dié^eugménon (des dernières disjointes) commençoit
à la paramèfe , & les intervalles en étoient les mêmes,
& fe fuivoienc dans le même ordre que dans le tétracorde
fynemménon 5 la trite , à un demi-ton au-ddfus
de la paramèfe ; la paranète, à un ton au-deffus de ,
-la trite ; enfin, la nète, à un ton au-deffus de la paranète
; & cette nète diézeugménon étoit la première
corde du tétracorde hyperboléon, & c .» (V o y e z aufîi
Ariftoxene-, p_ 6i ; Euclide , p. 20, &c. )
Donc les Anciens fàifoient ufage tantôt du fyftême
572/ fa fo l la f i \ ut re, tantôt du fyftême mi fa fo l la
f i ut re mi, tantôt de l’oâacorde de Pythagore, tantôt
de I’bepracordé diatonique. Donc le fyftême de l’ancienne
lyre fur encore en ufage après l’invention de
i ’o<ftacorde, d ’abord exclufivement, comme il paroît
par les vers d’i o n , cités par Euclide, pag. 19 , puis
concurremment, comme on vient de le voir dans
Gaudence ; donc le fyftême de l’ancienne lyre eft en
même temps, le plus ancien fyftême connu , & celui
dont l’ufage a duré le plus long-temps.
N e s’enfuit-il pas de là que ce fyftême étoit le
premier dont l'auteur du Mémoire fur la Mufique des
Anciens devoit s’appliquer à rechercher l’origine ? &
quelque profond que foie cet ou v rag e, quelque cu-
rieuCes qu’en foientles notes, queJqu’ingénieufes qu’en
foient les preuves , cette lacune dans la filiariou des
fyftêrnes anciens , oecafionnée par l’omiffion du fyf-
tême heptacorde diatonique, ne le rend-elle pas non-
feulement très-défeôtgeux, mais abfolument inutile ?
Tou s les fyftêrnes anciens fortent, fuivant M. l’abbé
Rouffier, p. 24 , de la progreffion des quintes f i mi
la re fo l ut fafi\r> les premiers fyftêrnes, des premiers
termes de cette progreffion, & les derniers, des termes
fuivans ; & cela fans tranfpofition , fans renverfe-
ment dans l’ordre de ces quintes : fyftême de Mercure,
fi mi la3. fyftême chinois , f i mi la re fol y fyftême de
Terpandre, f i mi la re fol ut y fyftême de Pythagore ,
f i mi la re fo l ut fa y grand fyftême grec, fi. mi la re
fo l ut fa fi\>. Or y cet ordre eft abfolument l’inverle
de celui que nous préfente l’hiftoire de la mufique
ancienne , puifque le fi\> & le fa fe trouvent dans le
plus ancien fyftême diatonique connu, dans le fyftême
.conjoint ; & que le fit| ne fe trouve que dans le dernier,
dans le fyftême disjoint, dans l’o&aeorde de Pythg-
gore. Terpandre veut retrancher de l’ancienne lyre le
f i b ém o l, & y fubftit ucr un mi à l’aigu j mais T er pandre
eft à Lacédémone condamné à une amende
pour ce changement. Pythagore veut fubftituer un
_/? fcj à ce même f i bémol de l’ancienne ly re , & rétablir
la nète de Terpandre-; & toute la faveur qu’obtient à
la longue le fyftême de Pythagore , c’eft de figurer
quelquefois , dans la mufique grecque , à la place du
fyftême conjoint. Il faudroit donc , quoi qu’en dife
M. l’abbé R ou file r, p. 6 8 , §. 1 1 0 , pour accorder
le Mémoire fur la Mufique des Anciens avec l’hiftoire,
renverfer en fens contraire fa progreffion triple ; du
fi b en faire Je premier terme, & du f i naturel le dernier
; fuppofer le calcul des vibrations partout 011 .M.
l’abbé Rouffier croit voir celui des longueurs ; tranf-
pofer en un mot l’ordre des intervalles , c’eft-à-dire,
mettre les graves à la place des aigus , & les aigus à
la place des graves. O r , que reftera-t-ii, après tous
ces changemens, du fyftême de M . l’abbé Rouffier ?
X V I . « Le nom de la corde que les Grecs anciens
appelèrent \'hypate, la première ou principale, femble
ne lui avoir été impofé que dans la vue de fixer & de
perpétuer pour ainn dire cette connoiffance ( du premier
terme de la progreffion triple ) ...... Pourquoi la
corde f i , qui ne fe montre partout que comme fiibor-
donnée aux yeux , à l’efpric & à l’oreille , étoir-elle
conftamment regardée comme la corde la plus efferi-
tielle de leur fyftême , comme la première , tandis
qu’elle n’en étoit pas l’initiale ? Bien plus , comme
la première des premières, la principale des principales
, h y pa t e h y p a t o n 1 33 Mémoire, & c ., p. 3 ;
i ° . De douze auteurs grecs au moins , donc il
nous refte dès Traités fur la mufique, aucun , de
l’aveu de M . L. R ., pag. 2 , ne paroît avoir foup-
çonné que le fyftême grec n’étoit - qu’un produit de la
progreffion triple. Il eft donc très-probable que ceux
donc lçs ouvrages ne font pas venus jufqu’à nous,
n’en favoient pas beaucoup plus fur ce lu jet. Il *éffc
donc très-probable que jamais les Grecs n’ont regardé
la progreffion triple comme le principe, comme le
fondement de leur fyftême.
20. L ’hypate des hypates ne fut ajoutée au grand
fyftême grec que par Timothée de M i’e t, qui vécut
fous le règne d’ Alexandre-le-Grand, c’eft-à-dire , à
peu près deux cents ans après Pythagore. Bo'èce ,
liv.ly ch. 20 : & les dénominations des cordes grecques
font
font antérieures à l’otftacorde. Bo'èce. , ibidem. Les
cordes du fyftême conjoint, ou de l’ancienne ly re ,
porroient , avant Pyth ago re, les mêmes noms,
& dans le même ordre que celles du fyftême
disjoint : à cette différence près q ue , dans l’ancienne
ly r e , la paramèfe éroit aufîi appelée trite,
au lieu q ue , dans la lyre de Pythagore , la trite & la
paramèfe étoient à un demi-ton l’une de l’autre ;
idem y ibid. Donc le nom d'hypate fut porté par la
corde la plus grave du fyftême conjoint, plus de
•deux cents ans avant l’exiftence du fi le plus grave ,
c ’ eft-a-dire , de l’hypate des hypates du grand fy f-
rême grec. A l’égard du fi a l’aigu de la mèfe, jamais
il ne porta d’autre nom que celui de paramèfe. Donc
la première corde , appelée hypate , fut un mi & non
pas un (i. O r , le mi n’eft pas le premier terme de la
progreffion des quintes. Donc le mot hypate n’étoit
pas le figne du premier terme de la progreffion
triple.
Nota. Nichomaque mal entendu pourroit faire ,
il eft v r a i, regarder Pythagore comme l’auteur de
ces dénominations, «c Pythagore, dic-il, pag. 13 ,
ayant donné le nom d'hypate à la corde repréfentée
par le nombre 6 , celui dé mèfe à la corde 8 | de
paramèfe à la corde 9 , & de nète à la corde n ,
& rempli diatoniquement tous les intervalles du dia-
pa fon , la valeur.de tous les fons de foéh co rd e fe
trouva déterminée & exprimée par des nombres con-
fonnans. M a is , i ° . ce n’eft pas le fi, mais le mi,
qui eft appelé hypate dans l ’o&acorde. 20. Puifque
Lichomaque fuppofe , pag. 9 -15 , comme B ëce,
les noms des cordes du fyftême grec antérieurs à l’oc-
tacorde ; donc il ne peur être qeeftion, dans ce
pafTage , de leur invention, mais feulement de leur
application aux cordes du fyftême disjoint.
Revenons à \'hypate. des mèfes. Hypate fignifie
premier, nete fignifie dernier. Or , la première note
du fyftême conjoint, le mi, fe rommoit hypate : fa
dernière noce, le rc , fe nommoit nète. Mi n’eft pas
le premier terme de la progreffion triple ƒ mi la re
f i l ut fa f- 1> y /en en eft pas le dernier. Donc ces mots
hypate & nète , premier & dernier, ne font point relatifs
à la progreffion triple, mais à l’ordre des cordes
du fyftême grec.
3 0. H y pa t e h y p a t o n 1 Si hypate fîgnifioic premier
terme de la progreffion triple; tétracorde des
hypates fïgnifîeroit tétracorde des premiers termes
de la progreffion triple. O r ,,1’ut du.tétracorde Ç ut
re mi eft le fixième terme de la progreffion fi mi la
re fo l ut fa fi- b ; & le fixième terme eft plus près du
huitième que du premier. Donc le mot hypate n’a-
voit pa s, chez les Grecs, Je fens que lui attribue
M . l’abbé Rouffier.
4°. Le nom d’hypate fe donnoit à la corde la plus
grave des deux tétracordes; inférieurs. O r , hypate
pourro't auffi bien dériver de upe que de uper ; &
dans le premier cas , hypate figrifîeroic la corde la
MufiqueI Tome / .
plus grave. Peut être eft-ce dans ce dernier fens que
les Anciens l'attribuèrent à Saturne, a caufe de leu
lenteur d e f i n mouvement, dit Bcëcc , V v . I , ch. 20.
O r , les cordes les plus graves ne fonr-elles pas celles
dont k s vibrations fe font avec plus de lenteur? Cette
acception du mot hypate eft plus naturelle que celle
de M. !.. R . , en ce qu’elle s’applique aufîi heureufe-
menr à i’hypate des mèfes qu’à celle des hypates;
au lieu que le mot hypate pris dans le fens de
M. L . R . ; ne convient q u ’à cette dernière corde.
y®. En fin , les dénominations des fons du tétracorde
pourroient très-bien ne s’appliquer que figuré-
ment & fymboliquement aux cordes du fyftême mélodique
des Grecs ; & dans le fens propre & naturel,
aux cordes de la ■baffe fondamentale de ce fyftême :
les notes de la mufique inftrumentalë des Anciens
femble ne très-propres à appuyer cette co n je ctu re.
Quoi qu’il en fo i t , il eft clair que les différentes
acceptions du mot hypate ne peuvent fervir à établir
ni l’exiftence , ni l ’ordre des termes de la progreffion
triple.
X V I I . ce En ajoutant au-deffus du tétracorde fu-
périeur de l’odtaeorde, les odt«ves des trois fons la
J o l fa du tétracorde inférieur la f i l f a mi , & au-
deflbus de celui-ci , les ©Caves re ut f i du tétracorde
fupérieur m i re ut f i , c’eft-à-dire, avec trois
fons ajoutés à l’aigu de l’oCacorde, & trois fons
ajoutés au grave ; de deux feuls tétracordes , Pytha-
gore en a fait aifément quatre en cette manière :
O c T A C O R D E .
La fol fa mi re ut. s i la fo l fa mi re ut fi. 3»
M. L . Rouffier n’a donc pas lu en entier ce 'chapitre
20 du premier livre de Bcëce , dont il a tiré
fon accord mi fi la mi. ce Th^ophràfte de Pierie y en
ajouta une au grave , pour avoir un fyftême ennéacorde......
Heftiée de Côlophon , une dixième;.....
Timothée de Milct , une on zième,__- qui fut appelée
hypate des hypates ( or, Timothée vivoit à peu.
près deux cents ans après Pythagore) & comme
la corde appelée mèfe ( moyenne ) étoit plus proche
de la nète que de l’hypate des hypates , on ajouta à
l’aigu un nouveau tétracorde , qui fut nommé hyperboléon.....
Mais comme alors la mèfe étoit moins
éloignée de l'hypace des hypates que de la dernière
n è te , on plaça fur l’hypace des hypates une ( dernière)
corde, qu’ on appela proflambanomène ou prof-
me/odos, 33 & tout ce la , plus de deux certs ans après
Pythagore. M. L. R. n’avoir donc pas lu, pas comparé
•avec Éoëce , N ich omaque , page 3 y 5 ni Pline
liv. V I I , ch. y 6. Mais avant de faire un fyftême fur
la mufique des Anc iens, M. L. R. a-t-il pu fe