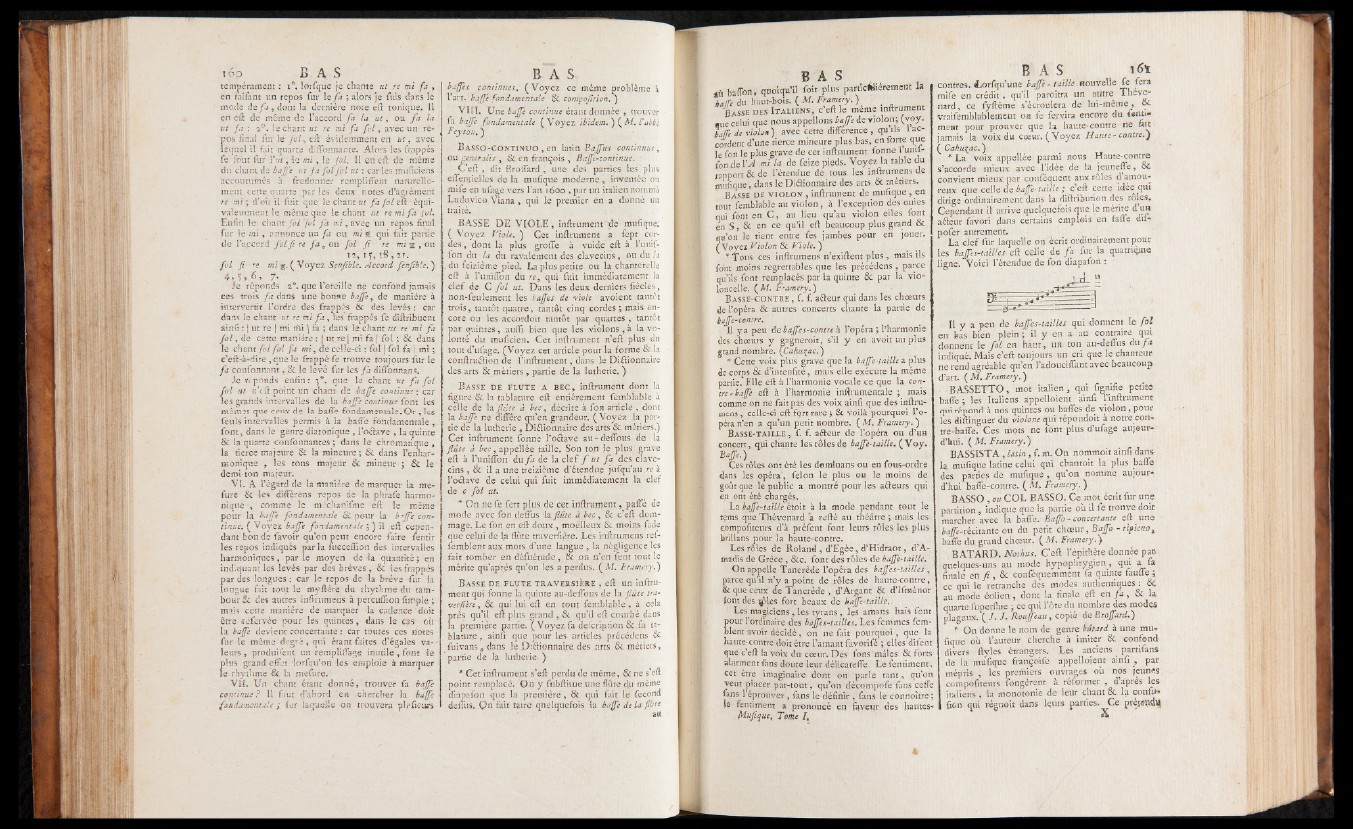
16p BAS
tempérament : i°. lorfque je chante u t re mi fa ,
en faifant un repos fur le fa ; alors je fuis dans le
mode de f a , dont la' dernière note eft tonique, il
en eû de même de l’accord fa la u t , ou fa la
u t fa : 2°. léchant u t re mi f z f> l , avec un repos
final fur le fo l , eft évidemment en u t , avec
lequel il fait quarte diffonnante. Alors les frappés
fe font fur Y ut ; le m i, le fol. Il en eft de même
du chant de baffe u t fa fol fo l u t : caries muflciens
accoutumés ä fredonner rempliffent naturellement
cette.quarte .par les deux notes d’agrément
re mi ; d’où il fuit que le chant ut fa fol eft équi-
vaiemment le même que le chant u t re mi fa (oL
Enfin le chant/ô/ fui fa h.i , avec un repos final
fur ie mi , annonce un fa ou mi m. qui fait partie
de laçcerd fo l f i re f a 9 ou fol f i re ml g , ou
12, 15, l 6 , 2T.
f o l f i re mi g . ( Voyez Senfible. Accord, fenfible. )
4 , 5 , , 6 , 7 .
Je réponds 20. que l ’oreille ne confond jamais
ees trois fa dans une bonne ba ffe, de manière à
intervertir l’ordre des frappés & des levés : car
dans le chant u t re mi f a , les frappés fe diflribuent
ainfi : | ut re | mi mi \ fa ; dans le chant.«/ re mi fa
f o l , de cette manière •: | ut re | mi fa J fol ; & dans
lé chant fol fo l fa mi, de celle-ci : fol | fol fa' | mi ;
e’eft-à-dire , que le fràppéfe trouve toujours fur le
fa confonnant, & le levé fur les fa diffonnans.
Je réponds enfin : 3*. que le chant u t f a f o l
f o l u t n’eft point un chant de b a ffe continue ■: car
les grands intervalles de la baffe continue font les
mêmes que ceux de la baffe fondamentale. Or , les
feuls intervalles permis _à la baffe fondamentale
font j dans le genre diatonique , l ’oçtaye , la quinte
& la quarte conformantes ; dans le chromatique >
la tierce majeure & la mineure ; & dans l’enharmonique
, les tons majeur & mineur ; & le
demi-ton majeur.
VI. A l’égard de la manière de marquer la me-
fure & les différons repos de la phrafe harmonique
» comme le méchanifme eff le même
pour là baffe fondamentale oc peur la b/*ffe continue.
( Voyez baffe fo n d am en ta le ; ) il eft cependant
bon de favoir qu’on peut encore faire fentir
les repos indiqués par la fuccefïion des intervalles
harmoniques, par le moyen de la quantité ; en
indiquant les levés par des brèves , & les frappés
par des longues .- car le repos de la brève fur la
longue fait tout ie myftère du rhythme du tambour
& des autres infirume-ns à percufïion fim-ple ;
mais cette manière de marquer la cadence doit
être réfervée pour les quintes, dans le cas où
la baffe devient concertante : car toutes ces notes
fur le même ‘degré , qui étant faites d’égales va- -
leurs , produifent mi rernpliffàge inutile , font ie ■
plus grand effet lorfqu’on les emploie à marquer ■
le rhythme &. la mefure.
VIL Un chant étant donné, trouver fa baffe
c o n tin u e ? Il faut d’abord en chercher la baffe ■
fo n d am en ta le ; fur laquelle on trouvera phrfieurs
B A S
baffes continues. ( V oyez ce même problème a
l’art, baffe fondamentale & compofition. )
V III. Une baffe continue étant donnée , trouver
fa baffe fondamentale ( Voyez ibidem. ) ( M. l’abbi
Feyto.uA
BassÔ-CONTINUO , en latin Baffus continuât,
OU gencralis , & en françois , Baffe-continue.
C ’e f t , dit Broffard , une des parties les plus
effentielles de la mufique moderne, inventée ou
mife en ufage vers l'an. 1600 , par un italien nommé
Ludovic© Viana , qui le premier en a donné un
traité.
BASSE DE V IO L E , inflrument "de mufique;
( Voyez Viole. ) Cet inflrument a fept cordes,
dont la plus greffe à vuide eft à l’ünif-
fon du la du ravalement des clavecins, ou àu la
. du feizième pied. La plus petite ou la chanterelle
eff à runîffon du re, qui fuit immédiatement la
cle f de C fo l ut. Dans les deux derniers fiècles,
non-feulement les baffes de viole avoient tantôt
trois, tantôt quatre, tantôt cinq cordes; mais encore
on les accordoit tantôt par quartes , tantôt
par qulfites, .suffi bien que les violons,à la volonté
du muficien. Cet infiniment n’eft plus du
tout d’ufsge-. (Voyez cet article pour la forme & la
conflriiâion de l’inArument, dans le Dictionnaire
des arts & métiers , partie de la lutherie. )
Basse de flûte a b e c , inflrument dont la
figure & la tablature eft entièrement femblable à
celle de la flûte à bec, décrite à fon article , dont
la baffe ne diffère qu’en grandeur. (V o y e z la partie
de la lutherie , Diélionnaire des arts & métiers.)
Cet infiniment fonne l’oâavé au-deffous de la
flûte a bec, appellée taille. Son ton té plus grave
eft à l’uniffon du fa de la clef f ut fa des clavecins
, & il a une treizième d’étendue jtifqu’au.re à
l ’o&ave de celui qui fuit immédiatement la clef
de ç fol ut.
* On ne fe fert plus de cet inflrument, paffé de
mode avec fon çleffus la flûte à. bec, 8c c’eft dommage.
Le fon en eft doux, moelleux & moins fade
que celui de l,a flûte traverfière. Les inftrumens ref-
lemblent aux mors d’une langue , la négligence les
fait tomber en désuétude , & on n’en fent tout le
mérite qu’aprps qu’on les a perdus. ( M. Itrameiy.)
Basse de flûte tr a v ersière , eft un infiniment
qui fonne la quinte au-deffous de la flûte traverfière
, & qui lui eft en tout femblable, à cela
près qu’il eft plus grand , & qu’il eft courbé dans
la première partie. (V o y e z fa description & fa ta*
blature, ainfi que pour les article^ précédens &
fuivans , dans le Dictionnaire des arts & métiers,
partie de là lutherie. )
* Cet inflrument s’eft perdu de même, & ne s’eft
point remplacé. On y fubftitue une flûte du même
diapafon que la première, & qui fait le fécond
demis, Qn fait faire quelquefois la baffe delà flûte
au
B A S
, ft baffon, quoiqu’il foit plus particfcièremeut la
hälfe du haut-bois. ( M. Framery. )
"Basse des Italiens , c’eft le même inflrument
-ue celui que nous appelions baffe de violon; (voy.
baffe de violon ) avec cette différence , qu ils 1 accordent
d’une tierce mineure plus bas, en forte que
le fon le plus grave de cet inflrument fonne 1 unif-
fonde VA mi la de feize pieds. Voyez la table du
rapport & de l’étendue de tous les inftrumens de
mufique, dans le Dictionnaire des arts & métiers.
Basse de v io lo n , inflrument de mufique , en
tout femblable au violon, à l’exception des ouies
qui font en C , au lieu qu’au violon elles font
en S , & en ce qu’il eft beaucoup plus grand &
qu’on le tient entre fes jambes pour en jouer.
(Voyez Violon 8c Viole. )
* Tous ces inftrumens n’exiftent plus , mais ils
fo'nt moins regrettables que les précédens, parce
qu’ils font remplacés par la quinte & par la violoncelle.
(AL Framery.)
Basse-contre , f. f. aCleur qui dans les choeurs ,
de l’opéra & autres concerts chante la partie de
baffe-centre.
11 y a peu de baffes-contre à l’opéra ; l’harmonie
des choeurs y gagnerait, s’il y en avoit un plus
grand nombre. \Cahu\ac. )
* Cette voix plus grave que la baffe-taille a plus
de corps & d’intenfité, mais elle exécute la même
partie. Elle eft à l’harmonie vocale ce que la contre
baffe eft à l’harmonie inftrumentale ; mais
comme on ne fait pas des voix ainfi que des inftrumens
, celle*ci eft fprt rare ; & voilà pourquoi l’opéra
n’en a qu’un petit nombre. ( M. Framery. )
Basse-taille , f. f. aâeur de l’opéra ou d’un
conçert, qui chante les rôlçs d§ baffe-taille. (V o y .
Baffe.)
Ces rôles ont été les domînans ou en fous-ordre
dans les opéra0, félon le plus ou le moins de
goût que le public a montré pour les aéleurs qui
en ont été chargés,
La baffe-taille étoit à la mode pendant tout le
tçms que Thévenard à refté au théâtre ; mais les
compofiteurs d’à préfent font leurs rôles les plus
bnllans pour la haute-contre.
Les rôles de Roland , d’Egée, d’Hidraot, d’A -
madis de Grèce, &c. font des rôles de baffe-taille.
Gnappelle Tancrède l’opéra des baffes-tailles,
parce qu’il n’y a point de rôles de haute-contre,
& que ceux de Tancrède , d’Argant & d’ifraénor
font des ijples fort beaux de baffe-taille..
Les magiciens, les tyrans, les amans haïs font
pour l’ordinaire des baffes-tailles. Les femmes fem-
blent avoir décidé, on ne fait pourquoi, que la
haute-contre doit être l’amant favorifé ; elles difent
que e’eft la voix du coeur. Des fons'mâles & forts
alarment fans doute leur délieateffe. Le fentiment,
cet être imaginaire dont on parle tant, qu’on
vent placer par-tout, qu’on décqmpofe fans ceffe
fans 1 éprouver , fans le définir , fans le connoître ;
le fentiment a prononcé en favçqr des hautes*
frlufi^ue, Tme
B A S i 6 t
!- contres, io r fq u ’une baffe - taille nouvelle fe fera
mife en crédit , qu’il paroîtra un autre Thévenard
, ce fyftême s’écroulera de' lui-même, &
vraifemblablement on fc fejrvira encore du ■ fenti»
meut pour prouver que la haute-contre ne fut
jamais la voix du coeur. (V o y e z Haute-contre.)
( Cahuçac. )
* La voix appellée parmi nous Haute-contre
s’accorde mieux avec l’idée de la jeuneffe, &
convient mieux par çonféquent aux rôles d’amoureux
que celle de baffe- taille ; c eft cette idee qui
dirige ordinairement dans la diflribution des rôles.
Cependant il arrive quelquefois que le mérite d un
1 aéleur favori dans certains emplois en fatie dif-*
pofer autrement.
La clef fur laquelle on' écrit ordinairement pour
: les baffes-tailles, eft celle de fa fur la quatrième
ligne. Voici l’étendue de fon diapafon :
Il y a peu de baffes-tailles qui donnent le fo l
en bas bien plein ; il y en a au contraire qui
donnent le fo l.cn haut, lin ton au-deffiis du fa
indiqué. Mais c’eft toujours un cri que le chanteur
ne rend agréable qu’en l’adoueiflant avec beaucoup
d’art. ( M. Framery. )
B A S SE T TO , mot italien, qui fignifie petite
baffe ; les Italiens appelloient ainfi Tinftrument
qui répond à nos quintes ou baffes de violon, pour
les diftinguer du violone qui repondoit a notre contre
baffe. Ces mots ne font plus d’ufage aujourd’hui.
( M. Framery.)
B A SS ISTA , latin, f. m. On nommoit ainfi dans-
la mufique latine celui qui çhantoit la plus baffe
des parties de mufique, qu’on nomme aujour-
d’hui baffe-contre. ( M. Framery. )
B A S SO , su CO L B ASSO. Ce mot écrit fur une
partition , indique que lu partie où il fe trouve doit
marcher avec la baffe. Bafo - concertante eft une
éd^r-récitante ou dü petit choeur, Baffo -rifienoy
baffe du grand çhoeur. ( M. Framery.)
B A T A R D . N-othus. C ’eft l’épithète donnée pais
quelques-uns au mode hypophrygien_, qui a fa
finale en f i , & conféquemment fa quinte fauffe ;
! ce qui le retranche des modes authentiques : &
au mode éolien, dont la finale eft en f a , & la
quarte fuperflue ; ce qui l’ôte du nombre des modes
plagaux. ( J. J- Roujfeau, copié de Broffard.)
* On donne le nom de genre bâtard à une mu»
tique où l’auteur cherche à imiter & confond
divers ftyles étrangers. Les anciens partifans
de la mufique françoife appelloient ainfi | par
mépris , les premiers ouvrages où nos jeunes
compofiteurs fongèrent a reformer , d après les
italiens, la monotonie de leur chant & la confia
fion qui régnoit dans leurs parties. Ce pre$t$çh|