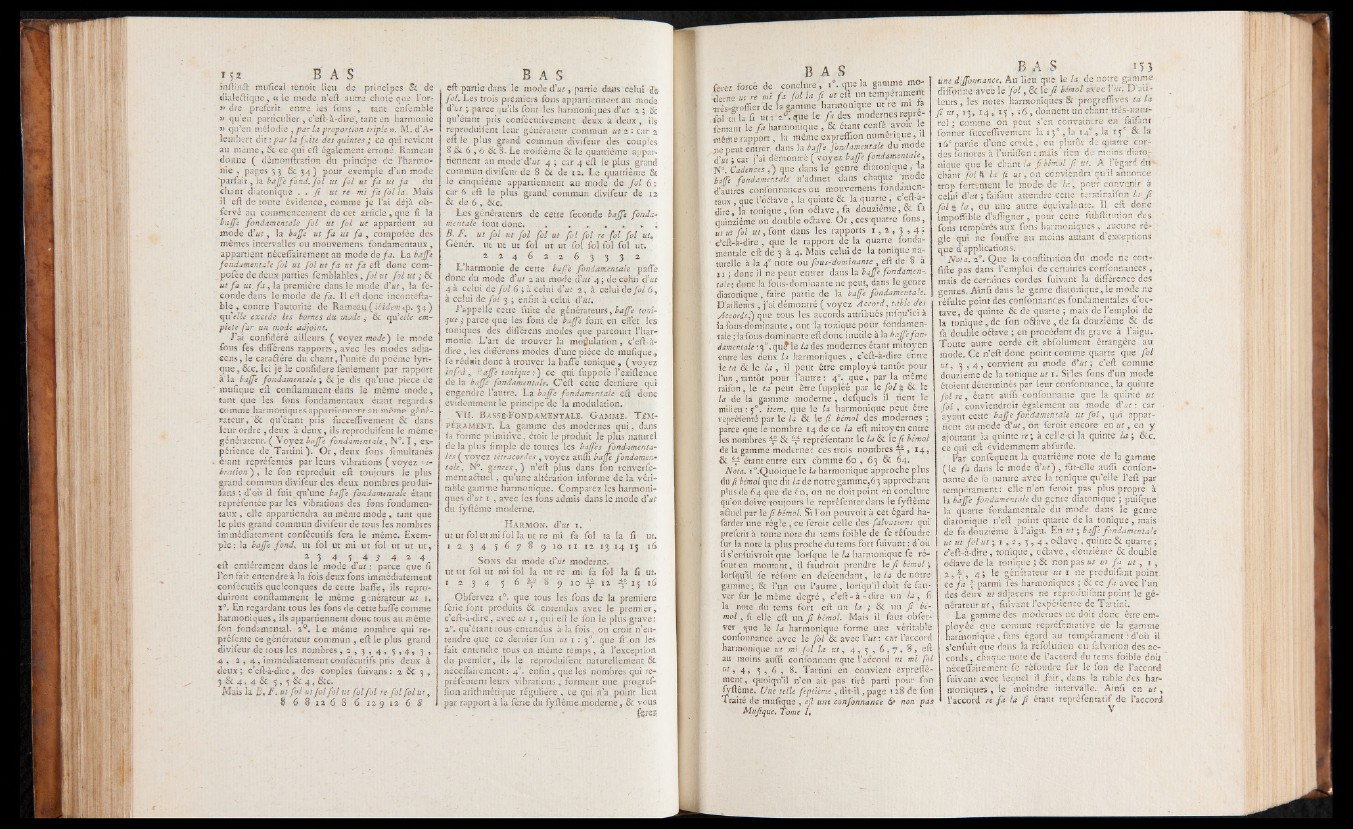
T 52 B A S
inftinét musical tenoit lieu de principes 8c de .
dialeétique, « le mode n’eft autre choie que l’or? j
» dre prefcrit encre les fons , tant enfemble I
» qu’en particulier, c’eft-à-dire', tant en harmonie |
« qu’en mélodie , par la proportion triple ri. M.d’A- I
lembert dit : par la fuite des quintes; ce qui revient
au même , St-ee qui eft également erroné. Rameau
donne ( démonftration du principe de l’harmonie
, pages 33 ôc 3 4 ) pour exemple d’un mode
'parfait, la 'baffe fond, fo l ut fo l ut fa ut fa du
chant diatonique . .■ f i ut re mi fa fo lia . Mais
il eft de toute évidence, comme je l’ai déjà ob-
fervé au commencement de cet article , que fi la
baffe fondamentale fo l ut fo l ut appartient au
mode d'u t , la baffe ut fa ut fa , compofée des
mêmes intervalles ou mouvemens fondamentaux ,
appartient néceffairement an mode de fa. La baffe
fondamentale fo l ut fo l ut fa ut fa efl donc compofée
de deux parties fémblables , fo l ut fol ut ; 8c
ut fa ut. f a , la première dans le mode d'ut, la fécondé
dans le mode de fa. Il efl donc incontèfta-
ble , contre l’autorité de Rameau ( ibidem a.p. 34)
qu'elle excede les bornes du mode ,• & qu’e//e empiète
fur un mode adjoint.
J’ai confidéré ailleurs .( voyez mode) le mode
fous fes différens rapports, avec les modes adja-
cens, le caraétère du chant, l’unité du poëme lyrique
, &c. Ici jë le confidere feulement par rapport
à’ la baffe fondamentale ; & je dis qu’une piece de
mufique efl: conflamment dans le même mode,
tant que les fons fondamentaux étant regardés
comme harmoniques appartiennent au même générateur,
8c qu’étant pris fucceflivement & dans
leur ordre , deux à deux, ils reproduifent le même/
générateur. ( Voyez baffe fondamentaleN°. I , expérience
de Tartini). O r , deux fons fimultanés
étant repréfentés par leurs vibrations ( voyez vibration
) , le fon reproduit efl toujours le plus
grand commun divifeur des deux nombres produi-
fans ; d’où il fuit qu’une baffe-fondamentale étant
repréféntée par les vibrations des fons fondamentaux
, elle appartiendra au même mode , tant que
le plus grand commun divifeur de tous les nombres
immédiatement confécutifs fera le même. Exemple:
la baffe fond, ut fol ut mi ut fol ut ut ut,-
., 2 3 4 5 4 5 4 2 4
efl entièrement dans le mode dû ut: parce que fl
Ton fait entendre à la fois deux fons immédiatement
confécutifs quelconques de cette baffe, ils reproduiront
conflamment le même générateur ut 1.
i° . En regardant tous les fons de cette baffe comme
harmoniques, ils appartiennent donc tous au même
fon fondamental. 2°. I e même nombre qui 'repréfente
ce générateur commun , efl le plus grand
divifeur de tous les nombres , 2 , 3 , 4 , 5 , 4 , 3 ,
4 , 2 , 4 , immédiatement confécutifs pris deux à
deux ; c’eft-à-dire, des couples fuivans : 2 8ç 3 ,
3 & 4 , 4; &- 5, 5 & 4 , &c.
Mais la B. F. ut fo l ut fo l fo l ut fo l fo l re fo l fo l ut,
§ 6 S 12 6 8 6 12 9 12 6 8
B A S
efl partie dans le moded’« /, partie .dans celui' de
fol.. Les trois prèmiers fons appartiennent au mode
d’a/ parce qu’ils font les harmoniques d'ut 2 ; &
qu’étant pris confécutivement deux à deux, ils
reproduifent leur générateur commun ut 2 : car a
efl le plus grand: commun divifeur des couples
8 .8c 6 , 6 8c 8. Le rroiflème & le quatrième appartiennent
au mode'd’wr 4 ; car 4 efl le plus grand
commun divifeur de 8 & de 12. Le quatrième 8c
le cinquième appartiennent au mode de fo l 6 :
car 6 efl le plus grand commun divifeur de 12
& de 6 , &c.
Les générateurs de cette féconde baffe fonda*
mentale font donc. \ . . „ , „ - ^ ;
B. F. ut fol ut fo l fo l ut fo l fo l re fo l fo l ut.
Génér. ut ut ut fol ut ut fol fol fol fol ut.
2 2 4 6 2 2 6 3 3. 3 2
L’harmonie de cette baffe fondamentale paffe
donc du mode d'ut 2 au mode d’-«/ 4 ; dé colui dé ut
4 à celui dé fo l 6 ; à celui d’«/ 2, à celui de fo l 6,
à celui de fô l 3 ; enfin à celui d'ut.
J’appelle cette fuite de générateurs, baffe tonique
; parce que les fons de Baffe font, en effet les
toniques des différens modes que parcourt l’harmonie.
L’art de trouver la modulation, c’eft-à-
d ire, les différens modes d’une pièce de mufique.,
fe rédait donc à trouver la baffe tonique , ( voyez
infrà , Baffe tonique : ) ce qui fuppofe l’exiflence
de la baffe fondamentale. C ’eft cette derniere qui
engendre l’autre. La baffe fondamentale efl donc
évidemment le principe de la modulation.
. VII. Basse-Fondamentale. G amme. T empérament.
La gamme des modernes qui, dans
(a forme primitive, étoit le produit le plus naturel
de la plus Ample de toutes les baßes fondamentales
( voyez tétracordes , voyez aufli baffe fondamentale
, N°. genres, ) n’eft plus dans fon renverfe-
mênt aéluel, qu’une altération informe de la véritable
gamme harmonique. Comparez les harmoniques
d’ut 1 , avec les fons admis dans le mode d'ut
du fyffême moderne.
Harmon. d9ut 1.
ut ut fol ut mi fol la ut re mi fa fol ta la fi ut.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16
Sons du mode d’ut moderne,
ut ut fol ut mi fol la ut re mi fa fol la fi ut.
1 2 3 4 5 6 2Ls 8 p 10 Xf i2 ” 15 16
Obfervez i°. que tous les fons de la première
-férié/ont produits & entendus avec le premier,
c’eft-à-clire, avec ut 1, qui efl le fon le plus grave:
20. qu’étant tous-entendus à-la fois , on croit n’entendre
que ce dernier fon «£1:3°. que fi\.on les
fait entendre tous en même temps, à l’exception
du premier, ils le reproduifent naturellement &
néceffairement : 40. enfin, que les nombres qui ré-
préfentent leurs vibrations forment une progref-
fion arithmétique régulière , ce qui n’a point lieu,
par rapport à la férie du fyflême,moderne, 8c vous
ferez forcé do conclure , i°. que la gamme mo:
derne ut n mi fa fo l la f i ut eft un tempérament
très-^offier'de la gamme harmonique ut re mi ta
fol -ta la fi ut : - 2°. que le fa des modernes représentant
le fa harmonique étant cenfé-avoir le
îiiêifte rapport, la même ex-preffion numérique, il
jié peut entrer! dans la baffe fondamentale du mode
d’ut ; .car j’ai démontré (v o y e z baffe fondamentale,
N°. Cadences f ) que clans le genre diatonique , la
baffe fondamentale n’admet- dans chaque 'mode
d’autres confonnances ou mouvemens foildanien-
taux , que l’ô&ave , la quinte & la quarte , c’efl-à-.
dire, la tonique , fon oétave, fa douzième, & fa
quinzième ou double oétave. O r , ces-quatre ions,
ut ut fol u t, font dans les rapports 1 , 2 , 3 ? 4 :
c’eft-à-dire , que le rapport de la quarte fondamentale
efl de 3 à 4* Mais celui de la tonique naturelle
à la 4* note ou fous-do minante , eft de 8 à
11 j donc il ne peut entrer dans la baffe fondamentale:
donc la fous-dominante ne peut, dans le genre
diatonique , faire partie de la baffe fondamentale.
D!ailienrs , fa i démontré ( voyez Accord, table des ;
Accords ,) que tous les accords attribués jufqu’ici à
ia fous-dominante , o,nt la tonique pour, fôndamen-
, tale;la fous-dominante eft donc inutile à la baffe fon-
damentale : 30, qu^le la des modernes étant mitbyen
entre ies deux la harmoniques , c’eft-a-dire entre
le ta 8c le la , il peut être employé tantôt pour
Win , tantôt pour l ’autre : 40. que , par la même
râifon, le ta peut être fup-pléé par le fo l # 8c le
la de la gamme moderne , delquels il tient le
milieu : 50. item, que le la harmonique peut être
représenté par lèAa 8c le f i bémol des modernes ,
parce que le-nombre 14 de ce la eft mitoyen entre
les nombres ^ 8c repréféntanr le la 8c le f bémol
de la gamme moderne : ces trois nombres ^ , : 14 ,
8c ^ étant entre eux comme 60 , 63 8c 64.
Nota. i 0.<^uoique le la harmonique approche plus
du fi bémol que du la de notre gamme,63 approchant
plus de 64 que de 60, on ne doit point en conclure
qu’on doive toujours le repréfenterdans fé fyflême
aâuél par le ƒ bémolfS1 l'on pouvoit à cet égard ha-
farder une règle , ce feroit celle des falvations qui
prefcrit à toute note du tems foible de fe réfoudre
fur la note la plus proche du tems fort fuivant : d’où
il s’enfuivroit que lorfque le la harmonique fe ré-
foiiten montant, il faudroit prendre le f i bémol ;
lorfqu’41 fe réfout en defcendant, le la de notre
gamme ; 8c l’ijn ou l’autre , lorfqu’il doit fe fan-,
, ver fur le même degré, c’ e ft-à ■’ dire un l a , fi
la note du tems fort eft un la ; 8c un f i bémol
| fi elle efl un f i bémol. Mais il faut obfer-
ver que le la harmonique forme une véritable
confonnance avec le fol 8c avec Vut : car l’accord
harmonique ut mi fol la u t , 4 , '5 , 6 , 7 , 8 , eft
au moins aufli confonnant que l ’accord ut mi fol
“b 4 ) 5 , 6 , 8 . Tartini en convient expreffé-
ment, quoiqu’il n’en ait pas tiré parti pour fon
fyflême. Une telle fcptïeme , dit-il, page 128 de fon
Traité de mufique , efl une confonnance 6* non pat
Mufique. Tome ï%
ûne dljforinance. Au lieu que le la. de notre gamme
diffonne avee le fo l , 8c le f i bémol avec Vut. D ailleurs
, les notes harmoniques 8c progreffiVes ta la
f i ut, 1 3 , 1 4 , 1 5 , i.6y, donnent un chant très-naturel
; comme on peut s’en convaincre en faifimt
fonner fucceflivement la 13e la 14e , la 15e 8c la
16e partie d’une cOrds , ou plutôt de quatre cordes
fonorés à l’uniffen -..mais rien de moins diatonique
que le chant ta f ib t r r io ïf f iu t . A l’égard du-
chaiit fo l & U fi «r , on conviendra qu’il annonce
trop fortement le inode* de la , pour convenir à
celui d’ut ; faifant attendre cette terminaifon la .fi
fol # la , ou une autre équivalente. Il efl donc
impoflible d’afi’igner, pour cette fub.ftitmion des '
fons tempérés aux fons harmoniques , aucune rè-
gle qui ne fouffre au moins autant d’exceptions
que d’applications.
Nota. 20. Que la conftitution du mode ne cbn-
fifle pas dans l’ emploi de certaines confonnances ,
niais de certaines cordes fuivant la différence des
genres. Ainfi dans le genre diatonique, le mode ne
réfulte point des confonnances fondamentales d’octave^
de quinte & de quarte ; mais de l’emploi de
la tonique, de fon o â a v e , de fa douzième 8c de
fa double oâave ; en procédant du grave à l'aigu.
Toute autre corde eft. abfolument étrangère au
mode. Ce n’eft donc point comme quarte que fo l
ut 9 3 , 4 , convient au mode d’ ut ; 'c’eft comme
douzième de la tonique ut 1. Siles fons d’un mode
étoient déterminés par leur confonnance, la quinte
fol re, étant aüffi çonfonnante que la quinté ut
fo l , conviendrez également an mode d’ut : car ■
ayant cette' baffe fondamentale ut f o l , qui appartient
au mode dCut, ôn féroit encore en ut > en y
ajoutant ia quinte re ; à celle-ci la quinte la ; 8cc.
ce qui eft évidemment abfurde.
Par confisquent la quatrième note de la gamme
( le fa dans le mode d’ut) , fût-elle aufli confon-
nante de fa nature avec la tonique qu’elle l’eft par
tempérament : elle n’en féroit pas plus propre à
la baffe fondamentale du genre diatonique ; puifque
la quarte fondamentale du mode dans le genre
diatonique n’eft point quarte de la tonique , mais
de fa douzième à l’aigu. En ut ; baffe fondamentale
| ut ut fo l ut ; 1 ,2 , 3 ,4 , oétave , quinte 8c quarte ;
c’eft-à-dire, tonique, oétave, douzième & double
oétave de la tonique ; & non pas ut ut fa ut , \ ,
2 , f » 4 ? le générateur ut 1 ne produifant point
ee fa { parmi fes harmoniques ; & ce fa avec l’un
des deux ut àdjaceris ne reprc-duiîânt point le générateur
ut, fuivant l’experience de Tartini.
La gamme des modernes ne doit donc être employée
que comme repréfentative de la gamme
harmonique , fans égard au tempérament : d’où il
s’enfuit que dans la réfolütion ou falvation des accords,
chaque note de l’ accord du tems foible doit
néceffairement fe réfoudre fur le fon de l’accord
fuivant avec lequel il .fait, dans la table des harmoniques
, le moindre intervalle. Ainfi en u t ,
l’accord re fa la fi étant repréféntatif de l’accord