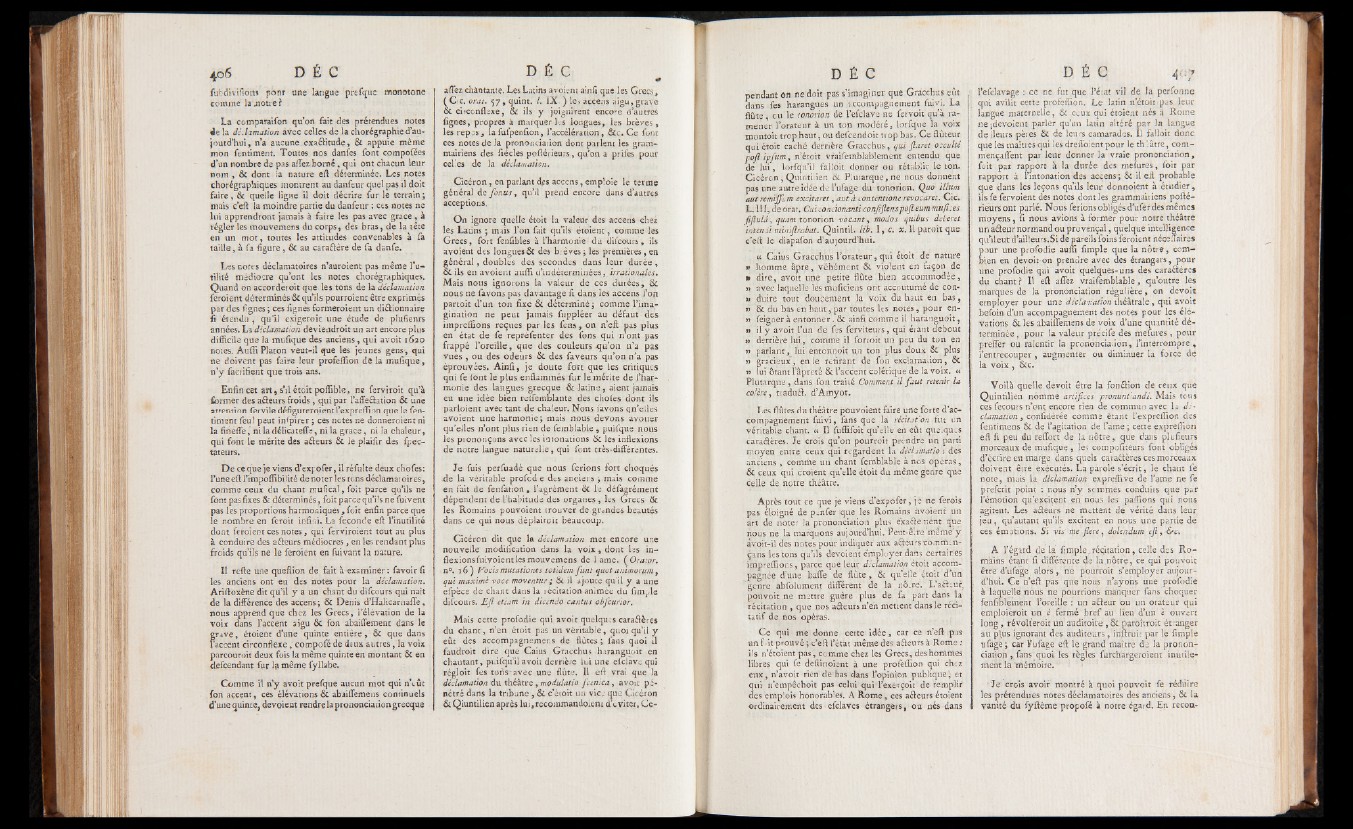
fubdivifions pönr une langue prefque monotone
comme la .notre?
La comparaifon qu’on fait des prétendues notes
Je la déclamation avec celles de la chorégraphie d’aujourd’hui,
n’a aucune exaéiitude, & appuie même
mon fentiment. Toutes nos danfes font compofées
d’un nombre de pas affez borné, qui ont chacun leur
nom , & dont fa nature eft déterminée. Les notes
chorégraphiques montrent au danfeur quel pas il doit
faire, & quelle ligne il doit décrire fur le terrain;
mais c’eft la moindre partie du danfeur : ces notes ne
lui apprendront jamais à faire les pas avec grâce, à
régler les mouvemens du corps, des bras, de la tête
en un mot, toutes les attitudes convenables à fa
taille, à fa figure, & au caraéière de fa danfe.
Les notes déclamatoires n’auroient pas même l’utilité
médiocre qu’ont les notes chorégraphiques.
Quand on aceorderoit que les tons de la déclamation
feroient déterminés & qu’ils pourroient être exprimés
par des fignes ; ces lignes formeroient un di&ionnaire
fi étendu , qu’il exigeroit une étude de plufienrs
années. La déclamation deviendrait un art encore plus
difficile que la mufique des anciens, qui avoit 1620
notes. Auffi Platon veut-il que les jeunes gens-, qui
ne doivent pas faire leur profeffion de la mufique,
n’y facrifient que trois ans.
Enfin cet art, s'il étoit poffible, ne ferviroit qu’à
former des aûeurs froids , qui par l’affe&ation & une
attention fervile défigureraient l’expreffion que le fen-
tîment feul peut inspirer ; ces notes ne donneroierst ni
la fineffe, ni la délicateffe, ni la grâce, ni la chaleur,
qui font le mérite des aéleurs & le plaifir des fpec-
tateurs.
De ce que je viens d’expofer, il réfulte deux chofes:
l'une eft l'impoffibilité de noter les tcns déclamai oires,
comme ceux du chant mufical, foit parce qu’ils ne
font pas fixes & déterminés, foit parce qu’ils ne fuivent
pas les proportions harmoniques , foit enfin parce que
le nombre en ferait infini. La fécondé eft l'inutilité
dont feroient ces notes, qui ferviroient tout au plus
à conduire des aéleurs médiocres, en les rendant plus
froids qu’ils ne le feroient en fuivant la nature.
Il refte une queflion de fait à examiner: favoirfi
les anciens ont eu des notes pour la déclamation.
Ariftoxène dit qu’il y a un chant du difcours qui naît
de la différence des acçens ; & Denis d’Halicarnaffe,
nous apprend que chez les Grecs, l’élévation de la
voix dans l’accent aigu & fon abaiffement dans le
grave, étoient d’une quinte entière, & que dans
faccent circonflexe, compofé de deux autres, la voix
parcourait deux fois la même quinte en montant & en
descendant fur la même fyllabe.
Comme il n’y avoit prefque aucun mot qui n’cût
fon accent, ces élévations & abaiffemens continuels
d’une quinte, dévoient rendre la prononciation grecque
affez chantante. Les Latins avoient ainfi que les Grecs,
( G.c. or ut. 5 7 , quint. I. I X ) les accens aigu, grave
& circonflexe, & ils y joignirent encore d’autres
lignes, propres à marquer fis longues, les brèves,
les repos, la fufpenfion, l’accélération, &c. Ce font
ces notes de la prononciation dont parlent les grammairiens
des fiècles poftérieurs, qu’on a prifes pour
cel.'es de la déclamation.
Cicéron, en parlant des accens, emploie le terme
général de ƒ omis, qu’il prend encore dans d’autres
acceptions,
On ignore quelle étoit la valeur des accens chez
les Latins ; mais l’on fait qu’ils étoient, comme les
Grecs, fort fenfibles à l'harmonie du difcours, ils
avoient des longues & des b.-èves ; les premières, en
général, doubles des secondes dans leur durée ,
& ils en avoient auffi d’indéterminées, irrationales,
Mais nous ignorons la valeur de ces durées, &
nous ne favons pas davantage fi dans les accens l’on
partoit d’un ton fixe & déterminé ; comme l’imagination
ne peut jamais fuppléer au défaut des
impreffions reçues par les fens, on n’eft pas plus
en état de fe repréfenter des fons qui n’ont pas
frappé l’oreille, que des couleurs qu’on 11’a pas
vues , ou des odeurs & des faveurs qu’on n’a pas
éprouvées. Ainfi, je doute fort que les critiques
qni fe font le plus enflammés fur le mérite de l’harmonie
des langues grecque & latine, aient jamais
eu une idée bien reifemblante des chofes dont ils
parloient avec tant de chaleur. Nons favons qn’eiles
avoient une harmonie ; mais nous devons avouer
qu’elles n’ont plus rien de femblable , puifque nous
les prononçons avec les intonations & les inflexions
de notre langue naturelle, qui font très-différentes.
Je fuis perfuadé que nous ferions fort choqués
de la véritable profcd e des anciens ; mais comme
en fait de fenfarion , l’agrément & le défagrément
dépendent de l’habitude des organes, les Grecs &
les Romains pouvoient trouver de grandes beautés
dans ce qui nous déplaircic beaucoup,
Cicéron dit que la déclamation met encore une
nouvelle modification dans la v o ix , dont les inflexions
fuivoient les mouvemens de l ame. ( Orator.
n°. 16 ) Vocismutationes totidem funt quot anïmorum,
qui maxime voce moventur; & il ajoute qu’il y a une
efpèce de chant dans la récitation animée du fimple
difcours. EJl etiam in diccndç cantus obfcurior.
Mais cette profodie qui avoit quelques cara&ères
du chant, n’en étoit pas un véritable, quoi qu’il y
eût des accompagnemens de flûtes ; fans quoi il
faudroit dire que Caius Gracchus haranguait en
chantant, puifqu’il avoit derrière lui une efclave qui
rçgloit fes tons~avec une flûte. Il eft vrai que la
déclamation du théâtre, modulatio fcenica, avoir pénétré
dans la tribune, & ç’étoit un vice que Cicéron
& Qiuntilien après lui,recoinmandoieiu d’éviter. C ependant
on ne doit pas s’imaginer que Gracchus eût
dans fes harangues un eccompagnement fuivi. La
flûte, ou le tonorion de l’efclave ne fervoit qu’à ramener
l’orateur à un ton modéré, lorfque la voix
montoit trop haut, ou defeendoit trop bas. Ce flûteur
qui étoit caché derrière Gracchus, qui fiaret occulté
pofl ipfum, n’étoit vraifemblablement entendu que
de lu i, lorfqu’il falloit donner ou rétablir le ton.
Cicéron, Quintiiien & Piuiarque,ne nous donnent
pas une autre idée de l’ufage du tonorion. Quà ilium
aut reniiffum excitarct, aut à contentione revocaret. Cic.
L. 111, de orar. Cuï concionanti confißenspoß eum muß:es
fißuld, quam tonorion vacant, modos qmbus deberet
inien.il minifirabat. Quintil. lib. I , c. x. 11 paraît que
c’eft le diapafon d’aujourd’hui.
« Caius Gracchus l’orateur, qui étoit de nature
n homme âpre, véhément & violent en façon de
» dire, avoit une petite flûte bien accommodée,
j ? avec laquelle les muficiens ont accoutumé de con-
» duire tout doucement la voix du haut en bas,
» & du bas en haut, par toutes les notes, pour en-
» feigner à entonner. & ainfi comme il haranguoit,
» il y avoit l’un de fes ferviteurs, qui éiant debout
» derrière lui, comme il fortoit un peu du ton en
» parlant,' lui entennoit un ton plus doux & plus
« gracieux, en le retirant de fon exclama don, &
n lui ôtant râprëté & l’accent colérique de la voix. «
Plutarque, dans fon traité Comment il faut retenir la
colère, traduit. d’Amyot.
Les flûtes du théâtre pouvoient faire une forte d’accompagnement
fuivi, fans que la récitai on fut un
véritable chant. « Il fuffifoit quelle en eût quelques
caractères. Je crois qu’on pourrait prendre un parti
moyen entre ceux qui regardent la déclamation des
anciens , comme un chant femblable à nos opéras,
& ceux qui croient quelle étoit du même genre que
celle de notre théâtre.
Après tout ce que je viens d’expofer, jé ne ferois
pas éloigné de p.nfer que les Romains àvoienf un
art de noter la prononciation plus exaéteniènt que
nous ne la marquons aujourd’hui. Peut-êlre mêmé'y
avoit-il des notes pour indiquer aux aâéurs commsn-
çans les tons qu’ils dévoient employer dans certaines
impreffions, parce que leur déclamation étoit accompagnée
d’une baffe de flûte, & quelle étoit d’un
genre abfolument différent de la nô.ref L’aéfiur,
pouvoit ne mettre guère plus de fa part dans la
récitation , que nos aéieurs n’en mettent dans le récitatif
de nos opéras.
Ce qui me donne cette idée, car ce neft pas
unf.it prouvé; c’eft l’état même des a&eursà Rome :
ils n’étoient pas, comme chez les Grecs, des hommes
libres qui fe aeftinoient à une profeffion qui chez
eux, n’avoit rien de bas dans l’opifiïon publique} et
qui n’empêchoit pas celui qui Texérçoit de remplir'
des emplois honorables. A Rome , ces aéteurs étoient
ordinairement des efclaves étrangers, ou nés dans
l’efclavage : ce ne fut que l’érat vil de la perfonne
qui avilit cette profeffion. Le latin n’étoit pas leur
langue maternelle, ôc ceux qui étoient nés a Rome
ne jdevoient parler qu’un latin altéré par la langue
de fleurs pères & de leurs camarades. Il falloit donc
que les maîtres qui les dreffoient pour le th - âtre, com-
mençaffent par leur donner la vraie prononciation,
foit par rapport à la durée des mefures, foit par
rapport à l’intonation des accens ; & il eft. probable
que dans les leçons qu’ils leur donnoient à étudier,
ils fe fervoient des notes .dont les grammairiens poftérieurs
ont parlé. Nous ferions obligés d’u fer des mêmes
moyens, fi nous avions à former pour notre théâtre
unaéteur normand ou provençal, quelque intelligence
qu’ileut d’ailleurs.Si de pareils foins feroient néceffaires
pour une profodie auffi fimple que la nôtre, combien
en devoit-on prendre avec des étrangers, pour
une profodie qui avoit quelques-uns des caraéfères
du chant? Il eft affez vraifemblable, qu’outre les
marques de la prononciation régulière, on devoit
employer pour une déclamation théâtrale, qui avoit
befoin d’un accompagnement des notes pour les élévations
&. les abaiffemens de voix d’une quantité déterminée
, pour la valeur précife des mefures , pour
preffer ou ralentir la prononciation, l’interrompre,
l’entrecouper, augmenter ou diminuer la force de
la v o ix , &c.
Voilà quelle devoit être la fonction de ceux que
Quintiiien nomme artifices pronuniandi. Mais tous
ces fecours n’ont encore rien de commun avec la dé-
clamation , confidérée comme étant l’expreffion des
fentimens & de l’agitation de ï’ame ; cette expreffion
eft fi peu du reffort de la nôtre, que dans plufieurs
morceaux de mufique , les çompofiteurs font obligés
d’écrire en marge dans quels çaraétères ces morceaux
doivent être exécutés. La parole s’écrit, le chant fe
note, mais la déclamation expreffive de l’ame ne fe
preferit point : nous n’y sommes conduits que par
l’émotion qu’excitent en nous les paffions qui nous
agitent. Les aéteurs ne mettent de vérité dans leur
jeu, qu’autant qu’ils excitent en nous une partie dé
ces émotions. Si vis me .flere^ dolendum efl, &c.
A l’égard de la fimple. récitation, celle des Romains
étant fi différente de la nôtre,^ ce qui pouvoit
être d’ufage alors , ne pourroit s’employer aujourd’hui.
Ce n’eft pas que nous n’ayons une profodie
à laquelle nous ne pourrions manquer fans choquer
fenfiblemënt l’oreille : un aéfeur ou un orateur qui
emploièroit un é fermé bref au lieu d’un è ouvert
long, révolteroit un auditoire , & paroîtroit étranger
au plus ignqfaiit des auditeurs , inftruir par le fimple
ufage ; car Vufage eft le grand maître de la prononciation
, fans quoi les règles furchargeroient inutilement
la mémoire.i -
■ Je' crois avoir montré à quoi pouvoit fe réduire
les prétendues notes déclamatoires des anciens, & la
vanité du fyftême propofé à notre égard. En recon