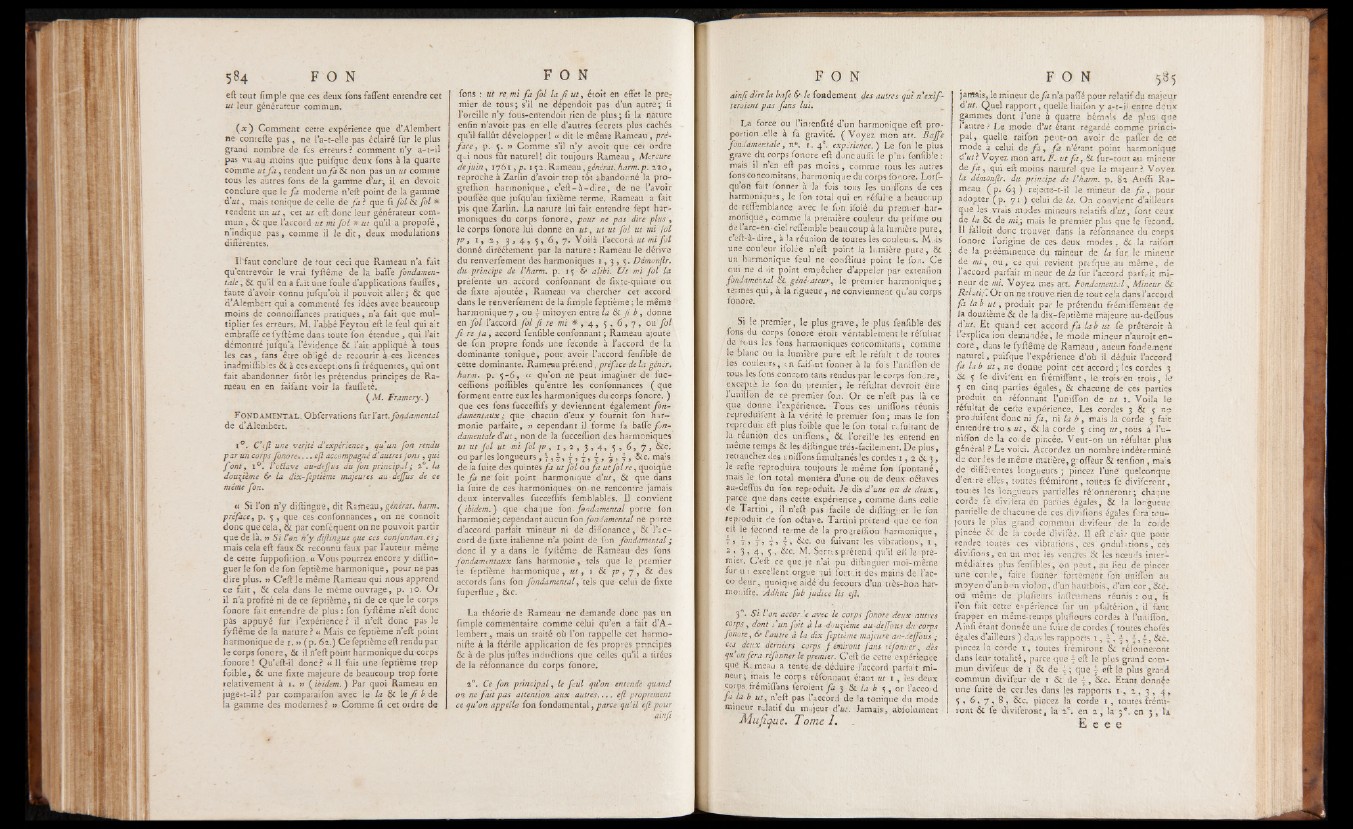
eft tout fini pie que ces deux Tons faffent entendre cet
ut leur générateur commun.
( x ) Comment cette expérience que d’Alembert
ne contefte pas, ne l’a-1-elle pas éclairé fur le plus
grand nombre de fes erreurs? comment n’y a-t-il
pas vu au moins que puifque deux fions à la quarte
comme u t ja , rendent un fa & non pas un ut comme
tous les autres fions de la gamme d’ut\ il en devoit
conclure que le fa moderne n’eft point de la gamme
d'ut, mais tonique de celle de fa } que fi fol & fol X
rendent un u t , cet ut eft donc leur générateur commun
, &-que l'accord ut mi fo l * ut qu’il a propofié,
n’indique pas, comme il le dit, deux modulations
différentes.
Il'faut conclure de tout ceci que Rameau n’a fait
qu’entrevoir le vrai fyftême de la baffe fondamentale
, & qu’il en a fait une foule d’applicatipns fauffes,
faute d’avoir connu jufqu’oii il pouvoir aller ; & que
id’Alembert qui a commenté fes idées avec beaucoup
moins de connoiffances pratiques, n’a fait que multiplier
fies erreurs. M. l’abbé Feytou eft le fieul qui ait
embraffé ce fyftême dans toute fon étendue , qui l’ait
démontré jufiqu’à l’évidence & l’ait appliqué à tous
les cas, fans être obligé de recourir à ces licences
inadmiffibles & à ces exceptions fi fréquentes, qui ont
fait abandonner fitôt les prétendus principes de Rameau
en en faifant voir la fauffeté.
(M . Framery.')
Fondamental. Obfiervations fur l’art. fondamental
de d’Alembert. - .
i ° . C’ t f i une vérité d'expérience, qufun fon rendu
par un corps fonore• ... efi accompagné d'autres Jons, qui
fo n t , i ° . ToElave au-dejjus du fon principal; 2°. la
douzième & la dix-feptième majeures au-dejfus de ce
même fon.
« Si l’on n’y diftingue, dit Rameau, générât, harm.
préface, p. 5 , que ces xonfonnances, on ne Connoît
donc que cela, & par conféquent on ne pouvoit partir
que de là. » Si l'on n y diflingue que ces confonnqn.es;
mais cela eft faux & reconnu faux par l’auteur même
de cette fiuppofiîion. « Vous pourrez encore y diftin-
guer le fon de fon feptième harmonique, pour ne pas
dire plus. » C’eft le même Rameau qui nous apprend
ce fait, & cela dans le même ouvrage, p. 10. Or
il n’a profité ni de ce feptième, ni de ce que le corps
fonore fait entendre de plus : fon fyftême n’eft donc
pas appuyé fur l’expérience? il n’eft 'donc pas le
fyftême de la nature ? « Mais ce feptième n’eft point
harmonique de 1. » ( p. 62.) Ce feptième eft rendu par
le corps fonore, 5c il n’eft point harmonique du corps
.fonore! Qu’eft-il donc? « Il fait une feptième trop
foible, & une fixte majeure de beaucoup trop forte
relativement à 1. m (ibidem.) Par quoi Rameau en
juge-t-il ? par comparaifon avec le la Si le f i b de
la gamme des modernes? ».Comme fi cet ordre de
fions : ut re/ mi fa fo l la f i ut, étoit en effet le pre?
mier de tous; s’il ne dépendoit pas d’un autre;' fi
l’oreille n’y fous-entendoit rien de plus ; fi la nature
enfin n’avoit pas en' elle d’autres fecrets plus cachés
qu’il fallût développer I « dit le même Rameau , préface,
p. 5. >7 Comme s’il n’y avoit que cet ordre
qui nous fût naturel! dit toujours Rameau , Mercure
de juin, 17 6 1, p. 152. Rameau, générât, harm.p. 220,
reproche à Zarlin d’avoir trop tôt abandonné la pro-
greflion harmonique, c’e ft-à-d ire , de ne l’avoir
pouffée que jufqu’au fixième terme. Rameau a fait
pis que Zarlin. La nature lui fait entendre fept harmoniques
du corps fonore, .pour ne pas dire plus,
le corps fonore lui donne en u t, ut ut fol ut mi fol
jp, T, 2 y 3 , 4 , 5 , 6 , 7. Voilà l’accord ut mi fol
donné dirè&ement par la nature : Rameau le dérive
du renverfement des harmoniques 1 , 3, 5. Détnonfir.
du principe de l ’harm. p. 15 6* alibi. Ut mi fol la
prèlente un.. accord confonnant de fixte-quinte ou
de fixte ajoutée, Rameau va chercher cet accord
dans le renverfement de la fimple feptième ; le même
harmonique 7 , ou y mitoyen entré la & fi b , donne
en fo l l’accord fo l f i re mi * , 4 , 5 , 6 , 7 , ou fol
f i re fa y accord fenfible confonnant ; Rameau ajouté
de fon propre fonds une féconde à l’accord de la
dominante tonique, pour avoir l’accord fenfible de
cette dominante. Rameau prétend , préface de la gêner,
harm. p. 5 -6 , « qu’on ne peut imaginer de fuc-
ceflions poflibles qu’entre les confonnances ( que
forment entre eux les harmoniques du corps fonore. )
que ces fons fucceflifs y deviennent également fondamentaux;
que chacun d’eux y fournit fon harmonie
parfaite, » cependant il forme fa baffe fondamentale
d'ut, non de la fucceflion des harmoniques
ut ut fol ut mi fol jv , 1 , 2 , 3 , 4 , 5, 6 y 7 , Sic.
ou parles longueurs > 7 » 7* 7- » 7 > 7 , 5 » 7 * &c. ma^s
de la fuite des quintes fa ut fo l ou fa utfol re, quoique
le fa nefoit point. harmonique d'ut, & que dans
la fuite de ces harmoniques on ne rencontre jamais
deux intervalles fucceflifs femblables. Il convient
(ibidem.) que chaque fon. fondamental porte fon
harmonie; cependant aucun fon fondamental ne porte
d’accord parfait mineur ni de diffonance, & l’accord
de fixte italienne n’a point de fon fondamental ;
donc il y a dans le fyftême de Rameau des fons
fondamentaux fans harmonie, tels que le premier
le feptième harmonique, u t , 1 & p , 7 , & des
accords fans fon fondamental, tels que celui de fixte
fuperflue, &c.
La théorie de Rameau ne demande donc pas un
fimple commentaire comme celui qu’en a fait d’A lembert
, mais un traité ou l’on rappelle cet harmo-
nifte à la ftérile application de fes propres principes
& à de plus juftes inditérions que celles qu’il a tirées
de la réfonnance du corps fonore.
2°. Ce fon principal y le feul qu’on entende quand
on ne fait pas attention aux autres.. . . efi proprement
ce qu'on appelle fon fondamental, parce qu'il efi pour
aïnfi
ainfi dire la bafe & le fondement des autres qui n'txif-
teroient pas fans lui.
La force ou l’inrenfité d’un harmonique eft proportion
elle à fa gravité. (V o y e z mon art. Baffe
fondamentale y n°. 1. 4e. expérience.) Le fon le plus
grave du corps fonore eft donc aufli le p’us fenfible:
mais il n’en eft pas moins , comme tous les autres
fons concomitans, harmonique du corps fonore. Lôrfi-
qu’on fait tonner à la fois tous les unifions de ces
harmoniques, le fon total qui en réfui e a beaucoup
de reffemblance avec le fon ifolé du premier harmonique,
comme la première couleur du prifme ou
de l’arc-en ciel reffeinble beaucoup à la lumière pure,
c’eft-à-dire, à la réunion de toutes les couleu;s. Mais
une cou'eur ifolée n’eft point la lumière pure , &
un harmonique feul ne eonfrime point le fon. Ce
cui ne d >it point empêcher d’appeler par extenfion
fondamental & générateur., lé premier harmonique;
termes qui, à la rigueur , ne conviennent qu’au corps
fonore.
Si le premier, le plus grave, le plus fenfible des
fons du corps fonore étoit véritablement le réfuîtar
de tous les fons harmoniques concomitans, comme
le blanc ou la lumière .pire eft le réfiuit t de toutes
les couleurs, en faifiint fonner à la fois l’uniffon de
tous les fons cqncom taps rendus par le corps fondre,
excepte le fon du premier, le réfifitat devroit .être
1 unilfon de ce premier fon. Or ce n’eft pas là ce
que donne l’expérience. Tous ces unifions réunis
reproduifent à la vérité le premier fon; mais le fon
reproduit eft plus foible que le fon total r-fuîrant de
la réunion des unifions, & l’oreille les entend en
même temps & les difiingue très-facilement. De plus,
retranchez des unifions fimultanés les cordes 1 , 2 & 3,
le refte reproduira toujours le même fon fpontané,
mais le fon total montera d’une ou de deux oéfaves
au-deffus du fom reproduit. Je dis d'une ou de deux,
parce que dans cette expérience , comme dans celle
de Tartini, il n’eft pas facile de diftinguer le fon
reproduit de fon oéfâve. Tartini pretend que ce fon
elt le fécond terme de la progrefiion harmonique,
■ 7» à ) j j 7» f , Sic. ou fuivant les vibrations , 1 ,
2 > 3 > 4 -, 5 , &c. M. Serre s prétend qu’il efi le prémier.
C ’eft ce que je n’ai pu diftinguer moi-même
fur M excellent orgue qui fort' it des mains de l’ac-
co deur, quoique aidé du fecours d’un très-bon har-
monifte. Adhuc fub judice lis efi.
3°. Si l'on accorde avec le corps fonore deux autres
corps y dont 1 un fort a la douzième au-dejjous du corps
fonore, 6* l'autre à la dix feptième majeure au-dejfous ;
ces deux derniers corps fendront fans ré foncer y d'cs
qu'on fera rêfonner le premier. C ’eft de cette expérience
ggff K. meau a tenté de déduire l’accord parfait mineur
; mais le corps réfonnant étant ut 1 , les deux
corps. frémifTans feroient fa 3 Si. la b 5 , or l’accoi d
fa la-b ut y n’eft pas l’accord de la tonique du mode
mineur relatif du majeur d’ut. Jamais, abfolument
Mujîque. Tome 1, .
jamais, le mineur de fa n’a paffé pour relatif du majeur
d'ut. Quel rapport, quelle liaifon y a-t-ji entre deux
gammes dont l ’une à quatre bémols de p'us que
l’autre ? Le mode d’ut étant regardé comme principal,
quelle raifon peut-on avoir de palier de ce
mode à celui de f a , f z n’érant point harmonique
dut} Voyez mon art. F. ut fa , & fur-tout au mineur
dè f t , .qui eft moins naturel que le majeur ? Voyez
la demonfir. du principe d-: l ’harm. p. 82 Airfli Rameau
( p. 63 ) rejecte-t-il le mineur de fa r pour
adopter (p. 71 ) celui de la. On convient d’ailleurs
que les vrais modes mineurs relatifs dut y font ceux
de la & de /rai„; mais le premier plus que le fécond.
Il falloir donc trouver dans la réfonnance du corps
fonore l’origine de ces deux modes . ÔC la raifon
de la prééminence du mineur de La fur. le mineur
de mi y ou, ce qui revient prefque au même, de
1 accord parfait m neur de la fur l’accord parfait mineur
de mi. Voyez mes art. fondamental, Mineur &
Relitij. Or on ne trouve rien de tout cela dans l’accord
fa la b ut y produit par le prétendu frémiffemeat de
la douzième & de la dix-feptième majeure au-deffous
dut. Et quand cet accord fa la b ut fe prêteroit à
lexplica ion demandée, le mode mineur n’auroit encore,
dans le fyftême de Rameau, aucun fondement
naturel, puifque l’expérience d’ou il déduit l’accord
fa la b ut y ne donne point cet accord ; les cordes 3
Si 5 fe divi'ent en frémiffant, le. trois'en trois, le
5 en cinq parties égales, & chacune de ces parties
produit en réfonnant ljjnifTon de ut t. Voila le
refultat de cefte expérience. Les cordes 3 & 5 ne
produifent donc ni fa , ni la b , mais la corde 3 fait
entendre tro s ut y & la corde 5 cinq «£,roüs à l’u -
nifion de la corde pincée. Veut-on un réfultat plus
général ? Le voici. Accordez un nombre indéterminé
de cordes de même rfiâtière, g^offeur & tenfion, mais
de differentes longueurs; pincez l’une quelconque
d’en:re elles, tomes frémiront, toutes fe diviferonr,
toutes les longueurs partielles réfonneront; chaque
corde fe. divlfera en parties égales, & la longueur
partielle de chacune de ces divifions égales fera toujours
le plus grand commun divifeur de la corde
pincée & de la corde divifée. Il eft c'air que pour
rendre toutes ces vibrations, ces ondulations, ces
divifions, en un mot les ventres & les noeuds intermediaires
plus fenfibies, on peut, au lieu de pincer
une corde, faire fonner fortement fon unifibn au
moyen d’un bon violon, d’un hautbois, d’un cor, &c.
où même de plufieurs inftrumens réunis: ou, fi
l’on fait cette expérience fur un ofaltérion, i f faut
frapper en même-temps plufieurs cordes à l’iiniffon.
Ainfi étant donnée une fuite de cordes ( toutes chofès
égaies d’ailleurs ) dans les rapports 1 , i &c.
pincez la corde 1 , toutes frémiront & réfonneront
dans leur totalité, parce que \ eft le plus grand commun
divifeur de 1 & de y ; que ~ eft le plus grand
commun divifeur de i & de 7 , &c. Etant donnée
une fuite de cordes dans les rapports 1 , 2 , 3 , 4 ,
5 , 6 , 7 , 8, &c. pincez la corde 1 , toutes frémiront
& le diviferofit, la 2e. en 2 , la 3e. en 3 , la
E e e e