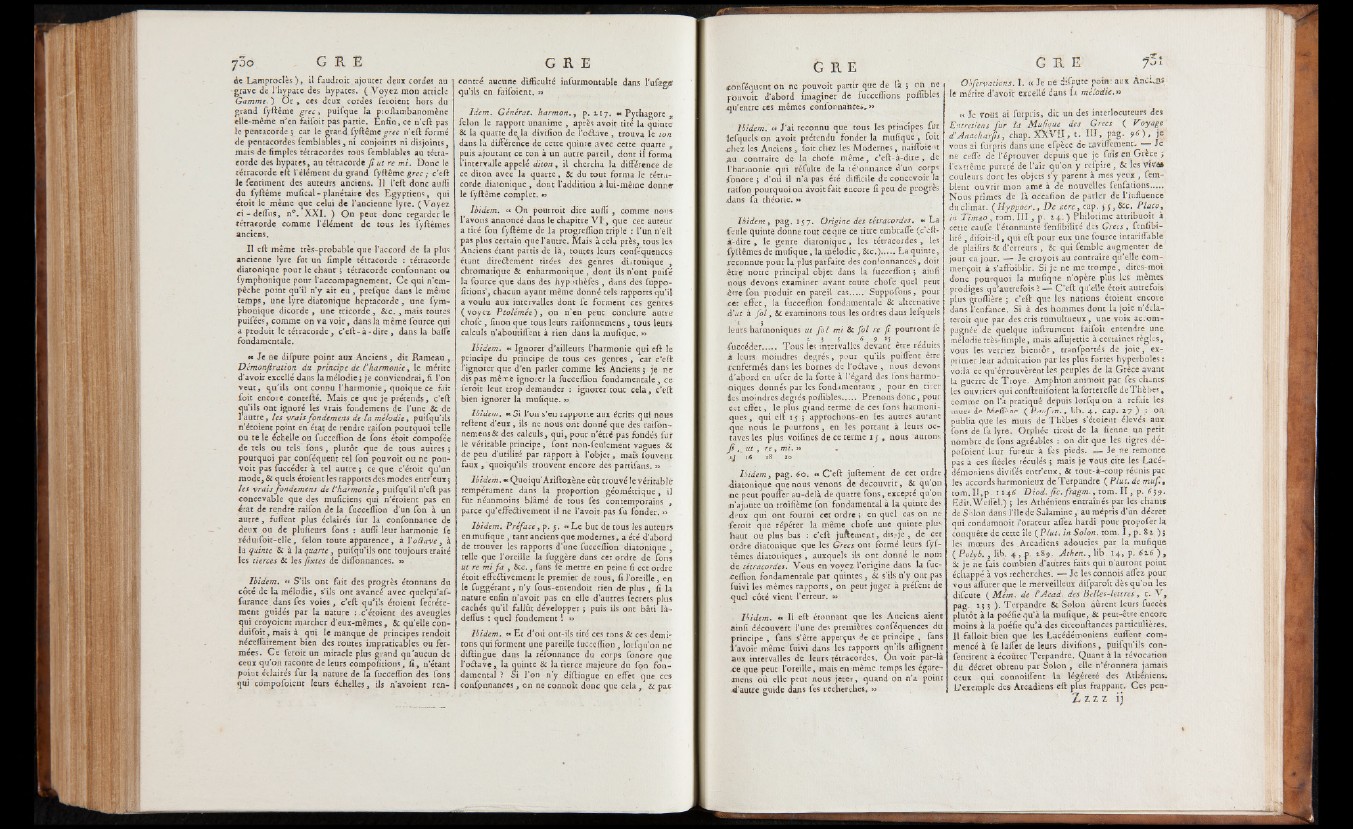
ÿ3o G R Ë
de Lamproclès ) , il faudrait ajouter dçux cordes au
grave de l’hypate des hypates. ( Voyez mon article
Gamme. ) Or , ces deux cordes feroient hors du
grand fyftême grec, puifque la pioflambanomène
elle-même nJcn faifoit pas partie. Enfin, ce n’eft pas
le pentacorde 3 car le grand fyftême grec n’eft formé
de pentacordes femblables , ni conjoints ni disjoints,
mais de (impies tétracordes tous femblables au tétra-
cordc des hypates, au tétracorde f i ut re mi. Donc le
tétracorde eft l'élément du grand fyftême grec ? c'eft
le fentiment des auteitrs anciens. Il l’eft donc aufll
du fyftême muficàl-planétaire des Egyptiens, qui
croit le même que celui de l’ancienne lyre. (Voyez
ci-deffus, n°. XXI. ) On peut donc regarder le
tétracorde comme l’élément de tous les iyftêmes
anciens.
Il eft même très-probable que l’accord de la plus
ancienne lyre fut un (impie tétracorde : tétracorde
diatonique pour le chanr 5 tétracorde confonnant ou
fymphonique pour l’accompagnement. Ce qui n’empêche
point qu’il n’y ait eu , prefquc dans le même
temps, une lyre diatonique heptacorde, une fymphonique
dicorde , une tricorde , &c. , mais toutes
puifées, comme on va voir, dans la même fource qui
a produit le tétracoide, c’eft-à-dire, dans la baffe
fondamentale.
•* Je ne difpute point aux Anciens, dit Rameau ,
Démonfiration du principe de l'harmonie, le mérite
d’avoir excellé dans la mélodie 5 je conviendrai, fi l’on
veut, qu’ils ont connu l’harmonie, quoique ce fait
foit encore contefté. Mais ce que je prétends, c’eft
qu’ils ont ignoré les vrais fondemens de l’une & de
l ’autre, les vrais fondemens de la mélodie, puifqu’ils
n’étoient point en état de rendre raifon pourquoi telle
ou te le échelle ou fucceflion de fons étoit compofée
dé tels ou tels fons, plutôt que de tous autres 3
pourquoi par conféquent tel fon pouvoit ou ne pouvoir
pas fuccéder à tel autre 5 ce que c’étoit qu’un
mode, & quels étoient lés rapports des modes entr’eux 3
les vrais fondemens de l'harmonie , puifqu’il n’eft pas
concevable que des muficiens qui n'étoient pas en
état de rendre raifon de la fucceflion d’un fon à un
autre, fuffent plus éclairés fur la confonnance de
deux ou de plufieurs fons : aufll leur harmonie fe
ïéduifoit-elle, félon toute apparence, à 1 'octave 3 à
la quinte & à la quarte , puifqu’ils ont toujours traité
les tierces & les fixtes de diffonnances. » ,
Ibidem. « S’ils ont fait des progrès étonnans du
côté de la mélodie, s’ils ont avancé avec quelqü’af-
furance.dans fes voies, c’eft qu’ ils étoient fecréce-
ment guidés par la nature :.c’étoient des aveugles
qui croyoient marcher d’eux-mêmes, & quelle con-
duifoit, mais à qui le manque de principes rendoit
iiéceffairement bien des routes impraticables ou fermées.
Ce feroit un miracle plus grand qu'aucun de
ceux qu’on raconte de leurs compofitions, f i , n’étant
point éclairés fur la nature de la .fucceflion des fons
qui cômpofoient leurs échelles, ils n’avoient ren-
G R E
contré aucune difficulté infurmontable dans l'ufagÿ
qu’ils en faifoient. »
Idem. Générât. narmon. , p. 117. * Pythagore T
félon le rapport unanime , après avoir tiré la quinte
& la quarte de la divifion de l’oétave , trouva le ton
dans la différence de cette quinte avec cette quarte y
puis ajoutant ce ton à un autre pareil, dont il forma
l’intervalle appelé diton, il chercha la différence de
ce diton avec la quarte, & du tout forma le tétracorde
diatonique, dont l’addition à lui-même donne
le fyftême complet. *»
Ibidem. « On pourroit dire auffi , comme nous'
l’avons annoncé dans le chapitre V P , que cet auteur
a tiré fon fyftême de la progreflîon triplé : l’un n’eft:
pas plus certain que l’autre. Mais à cela près, tous les
Anciens étant partis de là, toutes leurs conféquenccs
étant dire&ement tirées des genres diatonique ,
chromatique & enharmonique , .dont ils n’ont puifé
la fource que dans des hypothèfes , dans des fuppo-
fitions', chacun ayant même donné tels rapports qu’il
a voulu aux intervalles dont fe forment ces genres
(voyez Ptolémée) , on n’en peut conclure autre'
chofe, finon que tous leurs raifonnemens, tous leur*
: calculs rr’aboutiflent à rien dans la mufique. »
Ibidem. « Ignorer d’ailleurs l’harmonie qui eft le
principe du principe de tous ces genres , car c’eft
l’ignorer que d’en parler comme les Anciens 3 je ne
dis pas mêxè ignorer la fucceflion fondamentale, ce
feroit leur trop demander : ignorer tout cela, c’eft
bien ignorer la mufique. »
Ibidem. ««Si l’on s’en rapporte aux écrits qui nous
relient d’eux, ils ne nous ont donné que des raifon-
nemens& des calculs, qui, pour n’êtré pas fondés fur
le véritable principe, font non-feulement vagues &
de peu d’utilité par rapport à l’objet, mats (ouvenç
faux , quoiqu’ils trouvent encore des partifans. »
Ibidem. «Quoiqu’Ariftoxène eût trouvé le véritable
tempérament dans la proportion géométrique, il
fut néanmoins blâmé de tous fes contemporains ,
parce qu’effe&ivement il ne l’avoit pas fu fonder. *>
Ibidem. Préface, p. 5. «Le but de tous les auteurs
en mufique, tant anciens que modernes, a été d’abord
de trouver les rapports d’une fucceflion diatonique ,
telle que l’oreille la fuggère dans cet ordre de fons
ut re mi fa , & c ., fans fe mettre en pejne fi cet ordre
étoit effectivement le premier de tous, fi l’oreille, en
le fuggérant, n’y fous-entendoit rien de plus , fi la
nature enfin n’avoit pas en elle d’autres lecrets plus
cachés qu’il fallût développer 3 puis ils ont bâti là-
deffus : quel fondement 1 »
Ibidem. « Et d’où ont-ils tiré ces tons & ces demi"
tons qui forment une pareille fucceflion, Iorfqu’on ne
diftingue dans la réfonnance du corps fonore que
l'oCtaVe, la quinte & la tierce majeure du fon fondamental
? Si l’on ny diftingue en effet que ces
confpnnances, on ne conr.ok donc que c e l a ôc pat
G R E
«onféquçnt on ne pouvoit partir que de là 5 on ne
pouvoit d’abord imaginer de fucceflions pofllbles
qu’entre ces mêmes confonnahee*.»
Ibidem, ce J’ai reconnu que tous les principes fur
iefquels on avoit prétendu fonder la mufique, foit
chez les Anciens, foit chez les Modernes, naiffoient
jiu contraire de la chofe même, c’eft-a-dire , de
l'harmonie qui réfulte de la îéfonnance d’un corps
fonore 5 d’ou il n’a pas été difficile de concevoir la
raifon pourquoi on avoit fait encore fi peu de progrès
.dans fa théorie. »
Ibidem, pag, i$j . Origine des tétracordes. « L a
feule quinte donne tout ce que ce titre embraffe (c’eft-
it-dire , le. genre diatonique, les tétracordes, les
fÿilêmes de mufique, la mélodie, &c.)......La quinte,
reconnue pour la plus parfaite des confonnances, doit
être' notre principal objet dans la fucceflion 3 ainfi
nous devons examiner avant toute chofe quel peut
être fon produit en pareil cas..... Suppofons, pour
cet effet, la fucceflion fondamentale & alternative
.d’tfC à fol y 8c examinons tous les ordres dans lefqu.els
leurs harmoniques ut fo l mi & fo l re fi pourront fe
z 3 j 6 $ r 5
fuccéder..... Tous les intervalles devant êrre réduits
A leurs moindres degrés, pour qu’ils puiffent être
renfermés dans les bornes de l’oétave , nous devons
d’abord en ufer de la forte à l’égard des (ons harmoniques
donnés par les fondamentaux , pour en tirer
les moindres degrés pofllbles..... Prenons donc, pour
cet effet, le plus grand terme de ces fons harmoniques
, qui eft ij 3 approchons-en les autres autant
que nous le pourrons, en les portant à leurs octaves
les plus voifines de ce terme 1 y , nous aurons
f i ,^ut y re , mi. >»
18 1 0
Ibidem y pag. 60. « C ’eft juftement de cet ordre,
diatonique que nous venons de découvrir, & qu’on
-ne peut pouffer au-delà de quatre fons, excepté qu’on
n’ajoute un troifième fon fondamental à la quinte des
.deux qui ont fourni cet ordre 3 en quel cas on ne
feroit que répéter la même chofe une quinte plus
haut ou plus bas : c’eft juftement, disrjc , de cet
ordre diatonique que les Grecs ont formé leurs fyftêmes
diatoniques, auxquels ils ont donné le nom
de tétracordes. Vous en voyez l’origine dans la fucceflion
fondamentale par quintes, de s’ils n’y ont pas
fuivi les mêmes rapports, on peut juger à préfent de
•quel côté vient l’erreur. »
Ibidem. « Il eft étonnant que les Anciens aient
ainfi découvert l’une des premières conféquences du
principe , fans s’être apperçus de ce principe , fans
l ’avoir même fuivi dans les rapports qu’ils aflîgnent
aux intervalles de leurs tétracordes. On voit par-là
ce que peut l’oreille, mais en même temps les égare-
anens où elle peut nous jeter, quand on n’a point
•d’autre guide dans fes recherches. »?
G R E ? 3 î
Obfervati-ons. I. « Je ne dîfpute poin: aux ÀncLüS
le mérite d'avoir excellé dans la mélodie.»
« Je vous ai furpris, dit un des interlocuteurs des
Entretiens fur la ^lufique des Grecs ( V^oyage
d'Anacharfisy chap. X X V I I , t. III, pag. 96) t je
vous ai furpris dans une efpèce de jjiviffement- —- Je
ne ceffe de l’éprouver depuis que je fuis en Grèce ;
l'extrême pureté de l’air qu’on y refpire, & les Vive*
couleurs dort les objets s’y parent à mes yeux , femblent
ouvrir mon ame à de nouvelles fenfations.....
Nous prîmes de là occafion de parler de l’influence
du climat. ( Hyppoc rDe aere, cap. y y, &c. Plato,
in Tim&o , tom. I I I , p. 1 4 .) Philorime attribuait à
cette caufe l’étonnante fenfibilité des Grecs, fenfibi-
lité , difoit-il, qui eft pour eux une fource intariffable
de plaidrs & d’erreurs , & qui femble augmenter de
jour en jour. — Je çroyois au contraire qu’elle fcom-
mençoit à s’affoiblir. Si je ne me trompe, dites-moi
donc pourquoi la mufique n’opère plus les mêmes
prodiges qu’autrefois ? — C'eft quelle étoit autrefois
plus groflière 3 c’eft que les nations étoient encore
dans l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’éda-
teroit que par des cris tumultueux, une voix accompagnée
de quelque infiniment faifoit entendre une
mélodie très-(Impie, mais aflujettie à certaines règles,
vous les verriez bientôt, tranfportés de joie, exprimer
leur admiration par les plus fortes hyperboles :
voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de la Grèce avant
la guerre de Troye. Amphion animoit par fes chants
les ouvriers qui conftruifoient la fortereflè deThèbes,
comme on l’a pratiqué depuis lorfqu on a refait les
mur* de Meffènc ( Paufm., lib. 4 , cap. 17 ) : 011
publia que les muis de Thèbes s’étoient élevés aux
fons de fa lyre. Orphée tiroir de la fienne un petit
nombre de fons agréables : on dit que les tigres dé-
pofoient kur fureur à fes pieds. — Je ne remonte
pas à ces fiècles reculés 5 mais je vous cite les Lacédémoniens
divifés entr’eux, 8c tout-à-coup réunis par
les accords harmonieux de Terpandre ( Plut, de muf. ,
tom. II,p. 1146 Diod. fic.fragm. , tom. I I , p. 639.
Edit.Weffel.) 3 les Athéniens entraînés par les chants
de Solon dans l’îlede Sulamine , au mépris d’un décret
qui condamnoit l’orateur affez hardi pour propofer la
conquête de cette île ( Plut, in Solon, tom. I , p. 8 z ) j
les moeurs des .Arcadiens adoucies par la mufique
( Polyb. y lib. 4 , p. z8<>. Athen. , lib. 14, p. 6z6 ) ,
8c je ne fais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches. — Je les connois affez pour
vous affûter que le merveilleux difparoît dès qu’on les
difeute ( Mém. de l*Acad, des Belles-lettres, t. V ,
pag. 3 ). Terpandre & Solon durent leurs fuccès
plutôt à la poéfiequ’à la mufique, & peut-être encore
moins à la poéfie qu’à des circonftances particulières.
Il falloit bien que les Lacédémoniens euffent commencé
à fe laffer de leurs dividons, puifqu’ils con-
fentirent à écoüter Terpandre. Quant à la révocation
du décret obtenu par Solon , elle n’éronnera jamais
ceux qui connoiffent la légéreté des Athéniens,
U exemple des Arcadiens eft plus frappant. Ces peu