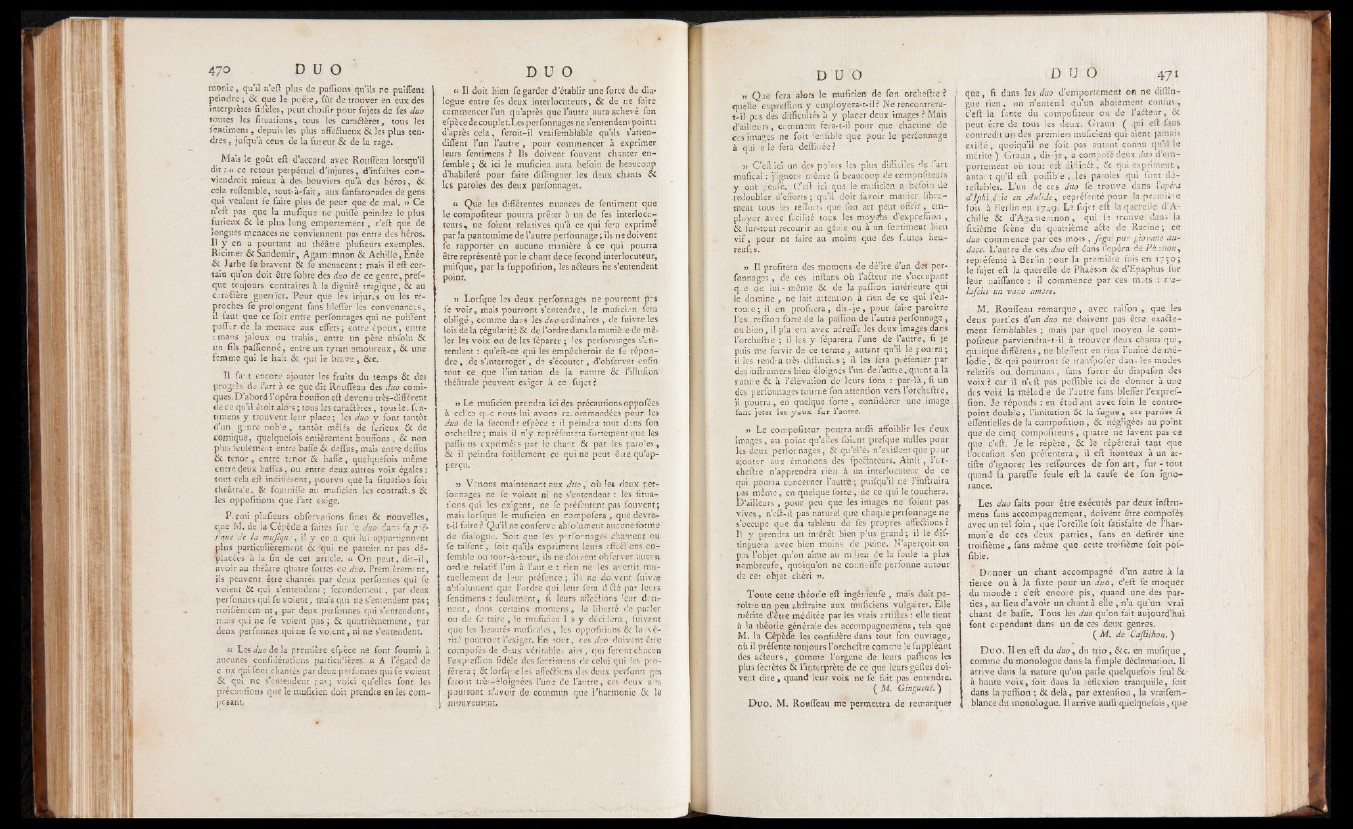
4 7 ° D U O
monîe, qu’il n’eft plus de pallions qu’ils ne puiffent '
peindre ; & que le pcëce, fûr de trouver en eux des
interprètes fidèles, peut choifir pour fujets de fes duo
toutes les fituations, tous les caractères, tous les
fentimens, depuis les plus affeélueux & les plus ten- :
dres. jufqu’à ceux de la fureur & de la rage.
Mais le goût eft d’accord avec Rouffeau lorsqu’il
dit : « ce retour perpétuel d’injures, d’infultes con-
viendroit mieux à des bouviers qu’à des héros, 6c
cela reffemble, tout-à-fait, aux fanfaronades de gens ;
qui veulent fe faire plus de peur que de mal. » Ce
n’eft pas que la mirifique ne puiffe peindre le plus
furieux & le plus long emportement, c’eft que de
longues menaces ne conviennent pas entre des héros.
11 y en a pourtant au théâtre plufieurs exemples.
Ricimer & Sandomir, Agamemnon & Achille, Enée
&. Jarbe fe bravent & fe menacent : mais il eft certain
qu’on doit être fobre des duo de ce genre, pref-
que toujours contraires à la dignité tragique, & au
caractère guerrier. Peur que' les injures ou les reproches
fe prolongent fans bleffer les convenances,
il faut que ce {bit entre perfonnages qui ne puilTent
pafltr de la menace aux effets; entre époux, entre
: mans jaloux ou trahis, entre un père abfolu &
r.n fils palkonné, entre un tyran amoureux, 8c une
femme qui le hait 6c qui iè brave , 6cc.
Il faut encore ajouter les fruits du temps & des
progrès de l’art à ce que dit Rouffeau des duo comiques.
D ’abord l’opéra bouffon eft devenu très-différent
de ce qu’il étoit akrs; tous les caraétères, tous le; fon-
timens y trouvent leur place ; les duo y font tantôt
d’un g:nre nob'e, tantôt mêlés de ferieux & de
comique, quelquefois entièrement bouffons , & non
plus feulement entre baffe 6c deffus, mais entre deffus
& ténor, entre ténor & baffe, quelquefois même
entr/i deux baffes, ou entre deux autres voix égales ;
tout cela eft ineiitèrent, pourvu que la fitpation foie
théâtrale, & fomnifle au mufiçien les cpntraft.s 6c
les oppofitipns que l’art exige.
P,fmi plufieurs obfervanons fines & nouvelles,
que M. de la Çépède a faites fur ’e duo dans fa p:ë-
l ’que de la mujîqu: , il y en a qui lui appartiennent
plus parficulièrem?ni 6c ‘qui ne paroi ne pas déplacées
à la fin de cet article. « On peut, dir-il,
avoir au théâtre qiiatj-e fortes de duo. Premièrement,
ils peuvent être chantés par deux perfor.nes qui fe.
voient 6c qui s’entendent ; fecondement, par deux
perfonnes qui fe voient, mais qui ne s’entendent pas ;
troifièmem' nt, par deux psifonnes qui s’entendant,
mais qui ne fe voient pas; 6c quatrièmement, par
deux perfonnes qui ne fe voient, ni ne s’entendent.
« Les duo de la première efpèce ne font fournis à
aucunes confidérptions particulières, y. A l’égard de
c ux qpi font chantés par deux perfonnes qui fe voient
6c qui ne s’entendent pas; voici qu’elles font les
précautions que le mufiçien doit prendre en les composant,
D U O
<( Il doit bien fe garder d’établir une forte de dialogue
entre fes deux interlocuteurs, 6c de ne faire
commencer l’un qu’après que l’autre aura achevé fon
efpèce de coupiet.Les perfonnages ne s'entendent point :
d’après cela, feroit-il vraifemblable qu’ils s'attendirent
l’un l’autre , pour commencer à exprimer
leurs fentimens ? Us doivent fouvent chanter en-
femble ; 6c ici le mufiçien aura befoin de beaucoup
d’habileté pour faire diftinguer les deux chants &
les paroles des deux perfonnages.
« Que les différentes nuances de fentiment que
le compofiteur pourra prêter à un de fês interlocuteurs*
ne foient relatives qu’à ce qui fera exprime
par !a pantomime de l’autre perfonnage ; ils ne doivent
le rapporter en aucune manière à ce qui pourra
être représenté par le chant de ce fécond interlocuteur,
puifque, par la fuppofition, les aétèurs ne s’entendent
point.
» Lorfque les deux perfonnages ne pourront pr.s
fe voir, mais pourront s’entendre, le mufiçien fera
obligé, comme dans les duo ordinaires , de fuivr.eles
lois de la régularité 6c de l’ordre dans la manière de mêler
les voix ou de les féparer ; les perfonnages s’entendent
: qu’eft-ce qui les empêcheroit de fe répondre
, de s'interroger , de s’écouter , d’obferver enfin
tout ce que l’imitation de la rature 6c rillufion
théâtrale peuvent exiger à ce fujet ?
» Le mufiçien prendra ici des précautions oppofées
à celles que nous lui avons recommandées pour les
duo de la fécond; efpèce : il peindra tout dans fon
orcheftre; mais il n’y repréfentera fortement que les
pafliens exprimées par le cha^t 6c par les paro’es,
6c il peindra foiblement ce qui ne peut êire.qu’ap-
perçu.
y> V'nor.s maintenant aux duo §| ou les deux perfonnages
"ne fe voient ni ne s’entendent : les fitua-
tons qui les exigent, ne fe préfentent pas fouvent;
mais lorfque le mufiçien en compofera , que devra-
t-il faire •? Qu’il ne conferve abfolument aucune forme
de dialogue. Soit que les perfonnages' chantent eu
fe taifent, foit qu’ils expriment leurs ?ffeéVons en-
femble ou tou r-à-tour, ils ne doivent obferver, aucun
ord e relatif l’un à l’aut.e : rien ne les avertit mutuellement
de leur préfence ; ils se doivent fuivre
abfolument que l’ordre qui leur fera d clé par leers
fentimens : feulement, fi leurs affeélions leur donnent,
dans certains momens, la liberté de parler
ou de fe taire, le mufiçien i.s y décidera, fuivant
que les beautés muficales, les oppofiiicns 6c l a t é rite
pourront l’exiger. En tout, res duo doivent être
compofé.s de deux véritable:, ai; s , qui feront chacun
l’expreftion fidèle des fentimens c!e celui qui les proférera;
& lorfque les affeéficps des deux perfonn-, ges
feront trètréloignées l’une de l’autre, ces deux a ris
.pourront n’avoir de commun que l ’harmoni.ç 8c le
mouvement.
D U O
» Q.ie fera alors le mufiçien de fon orcheftre ?
quelle exprelfion y employera-t-il? Ne rencontrera-
t-il pis des difficultés à y placer deux images ? Mais
d’ailleurs, comment fera-t-il pour que chacune dé
ces images ne foit ferfûble que pour le perfonnage
à qui e le fera deftinée ?
» C’eft ici un des points les plus difficiles de fart,
mufical : j’ignore même fi beaucoup de compofiteurs
y ont jjenfé. C’eft ici que le mufiçien a befoin de
redoubler d’efforts.; qu’il doit favoir manier librement
tous les refforts que fon art peut offrir, employer
avec facilité tous les mcydhs d’exprefiion ,
& fur-tout recourir au génie ou à un fentiment bien
v i f , pour ne faire au moins que des foutes heu-
reirfes.
» Il profitera des momens de dé'ire d’un def perfonnages
, de ces inftans où l’aéteur rie s’occupant
q | | de lui-même 8c de la paflion intérieure qui
le domine , ne fait attention à rien de ce qui l’entoure;
il en profilera, d is-je, pour faire paroître
rex.reftion forte de la paflion de l’autre perfonnage ,
ou bien, il pla.era avec adreffe les deux images dans
l’orcheftie ; il les y féparera l’une de l’autre, fi je
puis me fervir de ce terme, autant qu’il le pourra ;
il les rendra très-diftlnéks ; il les fera piéfenter par
des inftrumens bien éloignés l’un de faune,.quant à la
rature 6c à l’élévation de leurs fons : par-là, fi un
des perfonnages tourne fon attention vers l’orcheftre,
il pourra, en quelque forte, confidérer une image;
fans jeter les yeux fur l’autre.
» Le compofiteur pourra au {fi affoiblir les deux
images, au point qu’elles fuient prefque nulles pour
les deux perfor nages, & qu’eüés n’exifientque pour
ajouter aux émotions des fpeélateurs. Ain fi , l’or-
cheftre n’apprendra rien à un interlocuteur de ce
qui pourra concerner l’autre ; puifqu’il ne l’inftruira
pas même, en quelque forte , de ce qui le touchera. ;
D ’ailleurs, pour peu que les images ne foient pas
vives, n’eft-il pas naturel que chaque perfonnage ne
s’occupe que du tableau de fes propres affeélions ?
11 y prendra un intérêt bien plus grand; il le dif-
tingueia avec bien moins de peine* N’aperçoit-on
pas l’objet qu’on aime au milieu de la foule la plus
nombreufe, quoiqu’on ne connoiffe perfonne autour,
de cet objet chéri ».
Toute cette théorie eft ingénieufe , mais doit pa-
roître un peu abftraite aux muficiens vulgaire?. Elle
mérite d’être méditée par les vrais artiftes : elle tient
à la théorie générale des accompagne m e ns, tels que
M. la Cépètïe les confidère dans tout fon ouvrage,
où il prefente toujours l’orcheftre comme le fuppléant
des aétèurs, jçomme l’organe de leurs pallions les
plus fecrètes 6c l’interprète de ce que leurs geiles doivent
dire , quand ledr voix ne fe foit pas entendre.
( M. Ginguené. )
Du o. M. Rouffeau me permettra de remarquer
D U O 471
que, fi dans les duo d’emportement on ne diftîn-
gue rien, on n’entend qu’un aboiement confus,
c’eft la fonte du compofiteur ou de l’aéteur, 6c
peut-être de tous les deux. Graun ( qui eft fans
contredit un des premiers muficiens qui aient jamais
exilié, quoiqu’il ne foit pas autant connu qu’il le
mérite ) Graun , dis-je , a compofé deux duo d’emportement
où tour eft di'linéf, 6c qui expriment,
antav-t qu’il eft poffib'e , Jes paroles qui font dé-
teftables. L’un de ces duo fe trouve dans Y opéra
tïlphij.iïe en Aultde, repréfenté pour la première
fois à Berlin en 1749. Le fujet eft la querelle d’A chille
6c d’Agamemnôn, qui fe trouve dans la
fixième fcène du quatrième aétè de Racine ; ce
duo commence par ces mots , fegm pur gio v an e audace.
L’autre de ces duo eft dans l’opéra de Ph.zétony
repréfenté à Berlin pour la première fois en 1750;
le fujet eft la querelle de Phaéton ôc d’Epaphus lur
leur naiffance : il commence par ces mots : t~a-
lafcia un vano amore,
M. Rouffeau remarque, avec raifon , que les
deux parties d’un duo ne doivent pas être exaétè-
ment femblables ; mais par quel moyen le compofiteur
parviendra-t-il à trouver deux chants qui,
quoique différens, ne bleffent en rien l’ unité de mélodie,
6c qui pourront fe tranfpofer dans les modes
relatifs ou. dominans, fans for tir du diapafon des
voix ? car il n eft pas poffible ici de donner à une
des voix la mélodie de l’autre fans bleffer l’expref-
fion. Je réponds : en étudiant avec foin le contrepoint
double, l’imitation & la fugue , ces parties fi
effentielles de la compofition , 6c négligées au point
que de cinq compofiteurs, quatre ne lavent pas ce
que c’eft. Je le répète, 6c le répéterai tapt que
l’occafion s’en préfentera -, il eft honteux à un ar-
tifte d’ignorer les 1 effources de fon art, fur - tout
quand la pareffe feule eft la eaufe de fon ignorance.
Les duo faits pour être exécutés par deux inftru-
mens fans accompagnement, doivent être compofés
avec un tel foin, que l’oreille foit fatisfaite de l’har-
moffe de ces deux parties, fans en defirer une
troifième, fans même que cette troifième foit poffible.
Donner un chant accompagné d’un autre à la
tierce ou à la fixte pour un duo, c’eft fe moquer
du monde : c’eft encore pis, quand une des parties
, au lieu d’avoir un chant à elle , n’a qu’un vrai
chant de baffe. Tous les duo qu’on fait aujourd’hui
font cependant dans un de ces deux genres.
( M. de Cafiilhon. )
D u o . Il en eft du duo, du trio, 6ce. en mufiquey
comme du monologue dans la fimple déclamation. Il
arrive dans la nature qu’on parle quelquefois feul Sc-
à haute voix , foit dans la réflexion tranquille, foir
dans la paflion ; ÔC delà , par extenfion, la vraifem-
blance du monologue. Il arrive aufli quelquefois, que