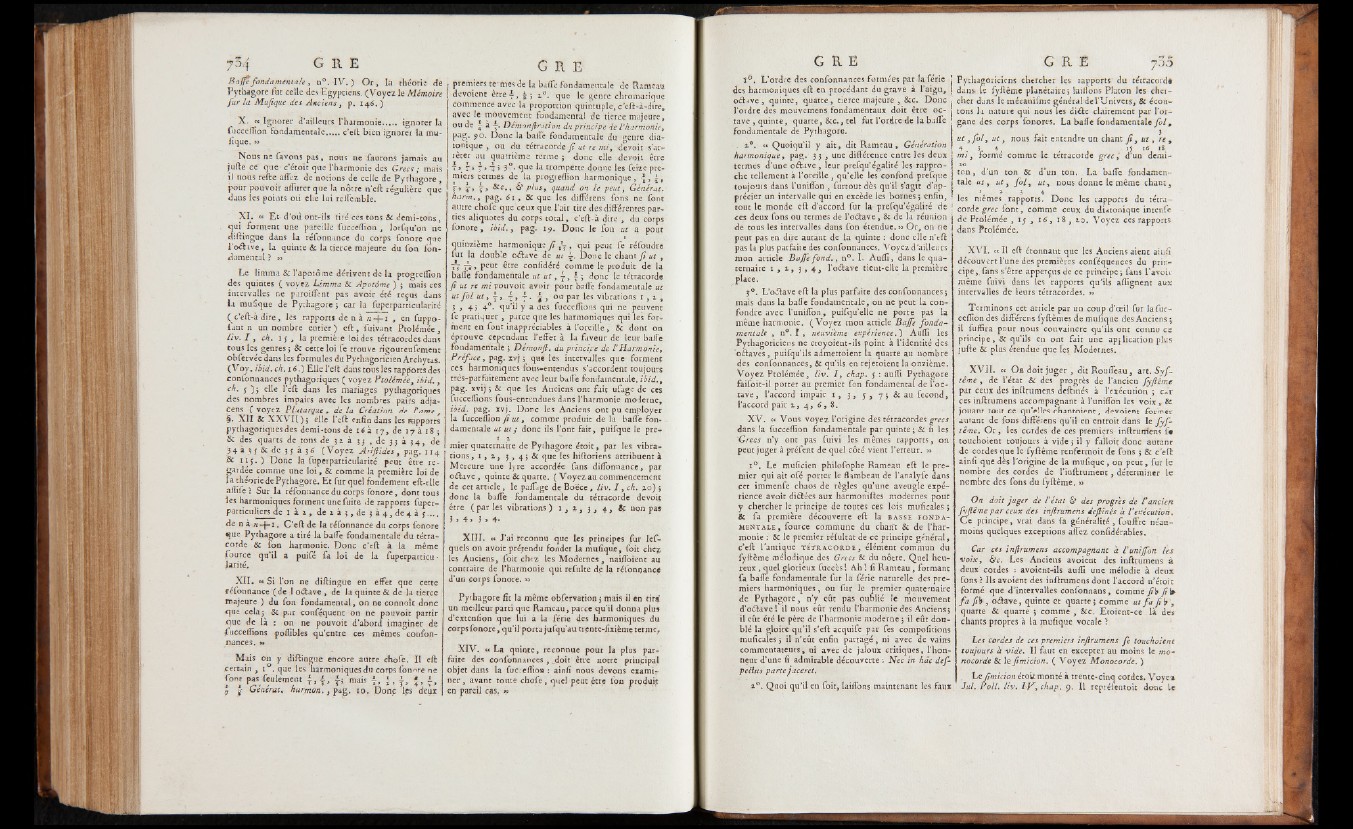
B afie fondamentale, n°. IV . ) O r , la théorie de
Pythagore fut celle des Egyptiens. (V o y e z le Mémoire
fur la Mufiqup des Anciens , p. 146, )
X . «« Ignorer d’ailleurs l’harmonie...... ignorer la
fucceflion Fondamentale».... c’eft bien ignorer la mu-
fique. »
Nous ne favons pas, nous ne (aurons jamais au
jufte ce que- c’étoit que l’harmonie des Grecs ; mais
il nous refte allez de notions de celle de Pythagore,
pour pouvoir affûter que la nôtre n'eft régulière que
dans les points où d ie lui reffémble.
X I . « Et- d ’où ont-ils tiré ces tons & demi-tons,
qui forment une pareille fucceflion , lorfqu’on ne
diftingue dans la réfonnance du corps fonore que
l ’oéfcive, la quinte & la tierce majeure du fon fondamental
? 93
Le limma 8c l’apotôme dérivent de la progreflïo.n
des quintes ( voyez Limma 8c Apotôme ) ; mais ces
intervalles ne pàroiffent pas avoir été reçus dans
la muSque de Pythagore ; car la fuperparticularité
( c’eft-à dire, les rapports de n à n-\-i , en fuppo-
lant n un nombre entier ) e f t , fuivant Ptolémée,
liv. I s ch. iy , la premiè:e loi des tétracordes dans
tous les genres ; & cette loi fc trouve rigoureufement
obfervée dans les formules du Pythagoricien Archytas.
(V o y . ibid. ch. 16.) Elle l’eft dans tous les rapports des
confonnances pythagoriques ( voyez Ptolémée, ibid. s
ch. y ) ; elle l’cft dans les mariages pythagoriques
des nombres impairs avec les nombres pairs adja-
Èens ( voyez Plutarque, de la Création de Came ,
§. X I I & X X V I I ) j elle f eft enfin dans les «apports
pythagoriques des demi-tons d e i 6 à i 7 , d e i 7 à i 8 ;
& des quarts de tons de 32 à 33 , de 33 à 3 4 , de j
3 4 * 3 5 & d e 33 à 36 (V o y e z Ariftides, pag. 1 14
& 1 1 5 . ) Donc la fuperparticularité peut être regardée
comme une lo i , & comme la première loi de
îa théorie de Pythagore. Et fur quel fondement eft-elle
aflife ? Sur la réfonnance du corps fonore, dont tous
les harmoniques forment une fuite de rapports fuper-
particuliers de 1 à z , de z à 3 , de 3 à 4 , de 4 à y...»
de n à n -\ -i. C ’eft de la réfonnance du corps fonore
que Pythagore a tiré la baffe fondamentale du tétra-
corde & fon harmonie. Donc c’eft à la même
fourcc qu’il a puifé fa lo i de la fupérparticu-
Jarité.
X I I . ce. Si l’on ne diftingue en effet que cette
ïéfonnance (de 1 oéfcave , de la quinte & de la tierce
majeure ) du fon fondamental, on ne connoît donc
que cela; & par conféquent on ne pouvoit partir
.que de là : on ne pouvoit d’abord imaginer de
iuccelfions poffibles qu’entre ces mêmes confonnances.
»
Mais on y diftingue encore autre chofe. Il eft
certain , 1 . que les harmoniques du corps fonore ne
font pas feulement £; mais * , -I, J , I ,
J J Générât. karmon. , pag. 10. Donp fes deyx
premiers t e rnes de la baffe fondamentale de Rameau
dévoient etre-f, j ; z ° . que le genre chromatique
commence avec la proportion quintuple, c ’eft-à-dire,
avec le mouvement fondamental de tierce majeure,
ou de à -*•. Démonstration du principe de l'harmonie,
pag. 90. Donc la balle fondamentale du genre dia»
ton ique , ou du tétracorde f i ut re mi, ' devoit s’arrêter
au quatrième terme ; donc elle devoir être
^r» f > "î î 3 °- q ue 1* trompette donne les feize premiers
termes de la progreffion harmonique, -*, £,
F» 4» & c ., 6* plus, quand on le peut, Générât,
harm.y pag. 6 1 , & que les différëns fons ne font
autre chofe que ceux que l’air tire des différentes par-
nés aliquotes du corps to ta l, c’eft-à dire , du corps
fon ore, ibid., pag. 19. Donc le fon ut a pour
quinzième harmonique f i , qui peut fe réfoudre
fur la double oélave de ut ■%. Donc le chant f i ut ,
77 f i y Peuc être confîdéré comme le produit de la
baffe fondamentale ut u t , L , *5 donc le tétracorde
f i ut re mi pouvoit avoir pour baffe fondamentale ut
ut fo l ut t j , t >T* J y ou par les vibrations 1 , z ,
î , 4 j 4°» qu’il y a des fucceffions qui ne peuvent
fe pratiquer , parce que les harmoniques qui les forment
en font inappréciables à l’o reille, & dont on
éprouve cependant l’effet à la faveur de leur baffe
fondamentale ; Démonft. du principe de 1‘Harmonie,
Préface, pag. xvj ; que les intervalles que forment
ces harmoniques fous-entendus s’accordent toujours
très-parfaitement avec leur baffe fondamentale, ibid.,
pag. xvij ; & que les Anciens ont fait ufage de ces
fuccefîions fous-entendues dans l’harmonie moderne,
ibid. pag. xvj. Donc les Anciens ont pu employer
la fucceflion f i ut., comme produit de la baffe fon damentale
ut ut ; donc ils l’ont fait, puifquc le pre*
mier quaternaire de Pythagore é to it , par les vibrations
, 1 , 1 , 3 , 4 ; & que les hiftoriens attribuent à
| Mercure une lyre accordée fans diflonnance, par
! otftave, quinte & quarte. ( V o y e z au commencement
de cet article, le pafEge de B o ë ce , liv. I , ch. %6) ;
donc la baffe fondamentale du tétracorde devoiç
être ( par les vibrations) 1 , 3 . , 3, 4 , 6c non paç
3 » 4 » 3 » 4 *
X I I I . « J’ai reconnu que les principes fur le s quels
on avoit prétendu fonder la mufique, foit chez
les Anciens, foit chez les Modernes, naiffoient au
contraire de l’harmonie qui réfulte d,e la réfonpancë
d’un porps fonore. *>
Pythagore fit la même obfervation; mais il en tirç
un meilleur parti que Rameau, parce qu’il donna plus
d’extenfion que lui à la férié des harmoniques du
corps fonore, qu’il porta jufqu’au tr,ente-fixième terme,
X IV . v La quinte, reconnue pour la plus parfaite
des confonnances , »doit être notre principal
objet dans la fuc:efIio» : ainfi nous devons examiner
, avant toute ch o fe , quel peut être Ion produijc
en pareil c#$, »
î ° . L ’ordre des confonnances formées pat la férié I
des harmoniques eft en procédant du grave à l’aigu, j
oéfcave, quinte, quarte, tierce majeure, &c. Donc .
l ’ordre des mouvemens fondamentaux doit être oc- j
ta v e , quinte, quarte, & c ., tel fût l’ordre de la baffe j
fondamentale de Pythagore.
. z ° . «Q u o iq u ’il y a it, dit Rameau, Génération J
harmonique, pag. 3 3 , une différence entre les deux
termes d’une o & iv e , leur prefqu’égalité les rapproche
tellement à l’oreille, qu’elle les confond prefque
toujours dans l’uniflon , furtout dès qu’il s’agit d’apprécier
un intervalle qui en excède les bornes; enfin,
tout le monde eft d’accord fur la prefqu’égalité de !
ces deux fons ou termes de l’o& a v e , & de la réunion
de tous les intervalles dans fon étendue, m O r , on ne
peut pas en dire autant de la quinte : donc elle n’tft
pas la plus parfaite des confonnances. V o y e z d’ailleurs
mon article BaJJé fond., n°. I. A u lïi, dans le quaternaire
1 , z , 3 , 4 , l’oftave tient-elle la première
place.
30. L ’o&ave eft la plus parfaite des confonnances ;
mais dans la baffe fondamentale, on ne peut la confondre
avec l’uniffon, puifqu’elle ne porte pas la
même harmonie. (V o y e z mon article Bajfe fondamentale
, n®. I , neuvième expérience. ) Aufii les
Pythagoriciens ne croyoient-ils point à l’identité des;
"oétaves, puifqu’ils admettoient la quarte au nombre
des confonnances, & qu’ils en rejetoient la onzième.
V o y e z Ptolémée, liv. ƒ , chap. 5 : auffi Pythagore
faifoit-il porter au premier fon fondamental de l’o c ta
v e , l’accord impair i j 3, y , 75 & au fécond,
l’accord pair z , 4 , 6, 8.
X V . « Vous voyez l’origine des tétracordes grecs
dans la fucceflion fondamentale par quinte; & fi les
'Grecs n’y ont pas fuivi les mêmes rapports, on
peut juger à préfent de quel côté vient l’erreur. 33
i ° . Le muficien philofophe Rameau eft le premier
qui ait ofé porter le flambeau de l’analyfe dans
cet immenfe chaos de règles qu’une aveugle expérience
avoit di&ées aux harmoniftes modernes pour
y chercher le principe de toutes ces lois muficales ;
8c fa première découverte eft la basse fo n d a m
en ta l e , fource commune du chant & de l’harmonie
: & le premier rélultat de ce principe général,
c’ eft l ’antique t é t r a c o r d e , élément commun du
fyftême mélodique des Grecs & du nôtre. Quel heureux
, quel glorieux fuccès 1 Ah 1 fi Rameau, formant
fa baffe fondamentale fur la férié naturelle des premiers
harmoniques, ou fur le premier quaternaire
de Pythagore, n’y eût pas oublié le mouvement
d’oétave ! il nous eût rendu l’harmonie des Anciens;
il eût été le père de l’harmonie moderne ; il eût doublé
la gloire qu’ il s’eft acquifc par fes compofitions
muficales ; il n’eût enfin partagé, ni avec de vains
commentateurs, ni avec de jaloux critiques, l’honneur
d’une fi admirable découverte : Nec in hâc défi
pettus parte jaceret.
z ° . Quoi qu’il en foit, laiffons maintenant les faux
Pythagoriciens chercher les rapports du tétracorde
dans le fyftême planétaire; laiflons Platon les chercher
dans le mécanifme général de l’Univers, & écoutons
lt nature qui nous les d iâ e clairement par l’organe
des corps fonores. La baffe fondamentale fo l9
ut, fo l y u t, nous fait entendre un chant f i , ut, re ,
I f f lH M B I , ij 16 18
mi, forme comme le tétracorde grec l d'un demiton
, d’un ton & d’un ton. La baffe fondamentale
ut y ut, f o l , ut, nous donne le même chant,
1 . 2 - 3 4
les mêmes rapports. Donc les rapports du tétra--
corde grec fon t, comme ceux du diatonique intenfc
de Ptolémée , i j , 1 6 , 1 8 , zo . V o y e z ces rapports
dans Ptolémée,
X V I . ce II eft étonnant que les Anciens aient ainfi
découvert l’une des premières conféquenccs du principe,,
fans s ’être apperçus de ce principe; fans l ’avoir
même fuivi dans les rapports qu’ils affignent aux
intervalles de leurs tétracordes. s>
Terminons cet article par un coup d’oeil fur la fucceflion
des différëns fyftêmes de mufique des Anciens ;
il fuffira pour nous convaincre qu’ ils ont connu es
principe, & qu’ils en ont fait une application plus
jufte & plus étendue que ies Modernes.
X V I I . « Ou doit juger , ditR ou fleau, art. Syfi
tême , de l’état & des progrès de l’ancien fyfiêrr.e
par ceux des inftrumens deftinés à l’exécution ; car
ces inftrumens accompagnant à l’uniffon les voix , &
jouant tout ce qu’elles chantoiefit, dévoient former
autant de fons différëns qu’ il en entroit dans le fy fi
tême. O r , les cordes de ces premiers inftrunîens f#
touchoient toujours à vide ; il y falloit donc autant
de cordes que le fyftême renfermoit de fons ; & c ’eft
ainfi que dès l ’origine de la mufique, on peut, fur le
nombre des cordes de rinftrument, déterminer le
nombre des fons du fyftême. »
On doit juger de l ’état 6* des progrès de l'ancien
fyfiême par ceux des inftrumens deftinés a l'exécution.
C e principe, vrai dans fa généralité, fouffre néanmoins
quelques exceptions affez çonfidérables.
Car ces in/lrumens accompagnant a l'unijfon Us
voix, &c. Les Anciens avoicnc des inftrumens à
deux cordes ; avoient-ils auffi une mélodie à deux
fons ? Ils avoient des ioftrumens dont l’accord n’ étoit
formé que d ’intervalles confonnans, comme fi\> f i k
fa fi\> , o&ave, quinte et quarte ; comme ut fa fi b ,
quarte & quarte ; comme , & c . Etoient-ce là des
chants propres à la mufique vocale ?
Les cordes de ces premiers inftrumens fe touchoient
toujours et vide. Il faut en excepter au moins le mo~
nocorde 8c le fimicion. ( V o y e z Monocorde. )
Lefimicion étok monté à trente-cinq cordes. V o y e z
Jul. Poil. liv. IVy chap. 9. I l reprélentoit donc le