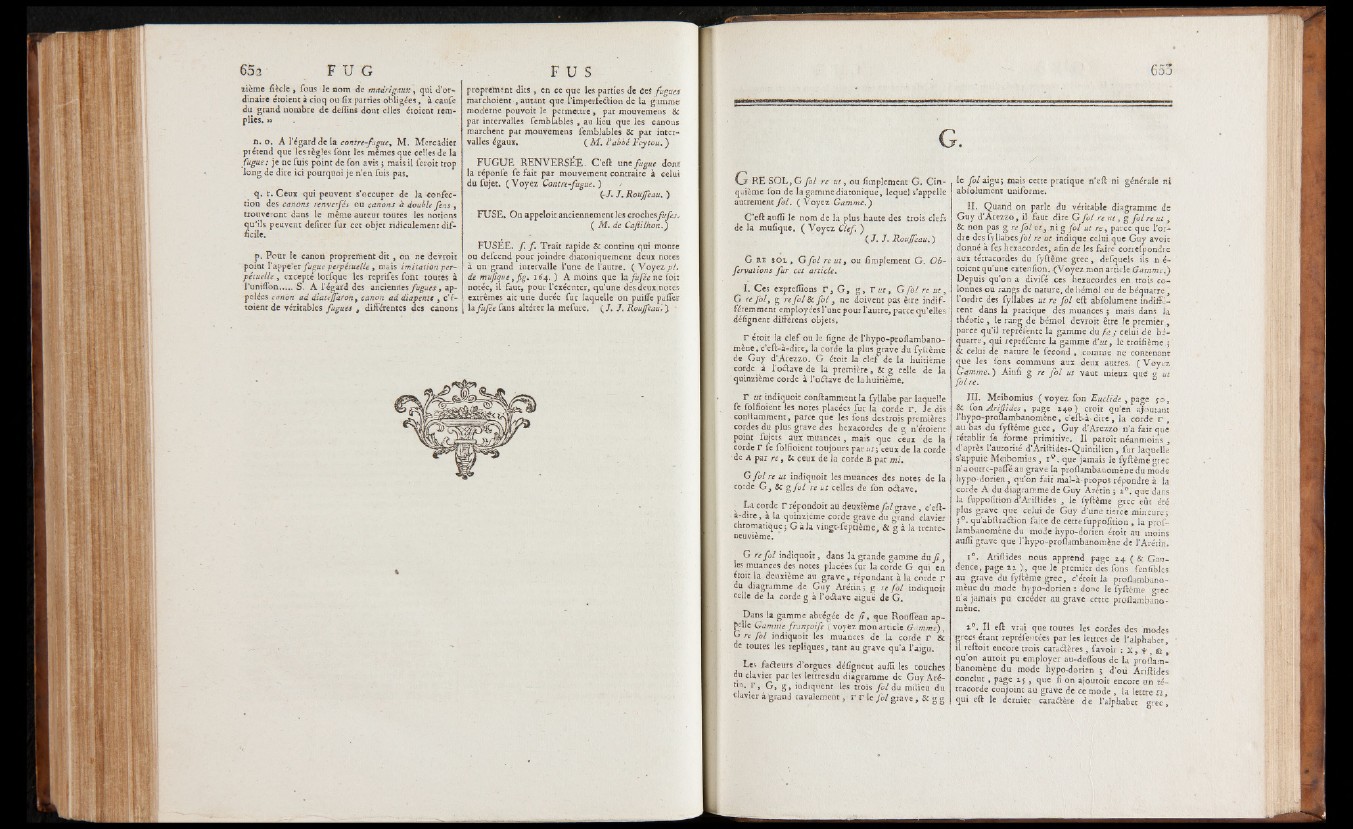
Soa F U G
zième fiècle , fous le nom de madrigaux , qui d’ordinaire
étoient a cinq ou fix parties obligées, à caufe
du grand nombre de deffins donc elles écoient remplies.
«
n. o. A l’égard de la contre-fugue, M. Mercâdier
prétend que les règles font les mêmes que celles de la
fugue : je ne fuis point de fon avis $ mais il feroit trop
long de dire ici pourquoi je n’en fuis pas.
q. r. Ceux qui peuvent s’occuper de la confection
des canons renverfés ou canons à double fens ,
trouveront dans le même auteur toutes les notions
qu’ils peuvent defirer fur cet objet ridiculement difficile.
p. Pour le canon proprement d it , on ne devroit
point l’appeler fugue perpétuelle , mais imitation perpétuelle
, excepté lorfque les reprifes font toutes à
l ’uniffon.....S. A l’égard des anciennes fugues, appelées
canon ad diatejfaron9 canon ad diapente , c 'é -
toienc de véritables fugues 9 différentes des canons
F U S
proprement dits , en ce que les parties de Ce$ fugues’
marchoient , autant que i’impeiieétion de la gamme
moderne pouvoit le permettre , par mouvemens &
par intervalles fcmblables , au lieu que les canons
marchent par mouvemens femblables & par intervalles
égaux. ( Af. l'abbé Fcytou. )
FUGUE RENVERSÉE. C ’eft une fugue dont
la réponfe fe fait par mouvement contraire à celui
du fujet. (V oyez Contre-fugue. )
(- J. J. Roujfeau. }
FUSE. On appeloit anciennement les croches fufes*
( M. de Ca f i Ikon.y
FUSEE, f f . Trait rapide & continu qui monte
ou defeend pour joindre diatoniquement deux notes
à un grand intervalle l’une de l'autre. (V o y e z pl.
de mufique, fig. 1 64. ) A moins que la fufée ne foi:
notée, il faut, pour l’exécuter, qu’une des deux,notés
extrêmes ait une durée fur laquelle on puiffe pafTer
la fufée fans altérer la mefure. (ƒ. J. Roujfeau* ) •
653
G.
C j RË SOL, G fo l re ut, ou fîmplement G. Cinquième
fon de la gamme diatonique, lequel s’appelle
autrement fo l. (V oyez Gamme.}
C ’eft auffi le nom de la plus haute des trois clefs
de la mufique. ( Voyez Clef. )
(J . J. Roujfeau.}
G Ri sol , G fo l re ut, ou Simplement G. Ob-
fervations fur cet article.
I. Ces exprefiions r , G , g , T u t , G fo l re ut,
G re fo l t g re fo l & f o l 3 ne doivent pas être indifféremment
employées l’une pour l’autre, parce qu’elles
défîgnent différens objets.
r étoit la clef ou le ligne de l'hypo-proflambano-
inène, c’eft-à-dirc, la corde la plus grave du fyftême
de Guy d’Arezzo. G étoit la c le f de la huitième
corde à l’oétave de la première » & g celle de la
quinzième corde à l’oéUve de la huitième.
r ut indiquoit conftamment la fyllabe par laquelle
fc folfioient les notes placées fur la corde r . Je dis
conftamment, parce que les fons des trois premières
cordes du plus grave des hexacordes de g n’étoient
point fujets aux muances, mais que ceux de la
corde r le folfioient toujours par ut-3 ceux de la corde
de A par re, & ceux de la corde B par mi.
G fo l re ut indiquoit les muances des notes de la
corde G 3 8c g fo l re ut celles de fon oftave.
La corde r répondoit au deuxième fo l grave, c’eft-
a-dire, à la quinzième corde grave du grand clavier
chromatique} G a la vingt-feptièrae, & g à la trente-
neuvième.
G re fo l indiquoit, dans la grande gamme du f i ,
les muances des notes placées fur la corde G qui en
étoit la deuxième au grave, répondant à la corde r
dû diagramme de Guy Arétin, g re fo l indiquoit
celle de la corde g à l’oétave aiguë de G.
Dans la gamme abrégée de f i , que Rouffeau appelle
Gamme françoife ( voyfcz mon article G ’mme)y
G re fol indiquoit les muances de la corde r &
de toutes les répliqués, tant au grave qu’à l’aigu.
Les fadeurs d’orgues défîgnent auffi les touches
du clavier par les lettres du diagramme de Guy Aré-
tin. r , G , g , indiquent les trois fo l du milieu du
clavier à grand ravalement, r r le fo l grave , & g g
le fo l aigu; mais cette pratique n’ eft ni générale ni
abfolument uniforme.
II. Quand on parle du véritable diagramme de
Guy d’A rezzo, il faut dire G fo l re ut 3 g foire ut ,
& non pas g re fo l ut 3 ni g fo l ut re3 parce que l’ordre
des fyliabcs fo l re ut indique celui que Guy avoit
donné à fe.s hexacordes, afin de les faire correfpondre
aux tétracordes du fyftême grec, defqueis ils n é-
toient qu’une extenfion. (Voyez mon article Gamme.)
Depuis qu’on a divifé ces hexacordes en trois colonnes
ou rangs de nature, de bémol ou de béquarre 3
l’ordre des fyllabes ut re fo l eft abfolument indifférent
dans la pratique des muances ; mais dans la
théorie, le rang de bémol devroit être Je premier ,
parce qu’il repréfente la gamme du fa y celui de b i-
quarre, qui repréfente la gamme d’ut3 le croifième }
& celui de nature le fécond , ^comrae ne contenant
que les fons communs aux deux autres. (V o y e z
Gamme.) Ainfi g re fo l ut vaut mieux que g ut
fo l re.
III. Mcibomius (voyez fon Euclide 3 page yo,
& foa Arifiides, page z+o ) croit qu’en ajourant
rhypo-proflambanomene, c’eft-à-dire, la corde r ,
au bas du fyftême grec, Guy d’Arezzo n’a fait que
rétablir fa forme primitive. Il paroît néanmoins ,
d’après l’autorité d’Ariftides-Quintilien , fur laquelle
s’appuie Meibomius, i v . que jamais le fyftême grec
n’aoutre-pafie au grave la proflambanomène du mode
hypo-dorien, qu’on fait mal-à-propos répondre à la
corde A du diagramme de Guy Arétin j i° . que dans
la fuppofition d’Ariftides , le fyftême grec eut été
plus grave que celui de Guy d'une tierce mineure;
30. qu’abftradion faite de cette fuppofition , la proflambanomène
du mode hypo-dorien étoit .au moins
auffi grave que fhypo-proflambanomène de l’Arérin.
i° . Ariftides nous apprend page ( & Gau-
dence, page zz m que le premier des fons fenfîbles
au grave du fyftême grec, c’étoit la proflambanomène
du mode hypo-dorien : donc le fyftême <*rec
n’a jamais pu excéder au grave cette proflambanomène.
z°. Il eft vrai que toutes les cordes des modes
grecs étant repréfentées par les lettres de l’ alphabet,
il reftoit encore trois caractères , favoir : X, s i*
qu’on auroit pu employer au-deflous de la proftam-
banomène du mode hypo-dorien j d’où Ariftides
conclut, page zy , que fi on ajoutoit encore un té-
tracorde conjoint au grave de ce mode , la lettre Cl,
qui eft le dernier caractère de l’alphabet grec*