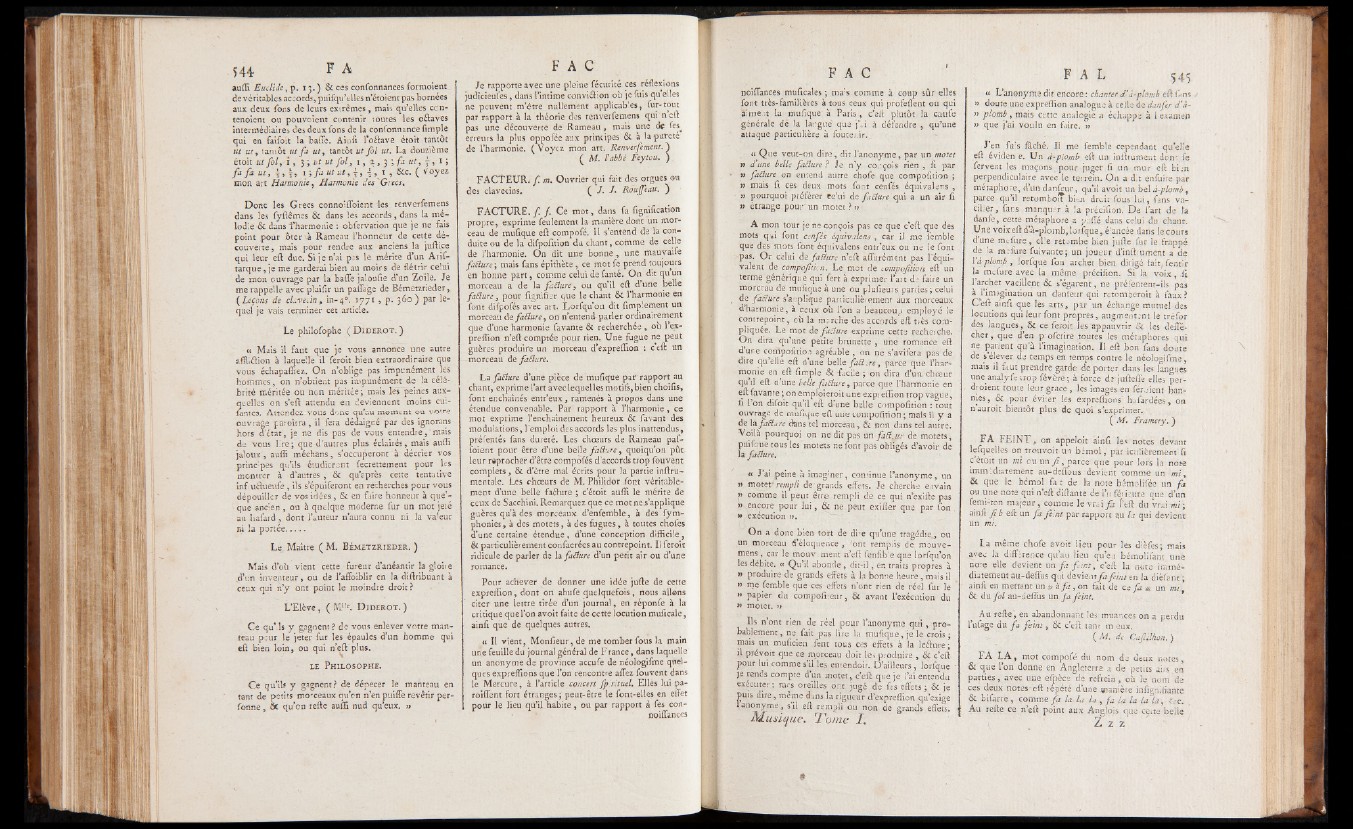
auffi Euclide, p. 1 3 .) & c e s confonnances formoient
de véritables accords, puifqu’elles n’étoient pas bornées
aux deux Tons de leurs extrêmes, mais qu’elles ccn-
tenoient ou pouvaient. contenir toutes les oftaves
intermédiaires des deux Tons de la confonnance fimple
qui en faifoit la baffe. Ainfi l'oftave étoit tantôt
ut ut y tantôt ut fa ut, tantôt ut fol ut. La douzième
étoit ut fo l, 1 , 3 ; ut ut fol , 1 , 2 , 3 ; fa ut, \ , 1 ;
fa fa ut, y , \ \ fa ut ut y \ y \ y \ y & c . ( V oyez
mon art Harmonie y Harmonie des "Grecs,
Donc les Grecs connoiffoient les renverfemens
dans les fyftêmes & dans les accords, dans la mélodie
& dans 'Fharmonie : observation que je ne fais
point pour ôter \à Rameau l’honneur de cette découverte,
mais pour rendre aux anciens la juftice
qui leur eft: due. Si je n’ai pcs le mérite d’un A r if -
ta rque , je me garderai bien au moins de flétrir celui
de mon ouvrage par la baffe jaloufie d’un Zoïle. Je
me rappelle avec plaifir un paffage de Bémetzrieder,
( Leçons de clavecin, in-40. 1 7 7 1 , p. 3 6 0 ) par lequel
je vais terminer cet article.
L e philofophe ( D id e r o t . )
« Mais il faut que je vous annonce une autre
affliéfion à laquelle il feroit bien extraordinaire que
vous échapaffiez. On n’oblige pas impunément les
hommes, on n’obtient pas impunément de la célé-
brité méritée ou non méritée; mais les peines auxquelles
on s’eft attendu en deviennent moins cu:-
fantes. Attendez-vous donc qu’au moment, ou votre
ouvrage paroîtra, il fera dédaigné par des ignorans
"hors d’é ta t, je ne dis pas de vous entend;e,'mais
de vous lire ; que d ’autres plus éclairés, mais auffi
jaloux , auffi médians, s’occuperont à décrier vos
princ'pes qu’ils étudieront fecrettement pour les
montrer à d’autres, & qu’après cette tentative
inf: uçhieufe, ils s’épuiferont en recherches pour vous
dépouiller de vos id é e s , & en faire honneur à que'-
que ancien , ou à quelque moderne fur un mot jeté
au ha fa rd, dont l’auteur n’aura connu ni la va^ur
ni la portée.. . . .
L e Maître ( M. Bém e t zr ied er . )
Mais d’ou vient cette fureur d’anéantir la gloire
.d’un inventeur, ou de l’affoiblir en la diftribuant à
ceux qui n’y ont point le moindre droit ?
L ’E lè v e , ( M1!e. D id e r o t . )
C e quMs y gagnent ? de vous enlever votre manteau
pour le jeter fur les épaules d’un homme qui
eft bien lo in , ou qui n’eft'plus.
le Ph ilo so ph e .
C e qu'ils y gagnent? de dépecer le manteau en
tant de petits morceaux qu’cn n’en puiffe revêtir per-
fon n e , Ôc qu’on refte auffi nud qu’eux. »
Je rapporte avec une pleine fécurité ces réflexions
judicieufes, dans l’intime convi&ion oh je fuis qu’elles
ne peuvent m’être nullement applicables, fur-tout
par rapport à la théorie des renverfemens qui n eft
pas une découverte de Rameau , mais une de fes^
erreurs la plus oppofée aux principes & à la purete
de l’harmonie. (V o y e z mon art. Renverfement. )
( AJ. P abbé Feytou. )
F A C T E U R .' f m. Ouvrier qui fait des orgues ou
des clavecins. ( J. J. Roujfeau. )
F A C T U R E , ƒ ƒ. C e m o t , dans fa ftgniflcation
propre, exprime feulement la manière dont un morceau
d e mufique eft compofé. il s’entend de la conduite
ou de la difpofition du chant, comme de celle
de l’harmonie. On dit une b on n e , une mauvaife
faHure', mais fans épithète, ce mot fe prend toujours
en bonne p a rt, comme celui de fan té. O n dit quun
morceau a de la faflure, ou qu’ il eft d’une belle
faElure, pour lignifier que le chant & l’harmonie en
font difpofés avec art. Lorfqu ’on dit fimplement un
morceau de faâlure, on n’entend-parler ordinairement
que d’une harmonie favante & recherchée, oh l’ex-
preffion n’eft comptée pour rien. Une fugue ne peut
guères produire un morceau d’expreffion : c’eft un
morceau de faâlure.
La faâlure d’une pièce de mufique p a r rapport au
chant, exprime l’art avec lequel les motifs, bien choifis,
font enchaînés entr’e u x , ramenés à propos dans une
étendue convenable. Par rapport à l’harmonie, ce
mot exprime l’enchaînement heureux & favant des
modulations, l’emploi désaccords les plus inattendus,
préfentés fans dureté. Les choeurs de Rameau paf-
foient pour être d’une belle facture, quoiqu’on pût
leur reprocher d’être compôfés d’accords trop fouvent
complets, & d’être mal écrits pour la partie inftru-
mentale. Les choeurs de M. Philidor font véritablement
d’une belle faélure ; c’étoit auffi le mérite de
ceux de Sacchini. Remarquez que ce mot ne^s’applique
guères qu’à des morceaux d’enfemble, à des fym -
phonies, à des motets, à des fugues, à toutes chofes
d’une certaine étendue, d’une conception difficile,
& particulièrement confacrées au contrepoint. Il feroit
ridicule de parler de la facture d’un petit air ou d’une
romance.
Pour achever de donner une idée jufte de cette
expreffion, dont on abufe quelquefois, nous allons
citer une lettre tirée d’un journal, en réponfe à la
critique que l’on avoit faite de cette locution m uficale,
ainfi que de quelques autres.
u II vient, Monfieur, de me tomber fous la main
une feuille du journal général de F rance, dans laquelle
un anonyme de province aceufe de néologifme quelques
expreffions que l’on rencontre affez fouvent dans
le Mercure, à l’article concert fp. rituel. Elles lui pa-
roiffent fort étranges; peut-être le font-elles en effet
pour le lieu qu’il habite, ou par rapport à fes connoiffances
B
noiffances muficales ; ma's comme à coup sûr elles
font très-familières à tou$ ceux qui profeflènt ou qui
aiment la mufique à Paris, c’eft plutôt la caufe
générale dé la largue" que j’c.i .à défendre , qu’une
attaque particulière à fouter.ir.
« Q u e veut-on dire, dit l'anonyme, par un motet
» d'une belle facture ? Je n’y conçois rien , fi par
» faâlure on entend autre chofe que compofition ;
m mais fi ces deux mots font cenfés équivalens ,
» pourquoi préférer Ce1 ni de faâlure qui a un air fi
n étrange pour' un motet ? »
A mon tour je ne conçois pas ce que c’eft que des
mots- q *i font cenfés équivalens , car il me femble
que des mots font équivalens entr’eux ou ne le font
pas. O r celui de f attitré n’eft affurément pas l’équivalent
de compofitkn. Le mot de compofitiofi eft un
terme générique qui fert à exprimer l’ait d:- faire un
morceau de mufique à une ou plufieui s parties ; celui
de faâlure s’applique particulièrement- àux morceaux
d harmonie, à ceux oh l’on a beaucoup employé le
contrepoint, oh la m?rche des accords eft très compliquée.
Le mot de faâlure exprime cette recheiçhe.
O n dira qu’une petite bmnette , une romance eft
d’ure compofition agréable , on ne s’avifera pas de
dire qu’elle eft d’une belle faâlure, parce que l’harmonie
en^eft fimple & -facile ; on dira d’un, choeur
qu’il eft d’une belle faâlure, parce que l'harmonie en
eft favante ; on emploieroit une expreffion trop vague,
li 1 on difoit qu’il eft d’une belle compofition : tout
ouvrage de mufique eft une compofition ; mais il y a
de la faâlure dans tel morceau, & non dans tel autre.
V oilà pourquoi on ne dit pas un fadeur de motets,
puifque tous les motets ne font pas obligés d’avoir de
la facture.
« J’ai peine à imaginer, continue l’anonyme, un
» motet" rempli de grands effets. Je cherche envain
p comme il peut être rempli de ce qui n’exifte pas
» encore pour lu i , & ne peut exifler que par fon .
» exécution ».
O n a donc bien tort de dire qu’une tragédie., ou
un morceau d’éloquence -ont rempiis de mouye-
mens, car le mouv ment n’eft fenfib.'e que lorfqu’on
les débite. « Q u ’il abonde , dit-il, en traits propres à
» produire de grands effets à la bonne heure, mais il
n me femble que ces effets n’ont rien de réel fur le ’
» papier du compofiteur, & avant l’exécution du
» motet. »
Ils n’ont rien de réel pour l’anonyme qui » probablement
, ne fait pas lire la mufique, je le crois ;
mais un muficien fent tous ces effets à la leéhire;
il prévoit que ce morceau doit les produire , & c’eft '
pour lui comme s’il les emendoir. D’ailleurs, lorfque -
je rends compte d’un motet, c’eft que je l’ai entendu
exeeuter : mes oreilles ont jugé de fes effets ; & je
puis dire, meme dans la rigueur d’expreffion qu’exige
1 anonyme, s’il eft rempli ou non de grands effets. !
Musique. Tome I.
« L ’anonyme dit encore : chanter d'à-plomb eft fins
» doute une expreffion analogue à celle de danfe/ d'à-
” plomb, mais cette analogie a échappé à 1 examefi
» que j’ai voulu en faire. »
J’en fins fâché. Il me femble cependant qu'elle
eft éviden e. Un à-plomb eft un inftrument dont fe
fervent Les maçons pour juger fi un mur eft bi:n
perpendiculaire avec le terrein. On a dit enfuite par
métaphore, d’un danfeur, qu’il avoit un bel à-plomb,
parce qu’il retomboit bien dreirfous lu i, fans vac
ille r , fans manqusr à la précifion. D e l’art de la
danfe, cette métaphore a pafTé dans celui du chant.
Une voix eft d-à-plomb, lorfque, é:ancée dans le cours
d’une mefure, elle retombe bien jufte fur le frappé
de la mefure fuivante; un joueur d’infttument a de
l’à-plomb, lorfque fon archet bien dirigé fait^fentir
la mefure avec la même précifion. Si la v o ix , .fi
1 archet vacillent &. s'égarent, ne préfentenr-ils pas
a i’imaginàtion uni danlèur qui retomberait à faux ?
C ’eft ainfi que les arts, par un échange mutuel des
locutions qui leur font propres, augmentent le tréfpr
des langues, & ce feroit les appauvrir & les deffé-
ch e r , que d’en p oferire .toutes les métaphores qui
ne parient qu’à l’imagination. Il eft bon fans doute
de s’élever de temps en temps contre le néologifme,
mais il faut prendre garde de porter dans les langues
une analyfe trop févère ; à force de jufteffe elles per-
droient toute leur grâce , les images en feraient ban-
n>es> Pour éviter les expreffions' ha fardées:, on
n auroit bientôt plus de quoi s’exprimer.
( M. Fr amer y. )
F A F E IN T , on appelait ainfi les notes devant
lesquelles on trouvoit un bémol , par.iculièrement fi
c’étoit un mi eu u n / , parce que pour lors la note
immédiatement au-deffous devient comme un mi y
& que le bémol fa t de la note bémolifée un fa
ou une note qui n’eft diftante de l’i; férieure que d’un
femi-ton majeur, comme le v rai fa f’eft du vrai mi;
ainfi Jîb eft un fa feint par rapport ^u la qui devient
un mi.
La même chofe avoit lieu pour les dièfes; mais
avec la différence qu’au lieu qu’en bémoîifant une
note elle devient un fa f e i n t , c’eft la note immédiatement
au-deffus qui devient fa feint en la dièfant ;
ainfi en mettant un Ȉ fa , on fait de ce fa # un mi
& du fol au-cieffus un ja feint.
Au-refte , en abandonnant les muances on a perdu
L’ufage du fa fe in t, & c’eft tant m eux.
( AJ. de Çafiilhort. )
F A L A , mot compofé du nom de deux notes,
& que l’on donne en Angleterre a de petits airs en
pa rties, avec une efpèce de refreih, oh le nom de
ces deux notes eft répété d’une manière infignifiante
& bifarre , comme fa la. la la , fa la la la la, & c.
A u refte ce n’eft point aux Anglois que cette belle
Z z z