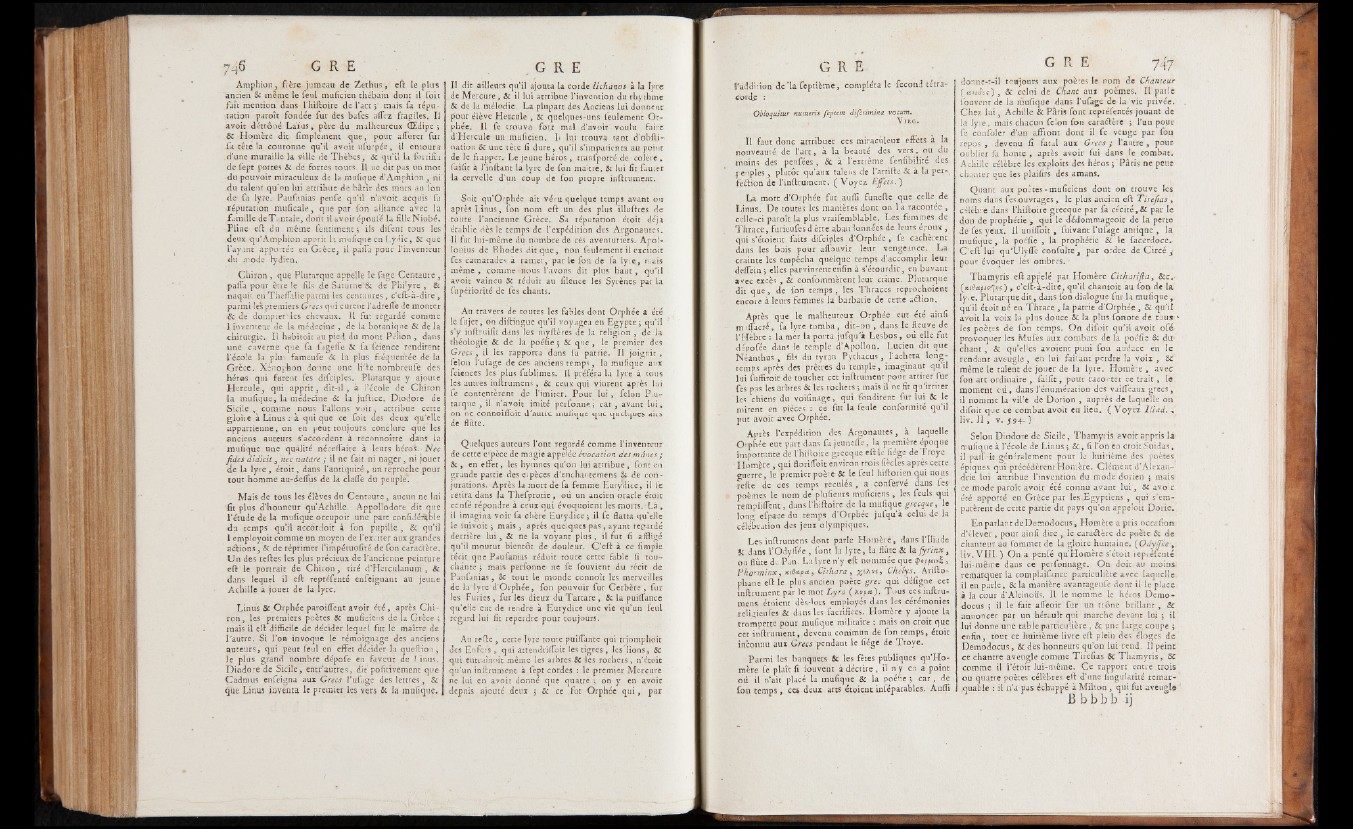
Amphion, frère jumeau de Z e th u s , eft le plus
ancien & même le feul muficien thébain dont il (oit
fait mention dans l'hiftoire de l’ art mais fa réputation
paroît fondée fur des bafes allez fragiles. Il
avoit détrôné L a ïu s , père du malheureux (Edipe ;
& Homère dit Amplement q ue , pour aflurer fur
fa tête la couronne qu’ il avoir ufurpée, il entoura
d’une muraille la ville de Thèbe s, & qu’ il la fortifia
de fept portes & de fortes tours. Il ne dit pas un mot
du pouvoir miraculeux de la mufique d’Amphion , ni
du talent qu'on lui attribue de bâtir des murs au fon
de fa lyre. Paufanias penfe qu’ il n’avoit. acquis fa
réputation muficale , que par fon alliance avec la
famille de Tantale, dont il avoit époufé la fille Niobé.
Pline eft du même fentiment 5 ils difent tous les
deux qu’Amphion apprit l i ma fi que en Lydie, & que
l’ayant apportés en G tè c e , il palfa pour l’inventeur
du .mode lydien.
Chiron , que Plutarque appelle le fage Centaure,
palfa pour être le fils de Saturnev& de Philyre , &
naquit en ThefTalie parmi les centaures , c’eft-à-dïre,
parmi les premiers Grecs qui eurent l’adrelle de monter
& de domptefTes chevaux. Il fut regardé comme
1 inventeur de la médecine , de la botanique 8c de la
chirurgie. Ii habitoic au pied du mont Pélion , dans
une caverne que fa fage fie & fafc ien ce rendirent
l ’école la plus fameufe èc la plus fréquentée de la
Grèce. Xénopbon donne une lifte nombreufe des
héros qui furent fes difciples. Plutarque y ajoute
He rcu le , qui apprit, d it- il, à l’école de Chiron
la mufique, la médecine & la juftice. Diodore de
S ic ile , comme nous l’allons v o i r , attribue cette
gloire à Linus : à qui que ce foit des deux qu’elle
appartienne, on en peut toujours conclure que les
anciens auteurs s’accordent à reconnoîrre dans la
mufique une qualité nécefiaire à leurs héros. Nec
fides didicit, nec nature ; il ne fait ni nager, ni jouer
de la ly r e , é to it, dans l’antiquité , un reproche pour
tout homme au-deflus de la clafle du peuple.
Mais de tous les élèves du Centaure, aucun ne lui
fie plus d’honneur qu’ Achille. Appollodore dit que
l ’étude de la mufique occupoit une part confidé^lble
-du temps qu’il accôrdoit à fon pupille , 8c qu’il
1 employoit comme un moyen de l’exciter aux grandes
actions , & de réprimer l’impétuolité de fon caractère.
U n des relies les plus précieux de l’ancienne peinture
eft le portrait de C h iro n , tiré d’Herculanum , &
dans lequel il eft repréfenté enfeignant au jeune
Achille à jouer de la.lyre.
Linus & Orphée paroiflent avoir é té , après C h i ron,.
les premiers poètes & mufieiens de la Grèce ;
mais il eft difficile de décider lequel fut le maître de
l ’autre. Si l’on invoque le témoignage des anciens ,
auteurs, qui peut feul en effet décider la queftion,
le plus grand nombre dépofe en faveur de Linus.
Diodore de Sic ile, entr’autres, dit pofitivement que
Çadmus enfeigna aux Grecs l’ufage des lettres, &
que Linus inventa le premier les vers & la mufique.
Il dit ailleurs qu’il ajouta la corde lichanos à la lÿrc
de Mercure, & il lui attribue l’invention du rhythme
& de la mélodie. La plupart des Anciens lui donnent:
jfour élève Hercule , 8c quelques-uns feulement Orphée.
Il fe trouva for^ mal d’avoir voulu faire
d'Hercule un muficien. L lui trouva tant d’obfti-.
nation & une tête fi dure, qu’il s’impatienta au point
de le frapper. Le jeune héros , tranfporté de colère ,
faifîc à l’inftant la lyre de fon maître, 8c lui fit fauter
la cervelle d'un coup de fon propre infiniment.
Soit qu’Orphée ait vécu quelque temps avant ou
après Linus , fon nom eft un des plus illuftres de
toute l’ancienne Grèce. Sa réputation étoit déjà
établie dès le temps de l’ expédition des Argonautes.
-Il fut lui-même du nombre de cés aventuriers. Apollonius
de Rhodes dit q ue , non feulement il excitoit
fes camarades à ramer, par le fon de fa ly re , mais
même , comme nous l’avons dit plus h a u t , qu’ il
avoit vaincu & réduit au fîlence les Syrènes par la
fupériorité de fes chants.
Au travers de toutes les fables dont Orphée a été
le fu je t , on diftingue qu’il voyagea en Egypte $ qu’il
s’y inftruifîc dans les îmyftères de la religion , de la
théologie 8c de la poéfie ; 8c que , le premier des
Grecs , il les rapporta dans fa patrie. Il joignic ,
félon l’ufage de ces anciens temps, la mufique aux
fciences les plus fublimes. Il préféra la lyre à tous
les autres inftrumens, 8c ceux qui vinrent après lui
fe contentèrent de l’imiter. Pour lui , félon P ur
tarque , il n’avoir imité perfonne j car , avant lu i,
on ne corinoifloit d’autre mufique que quelques airs
de flûte.
Quelques auteurs l’ont regardé comme l’inventeur
de cette efpèce de magie appelée évocation des mânes ;
8c , en effet, les hymnes qu’on lui attribue , font en
grande partie des e;pèces d’enchantemens & de conjurations.
Après la mort de fa femme Eurynice, il fe
retira dans la Thefprotie, où un ancien oracle étoic
cenfé répondre à ceux qui évoquoient les morts. Là ,
il imagina voir fa chère Eurydice ; il fe flatta qu’elle
le fuivoit ; mais , après quelques pas, ayant regardé
derrière lu i , & ne la voyant plus , il fut fi affligé
qu’il mourut bientôt de douleur. O eft à ce fimpie
récit que Paufanias réduit toute cette fable fi touchante
5 mais perfonne ne fe fouvient du récit de
Paufanias, 8c tout le monde connoît les merveilles
de la’ lyre d’Orphée, fon pouvoir fur Cerb ère, fur
les Furies , fur les dieux du Tartare,. & la puifiance
qu’elle eut de rendre à Eurydice une vie qu’un feul
regard lui fit reperdre pour toujours.
Au refte , cette lyre toute puifTantc qui triomphoit
des Enfers , qui attendriffoit les tigres , les lions, &
qui entraînent même les arbres 6c les rochers, n’étoic
qu’un inftrument à fept cordes : le premier Mercure
ne lui en avoir donné que quatre j on y en avoit
depuis ajouté deux ; ce fut Orphée q ui , par
l ’addition d e ’la feptième, compléta le fécond tétra*
cordp :
Obloquitur numeris feptem dijenmina vocum.
V irg.
Il faut donc attribuer ces miraculeux effets à la
nouveauté de l’a r t , à la beauté des v er s, ou du
moins ■ des penfées , & à l’extrême fenfibiliré des
peuples , plutôt qu’aux ta!eus de l’arrifle & à la per-,
fedion de l’inftrumenr. ( V o y e z Effets. )
La mort d’Orphée fut .auffi funefte que celle de
Linus. De toutes les manières dont on l'a racontée ,
celle-ci paroît la plus vraifemblablc. Les femmes de
T h ra c e , furieufes d être abandonnées de leurs époux ,
qui s’éroient faits difciples d’Orphée , fe cachèrent
dans les bois pour aflbuvir leur vengeance. La
crainte les empêcha quelque temps d’accomplir leur
deflein j elles parvinrent enfin à s’étourdir, en buvant
avec excès , 8c confommèrent leur crime. Plutarque
dit que, de fon temps , les Thraces reprochoient
encore à leurs femmes la barbarie de cette adion.
Après que le malheureux Orphée eut été ainfi
imffacré, fa lyre tomba, dit-on , dans le fleuve de
l ’Hèbrc : la mer la porta, jufqu’à Lesbos , où elle fut
dépofée dans le temple d’Apollon. Lucien dit que
Néanthus , fils du tyran Pythacus , l’acheta longtemps
après des prêtres du temple, imaginant qu’il
lui fuffiroit de toucher cet inftrument pour- attirer fur
fes pas les arbres & les iochers ; mais il ne fit qu’irriter
les chiens du voifinage, qui fondirent fur lui & le
mirent en pièces : ce fut la feule conformité qu’il
put avoir avec Orphée.
Après l’expédition des Argonautes, à laquelle
Orphée eut part dans fa jeunefîe, la première époque
importante de l'hiftoire grecque eft le fiége deTroye
Homère , qui florifïoit environ rrois fiècles après cette
guerre, le premier poè>e 8c le feul hiftorien qui nous
-refte de ces temps reculés ., a confervé dans fes
poèmes le nom de plufieurs mufieiens, les feuls qui
rempliffent, dans l’hiftoire de la mufique grecque, le
long efpace du temps d’Orphée jufqu’à celui de la
célébration des jeux olympiques.
Les inftrumens dont parle Homère, dans l’Iliade
8c dans l’Odyffée , font la ly re , la flûte & la fyrinx,
ou flûte de Pan. La lyre n’y eft nommée que (po/ymi,
Phorminx, xtèapci, Ciihara, Chelys. Ariftophane
eft le plus ancien poète grec qui défigne cet
infiniment par le mot Lyra ( àu ,<>«). Tous ces inftrumens
étoient dès-lors employés dans les cérémonies
religieufes & dans les facrifices. Homère y ajoute la
trompette pour mufique militaire ; mais on croit que
cet inftrument, devenu commun de fon temps, étoit
inconnu aux Grecs pendant le fiége de Troye.
Parmi les banquets & les fêtes publiques qu’Ho-
mère fe plaît fi Couvent à décrire , il n'y en a point
où il n’ait placé la mufique & la poéfie ; c a r , de
fon temps, ces deux arts étoient inféparables. Auffi
donne-t-il toujours aux poètes le nom de Chanteur
( aniï'cs') , & celui de Chant aux poèmes. Il parlé
Couvent de la mufique dans l’ufage de la vie privée.
Che z lu i , Achille & Paris font repréfentés jouant de
la ly î e , mais chacun félon fon caractère j l’un pour
fe confoler d’un affront dont il fe venge par fon
repos , devenu fi fatal aux Grecs ; l’au tre, pour
oublier fa honte , après avoir fui dans le combat.
Achille célèbre les exploits des héros j Paris ne peut
chanter que les plaifirs des amans.
Quant aux poètes-mufieiens dont on trouve les
noms dans fes ouvrages , le plus ancien eft Tirefeas,
célèbre dans l’hiftoire grecque par fa cé c ité ,& par le
don de prophétie , qui le dédommageoit de la perte
de fes yeux. Il uniffoit, fuivant l’ufage antique , la
mufique, la poéfie , la prophétie & le facerdoce.
C ’eft lui qu’Ulyffe confulte, par ordre de Circé J
pour évoquer les ombres. •
Thamyris eft appelé par Homère Cithariftay 8cc.
, c’eft-à-dire, qu’il chantoit au fou de la
ly.e. Plutarque d it, dans fon dialogue fur la mufique,
qu’il étoit né en T h ra c e , la patrie d’Orphée , & qu'il
avoit la voix la plus douce 8c la plus fonore de tous »
les poètes de fon temps. On difoit qu’ il avoit ofé.
provoquer les Mufes aux combats de la poéfie & du
ch an t, & qu’elles avoient puni fon audace en le
rendant aveugle , en lui failant perdre la voix , &
même le talent de jouer de la lyre. Homère , avec
fon art ordinaire , fa ifit, pour racorter ce t ra it , le
moment c.ù, dans l’énumération des vaiffeaux grecs,
il nomme la vil’e de Dorion , auprès de laquelle on
difoit que ce combat avoir eu lieu. ( V o y e z lliad. ,
liv. I I , v. 594. )
Selon Diodore de Sicile, Thamyris avoit appris la
mufique à l’école de Linus ; & , fi l’on en croit Suidas,
il paffùt généralement pour le huitième des poètes
épiques qui précédèrent Homère. Clément d ’Alexandrie
lui attribue l’invention du mode dorien j mais
ce mode paroît avoir été connu avant lu i, & avoir
été apporté en Grèce par lès.Egyptiens , qui s’emparèrent
de cette partie du pays qu’on appeloit D o rie.
En parlant de Demodocus, Homère a pris occafion
d’élever , pour ainfi dire , le caractère de poète & de
chanteur au Commet de la gloire humaine. (Odyffée ,
liv. V I I I .) On a penfé qu’Homère s’étoit lepréfenté
lui-même dans ce perTonnage. On doit; au moins
remarquer la complaifance particulière avec laquelle,
il en parle, & la manière avantageufe dont il le place à la cour d’Àlcinoüs. Il le nomme le héros Demodocus
j il le fait afleoir fur un trône brillant , &
annoncer par un hérault qui marche devant lui j il
lui donne une table particulière . 8c une largek coupe ;
enfin, tout ce huitième livre eft plein des éloges de
Demodocus, & des honneurs qu’on lui rend. Il peint
ce chantre aveugle comme Tirèfias 6c T ham yris, 8c
comme il l’étoit lui-même. C e rapport entre trois
ou quatre poètes célèbres eft d’une Angularité remar-
.quable : il n’a pas échappé à Milton , qui fut aveugl©