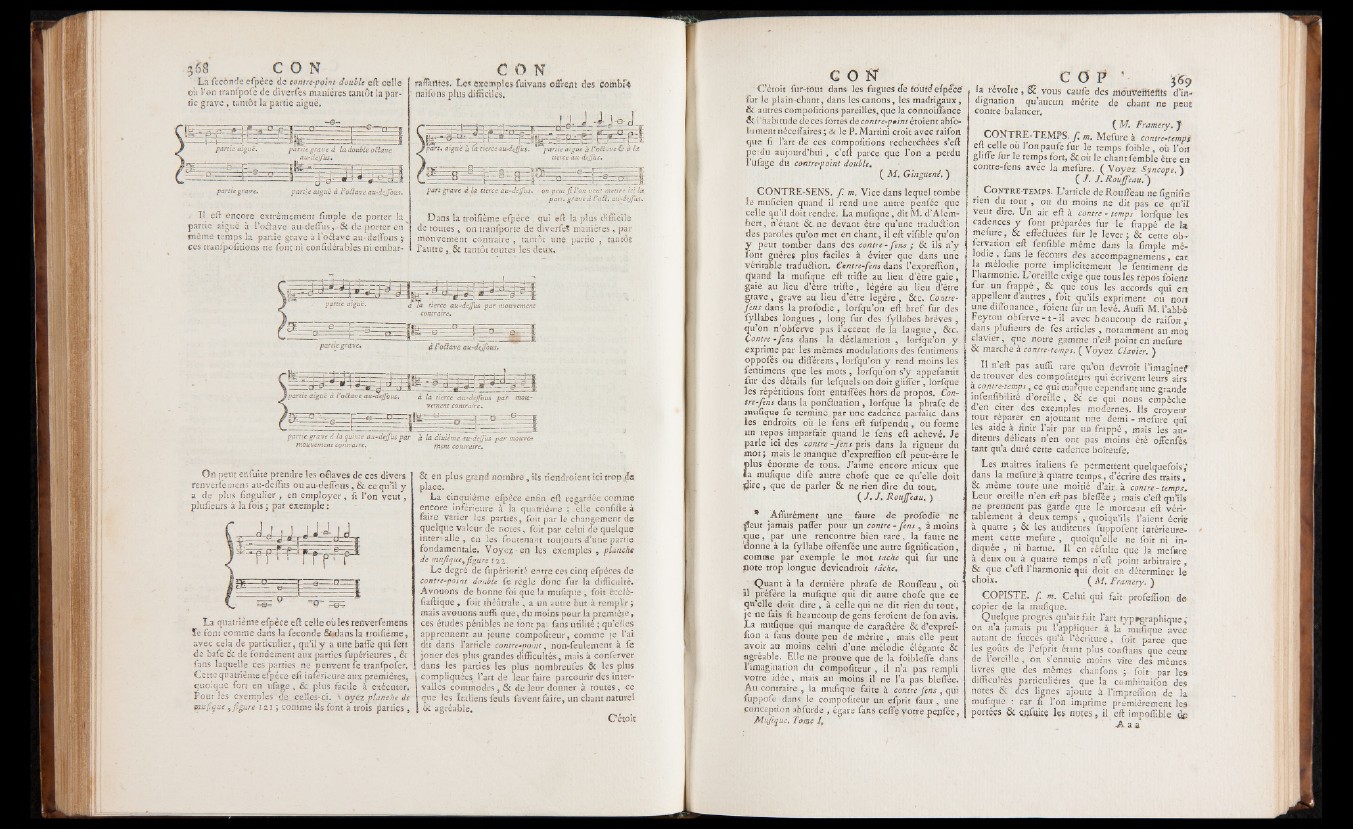
ggg C O N
La fecônde efpèce de contre-point double eft celle
où l-’on tranfpofe de dlverfes manières tantôt la partie
grave, tantôt la partie aiguë.
partie aiguë à Voftave au-dejfous.
€ ON
raffatltes, tes exemples fuivans offrent des comtf-e
naifons plus difficiles.
part, aiguë à (a tierce au-dcjjus,
— ■ a— ■— -------
-J- JjLcL
;-EdE
partie aigue à l’oddve & à la
tierce au- dejfus.
\ T%— Z Z = ë= r;rz= = -^Z irT
part grave à la tierce au-dejfus. ■ on peut fi l'on veut mettre ici la
• part, grave ài’ça, au-dcjfus.-
II eft encore extrêmement fimple de porter la
partie aiguë à l’oôave au-deffus,& deporteren
même temps la partie grave à i’oâave au-'deffous j-
ces tranipofitions ne font ni confidérables ni embar-
Dans la troifième efpèce , qui eft la plus difficile
de tomes , on tranfporte de diverfeS manières , par
mouvement contraire , tantôt une partie , tantôt
l’autre 8c tantôt toutes les deux.
partie grave. £ Potlave au-dejfous.
} parue aiguë à l‘o£lave au-defous. à la tierce au-dejfous par mow- ■
• \ ventent contraire.
"5E
m
partie grave a la quinte au-dejfus par à la- dixième au-dejfus par mouver
mouvement contraire, rnçm contraire.
On peut enfuite prendre les oélaves de ces divers
renverte mens au-deffus ou au-deffous , & ce qu’il y
a de plus fingulier , en employer, fi l’on v e u t ,
plufieurs à la fois ; par exemple :
La quatrième efpèce eft celle où les renverfemens
& en plus grand nombre, ils tiendroient ici trop.de
1 place.
Te font comme dans la fécondé S&dans la troifième,
avec cela de particulier, qu’il y a une baffe qui fert
de bafe & de fondement aux parties fupérieures, &
fans laquelle ces parties ne peuvent le tranfpofer, -
Cette quatrième efpèce eft inferieure aux premières,
quoique fort en ufage, & plus facile à exécuter.
Pour les exemples'de celles-ci. V oyez planche de
mufique, figure 121 ; comme ils font à trois parties ,
La cinquième efpèce enfin eft regardée comme
encore inférieure à la quatrième ; .elle confifte à
faire varier les parties, fuit par le changement de
quelque valeur de notes, foit par celui de quelque
intervalle , en les foutenant toujours d’une partie
fondamentale. Voy e z -en les exemples , planche
de mufique, figure 122.
Le degré de fupériorîte entre ces cinq efpèces de
contre-point double fe règle donc fur la difficulté.
Avouons de bonne foi que la mufique , foit èccié-
fiaftique , foit théâtrale , a un autre but à remplir ;
mais avouons auffi que, du moins pour la première,
ces études pénibles ne font pa. fans utilité ; qu’elles
apprennent au jeune compofiteur, comme je l’ai
dit dans l’arricle contre-point, non-feulement à fe
jouer des plus grandes difficultés, mais à conferver
dans les parties les plus nombreufes & les plus
(compliquées, l’art de leur faire parcourir des intervalles
commodes, 8c de leur donner à toutes , ce
que les Italiens fculs favent faire, un chant naturel
8c agréable.
Cétoit
C O f f
' C ’étoit fur-tout dans les fugues de fou té efpèce
fur le plain-chant, dans les canons, les madrigaux,
& autres comportions pareilles, que la connoinance
êc l ’habitude de ces fortes de contre-point étoientabfo-
1 umentiiéceffaires; & le P.Martini croit avec raifon
que fi l’art de ces comportions recherchées s’eft
perdu aujourd’h u i, c’en parce que l’on a perdu
l’yfage du contre-point double.
( M. Ginguenè. )
CONTRE-SENS, f i m. Vice dans lequel tombe
le murcien quand il rend une autre penfée que
celle qu’il doit rendre. La mufiqne, dit M. d’Alem-
foert, n’étant 8c ne devant être qu’une traduélion.
des paroles qu’on met en chant, il eft vifible qu’on
y peut tomber dans des contre - fiens ; 8c ils n’y
font guères plus faciles à éviter que dans une
Véritable traduérion. Centre-fiens dans l’expreftion,
quand la muf que eft trifte au lieu d’être g a ie ,
gaie au lieu d’être trifte, légère au lieu d’être
g ra v e , grave au lieu d’être légère, &c. Contre-
Jens dans la profodie , lorfqu’on eft bref fur des
fyllabes longues , long fur des fyllabes brèves , ;
qu’on n’obferve pas l’accent de la langue, 8cc, j
Contre -fiens dans la déclamation , lorfqu’on y
exprime par les mêmes modulations des fentimens
oppofés ou différens, lorfqu’on y rend moins les
fentimens que les mots, lorfqu’on s’y appefantit
fur des détails fur lefquels on doit gliffer , lorfque
les répétitions font entaffées hors de propos. Con- 1
tre-fiens dans la ponctuation , lorfque la phrafe de ;
mufique fe terminé par une cadence parfaite dans
les endroits où le fens eft fufpendq, ou forme
un repos imparfait quand le fehs eft achevé. Je ,
parle ici des contre -Jens pris dans la rigueur du
mot ; mais le manque d’exprefîion eft peut-être le
plus énorme de tous. J’aime encore mieux que
la mufique dife autre' chofe que ce qu’elle doit
fjire , que de parler & ne rien dire du tout.
( J. J. Rouffeau, ) . >
* Affurémeiît une faute de profodie ne
$eut jamais paffer pour un contre - fiens , à moins
,c[ue, par une rencontre bien rare, la faute ne
donne à la fyllabe offenfée une autre fignification,
comme par exemple le mot tache qui fur une
note trop longue deviendrait tâche.
Quant à la dernière phrafe de Rouffeau , où s
il préfère la mufique qui dit autre chofe que ce
qu’elle doit dire , à cejle qui ne dit rien du tout,
je ne fais fi beaucoup de gens feraient de fonavis.
La mufique qui manque de cara&ère & d’expref-
Jjon a fans doute peu de mérite , mais elle peut
avoir au moins celui d’une mélodie élégante 8c
agréable. Elle ne prouve que de la foibleffe dans
l’imagination du compofiteur , il n’a pas rempli
votre idée, mais au moins il ne l’a pas bleffee. -
A11 contraire , la mufique faite à contre-fiens , qui
fuppofe dans le compofiteur un efprit faux, une
conception abfurde , égare fans çeffe votre .pe$fée,
fiiifiquc. Tome /,
C O P 1 j s 9
la révolte , vous caufe des moiiVeffieftts d’indignation
qu’aucun mérite de chant ne peut
contre balancer,
( M , Framery. J'
CONTRE-TEMPS, fi. m. Mefure à contre-temps
eft celle où l’on paufe fur le temps foib le, où l’on
gliffe fur le temps fort, & o ù le chant femble être en
contre-fens avec la mefure. ( Voyez Syncope. )
( J. J. Roujfieau. )
C o n t r e -t em p s . L’article de Rouffeau ne lignifie
rien du tout , ou du moins ne dit pas ce qu’il
veut dire. Un air eft a contre - temps lorfque les
cadences y font préparées fur Te frappé de la
mefure, 8c effeduées fur le le ver ; & cette ob-
fervation eft fenfible même dans la fimple mélodie
, fans le fecours des accompagnemens, car
la mélodie porte implicitement le fentiment de
l’harmonie. L ’oreille exige que tous les repos foienc
fur un frappé, & que tous les accords qui en
appellent d’autres , foit qu’ils expriment ou no il
une diffonance, foient fur un levé. Auffi M. l’abbé-
Feytou o b fe rv e - t- ii avec beaucoup de raifon,’
dans plufiêurs de fes articles , notamment au mo$
clavier, que notre gamme n’eft point en mefure
8c marche à contre-temps. ( Voyez Clavier. )
Il n’eft pas auffi rare qu’tm devrait l’imaginef
de trouver des compofiteprs qui écrivent leurs airs
à contre-temps, ce qui marque cependant une grande
infenfibilité d’oreille , 8c ce qui nous empêche
d’en citer des exemples modernes. Ils croyent
tout réparer en ajoutant une demi - mefure qui
les aide à finir l ’air par un frappé, mais les auditeurs
délicats n’en ont pas moins été ofFenfés
tant qu’a duré cette cadence boîteufe.
Les maîtres italiens fe permettent quelquefois',’
dans la mefure‘à quatre temps, d’écrire des traits,
8c même toute une moitié d’aituà contre-temps.
Leur oreille n’en eft pas bleffée ; mais c’eft qu’ils
ne prennent pas garde que le morceau eft véritablement
a deux temps ,r quoiqu’ils l’aient écritr
a quatre ; 8c les auditeurs fuppofent intérieurement
cette mefure , quoiqu’elle ne foit ni indiquée
, ni battue. Il en réfulte que la mefure
à deux ou à quatre temps n’eft point arbitraire ,
8c que c eft 1 harmonie qui doit en déterminer le
choix. ( M. Framery. )
COPISTE, fi. m. Celui qui fait profeffion de
copier de la mufique.
Quelque progrès qu’ait fait l’art typographique ;
on n’a jamais pu l’appliquer à la mufique avec
autant^de fuccès qu’à l’écriture , foit parce que
les goûts de l’efprit étant plus confiai« que ceux
de l’oreille, on s’ennuie moins vite des mêmes
livres que des mêmes chanfons ; foit par les
difficultés particulières que la combinaifon des
notes 8c des lignes' ajoute à l’impreffion de la
mufique : car fi l’on imprime premièrement les
portées & équité les notes, il efi impoffible .de
A a a