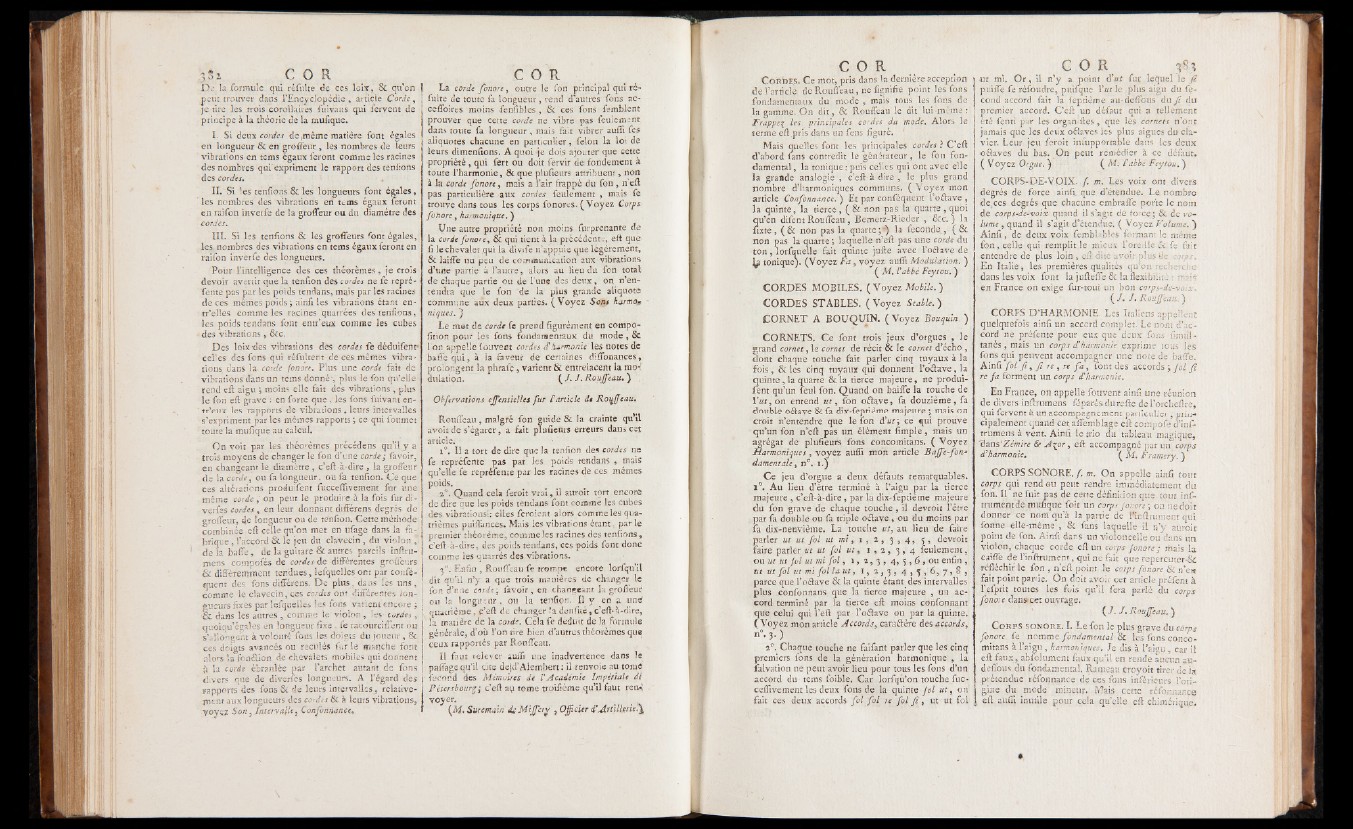
3 $ 2 C O R
De la formule qui ré fuite de ces lo i* , & qu’on |
peut trouver dans l ’Encyclopédie, article Corde,
je tire les. trois corollaires fuivaus qui fervent de
principe à la théorie de la mufique.
I. Si deux cordes de ,même matière font égales
en longueur & en groffeur, les nombres de leurs
vibrations en tems égaux feront comme les racines
des nombres qui expriment le rapport des tenfions
des cordes,
II. Si les tenlions & les longueurs font égales,
les nombres des vibrations eri tems égaux feront
en raifon inverfe de la groffeur ou du diamètre des
cordes.
III. Si les tenlions & les groffeurs font égales,:
les nombres des vibrations en tems égaux feront en
raifon inverfe des longueurs.
Poiir l’intelligence des ces théorèmes, je crois
devoir avenir que la .tenfion des cordes ne fe repréfente
pas par les poids tendans, mais par les racines
de ces mêmes poids ; ainfi les vibrations étant en-
tr’elles comme les racines quarrées des tenfions,
les poids tendans font entr’eux comme les cubes
des vibrations, &c.
Des loix des vibrations des cordes Ce déduifent*
celles des fons qui réfultent de ces mêmes vibrations,
dans la- corde fonore. Plus une corde fait de
vibrations dans un tems donné', plus le fon qu’elle
rend eft aigu ; moins elle fait des vibrations , plus
le fon eft grave : en forte q ue , les fons fuivant entr’eux
les rapports de vibrations, leurs intervalles
s’expriment par les mêmes rapports ; ce qui foumet
toute la mufique au calcul.
On voit par les théorèmes précédens qu’il y a
trois moyens de changer le fon d’une corde; fa voir,
en changeant le diamètre , c’eft-à-dire , la grofleur
de la corde, ou fa longueur, ou fa tenfion. Ce que
ces altérations produifent fucceflivement fur une
même corde ,' on peut le produire^; la fois fur di-
verfes cordes, en leur donnant différens degrés de
groffeur, 4e longueur ou de tenfion. Cette méthode
combinée eft celle qu’on met en ufage dans la fabrique
, l’accord & le jeu du clavecin, du violon *
de la baffe, de la guitare & autres pareils inftru-
mens compofés de cordes de différentes groffeurs
& différemment tendues, leiquelles ont par confé-
quent des fons différens. De plus, dans les uns,
comme le clavecin, ces cordes ont différentes longueurs
fixes par lefqueiles les fons varient encore ;
& dans les autres , comme le violon , les tordes,
quoiqu’égales en longueur fixe , fe racoürciffent ou
s’allôngent à volonté fous les doigts du joueur , &
ces doigts avancés ou reculés fur le manche font
alors la fon&ion de chevalets mobiles qui donnent
à la corde ébranlée par l’archet autant de fons
divers que de diverfes longueurs. A l’égard des '
rapports des fons & de leurs intervalles^ relative- I
jntnt aux longueurs des cordes & à leurs yibrations, J
voyez Son z intervalle ) Confia nuança i
C O R
La corde fonore, outre le fon principal qui réc
i t e de toute fa longueur, rend d’autres fons ac-
ceffoires moins ftenfibles , & ces fons femblent
prouver que cette corde ne vibre pas feulement
dans toute fa longueur, mais fait vibrer aufli fes
aliquotes chacune en particulier, félon la loi de
leurs dimenfions. A quoi je dois ajouter' que cette
propriété , qui fert ou doit fervir de fondement à
toute l ’harmonie, & que plufieurs attribuent, non
à la corde fonore, mais a l’air frappé du fon , n e«
pas particulière aux cordes feulement , mais fe
trouve dans tous les corps fonores. (V o y e z Corps>
fohore, harmonique. )
Une autre propriété non moins furprenante de
la corde fonore, & qui tient à la précédente, eft que-
fi le chevalet qui la divife n’appuie que légèrement,
& laiffe un peu de communication aux vibrations
d’une partie à l’autre, alors au lieu du fori total
de chaque partie ou de l une des deux, on n’entendra
que le fon de la plus grande aliquote
commune aux deux parties. (V o y e z Sons harmoa
niques. )
Le mot de corde fe prend figurément en compo-
fition pour les fons fondamentaux du mode , &
I on appelle fouveot cordes (Tharmonie les notes de
baffe qui, à la faveur de certaines diffonances,
prolongent la phrafe, varient & entrelacent la mo-^
dulation. {J . J. Rouffeau,)
Obfervations ejfentielles fur 1'article de Roififleau,
Rouffeau , malgré fon guide & Ja crainte qu’il
avoitde s’égarer, a fait plufieurs erreurs dans cet
article. • .
i°. Il a tort de dire que la tenfion des cordes ne
fe repréfente pas par les poids tendans , mais
qu’elle fe repréfente par les racines de ces mêmes
poids.
2.°. Quand cela feroit vrai, il auroît tort encore
de dire que les poids tendans font comme les cubes
des vibrations!: elles feroient alors comme les quatrièmes
puiffances. Mais les vibrations étant, par le
premier théorème, comme les racines des tenfions,
c’eft-à-dire, des poids tendans, ces poids font donc
comme les quarrés des vibrations.
■ 3°. Enfin , Rouffeau fe trompe encore lorfqu’il
dit qu’il n’y a que trois manières de changer le
fon d’une corde; favoir, en changeant la groffeur
ou la longueur, ou la tenfion. Il y en a une1
quatrième, c’eft de changer !a denfité, c’eft-à-dire,
la matière de la corde. Cela fe déduit de la formule
générale, d’oii l’on tire bien d’autres théorèmes que
ceux rapportés par Rouffeau.
Il faut relever aufîi une inadvertence dans le
paffage qu’il cite dejd’Alembert : il renvoie au tome
fécond des Mémoires de 1'Académie Impériale di
P éter s bourg; c’eft au tome troifième qu’il faut ren«î
voyer.
(AJ. Suremain dg Miffery , Officier d’Artillerie^
C O R
C ordes. Ce mot, pris dans la dernière acception
de l’article de Rouffeau, ne fignifie point les fons
fondamentaux du mode mais tous les fons de
la gamme. On d it, & Rouffeau le dit lui*même :
Frappe^ les principales cordes du mode. Alors le
terme eft pris dans un fens figuré. 1
Mais quelles font les principales cordes ? C ’eft
d’abord fans contredit le générateur, le fon fondamental,
la tonique:puis celles qui ont. avec elle
la grande analogie , c’eft-à dire, le plus grand
nombre d’harmoniques communs. (V o y e z mon
article Confonnance. ) Et par conféquent l’oéîave ,
la quinte, la tierce, ( & non pas la quarte , quoi
qu’en difent Rouffeau, Bemetz-Rieder , &c. ) la
iixte , ( & non pas la quarte la fécondé., ( &
non pas la quarte; laquelle n’eft pas un g corde du
to n , lorfquelle fait quinte jufte avec l’odave de
tonique}. (Voyez F a , voyez aufîi Modulation. )
( M. l'abbé Feytou. )
CORDES MOBILES. (V o y e z Mobile.)
CORDES STABLES. (V o y e z Stable.)
CORNET A BOUQUIN. ( Voyez Bouquin. )
CORNETS. Ce font trois jeux d’orgues , le
grand cornet, le cornet de récit & le cornet d’écho,
dont chaque touche fait parler cinq tuyaux à la
fois , & les cinq tuyaux qui donnent l’oéîave, la
quinte, la quarte & la tierce majeure, ne produi-
fent qu’un leul fon. Quand on baiffe la touche de
Y ut, on entend u t , fon o â a v e , fa douzième, fa
double oâaye & fa dix-feptième majeure ; mais on
croit n’entendre que le fon d'ut ; ce qui prouve
qu’un fon n’eft pas un élément fimple, mais un
agrégat de plufieurs fons concomitans. ( Voyez
Harmoniques, voyez aufli mon article Baffe-fon*
dament ale, n°. i.)
C e jeu d’orgue a deux défauts remarquables.
i° . Au lieu d’être terminé à l’aigu par la tierce
majeure , c’eft-à-dire, par la dix-feptième majeure
du fon grave de chaque touche, il devroit l’être
par fa double ou fa triple oélave , ou du moins par
la dix-neuvième. La touche ut, au lieu de faire
parler ut ut fo l ut mi, i , 2 , 3 , 4 , 5 , devroit
faire parler ut ut fo l ut, 1 , a , 3 , 4 feulement,
ou ut ut fo l ut mi f o l , 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6 , ou enfin ,:
ut ut fo l ut mi fo l la u t, 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 9
parce que l’o&aye & la quinte étant des intervalles
plus confonnans. que la tierce majeure , un accord
terminé par la tierce eft moins corifonnant
que celui qui l’eft par l’oâave ou par la quinte.
(V o y e z mon article Accords, caraâère des accords,
n°. 3. )
20. Chaque touche ne faifant parler que les cinq
premiers fons de la génération harmonique ., la
falvation ne peut avoir lieu pour tous les fons d’un
accord du tems foible. Car lorfqu’on touche fucceflivement
les deux fons de la quinte fo l u t, on
fait ces deux accords fo l fo l te fol f i , ut ut fol
C O R 383
ut mi. O r , il n’y a point d'ut fur lequel le fi.
puiffe fe réfoudre, p uifque Y ut le plus aigu du fécond
accord fait la feptième au-de flous du f i du
premier accord. C ’eft un défaut qui a tellement
été fenti par les organiftes , que les cornets n’ont
jamais que les deux oélaves les plus aigues du cia*
vier. Leur jeu feroit infupportable dans les detix
oétaves du bas. On peut remédier à ce défaut.
( V oyez Orgue. ) ( Mï l'abbé Feytou. )
CORPS-DE-VOIX, fi m. Les voix ont divers
degrés de force ainfi que d’étendue. Le nombre
de^ces degrés que chacune embraffe porte le nom
de corps-de-voix quand il s’agit de force; & de vu-
lume , quand il s’agit d’étendue. ( Voyez Volume. )
Ainfi , de deux voix fembbbles formant le même
fo n , celle qui remplit le mieux l’oreille & fe fait
entendre de plus loin , qft dite avoir plus de corps.
. En Italie, les premières qualités qu’on recherche
dans les voix font la jufteffe & la flexibilité : rr
en France on exige fur-tout un bon corps-de-voix,
( / . J. Rouffeau.)
CORPS D ’HARMONIE. Les Italiens appellent
quelquefois ainfi un accord complet. Le nom d’accord
ne préfente pour eux que deux fons fimiîî-
tanés, mais un corps d'harmonie exprime tous les
fons qui peuvent accompagner une note de baffe.
Ainfi fo l f i , f i re , re f a , font des accords ; fo l f i
re fa forment un corps d'harmonie.
En France, on appelle fouvent ainfi une réunion
de divers inftrumens féparés durefte de l’orcheftre,
qui fervent à un accompagnement particulier, principalement
quand cet affemblage eft compofé d’inf-
trumens à vent. Ainfi le trio du tableau magique,
'dans* Z émire 6» Aço r , eft accompagné par un corps
d'harmonie. ( M. Framsry. )
CORPS SONORE, f. m. On appelle ainfi tout
corps qui rend ou peut rendre immédiatement du
fon. Il ne fuit pas de cette définition que tout inf-
trumèntde mufique foit un corps Jorore; on ne doit
donner ce nom qu’à la partie de Pinftrument qui
fonne elle-même , & fans laquelle il n’y auroit
point de fon. Ainfi dans un violoncelle ou dans un
violon, chaque corde eft un corps fonore; mais la
caiffe de l’inftrumênt, qui ne fait que repercuter•&
réfléchir le fon , n’eft point le corps fonore & n’ea
fait point partie. On doit avoir cet article préfem à
l’efprit toutes les fois qu’il fera parlé du corps
fonore dan»cer ouvrage.
( 7. J. Rouffeau.)
C o r p s sonore. I. Le fon le plus grave du corps
fonore fe nomme fondamental & les fons conco-
mitans à l’aigu , harmoniques. Je dis à l’aigu , car il
eft faux, abfolument faux qu’il en rende aucun au-
deffous du fondamental. Rameau croyoit tirer cle la
prétendue réfonnance de ces fons inférieurs l’origine
du medé mineur. Mais cette réfonnance
eft aufli inutile pour cela qu’elle eft chimérique