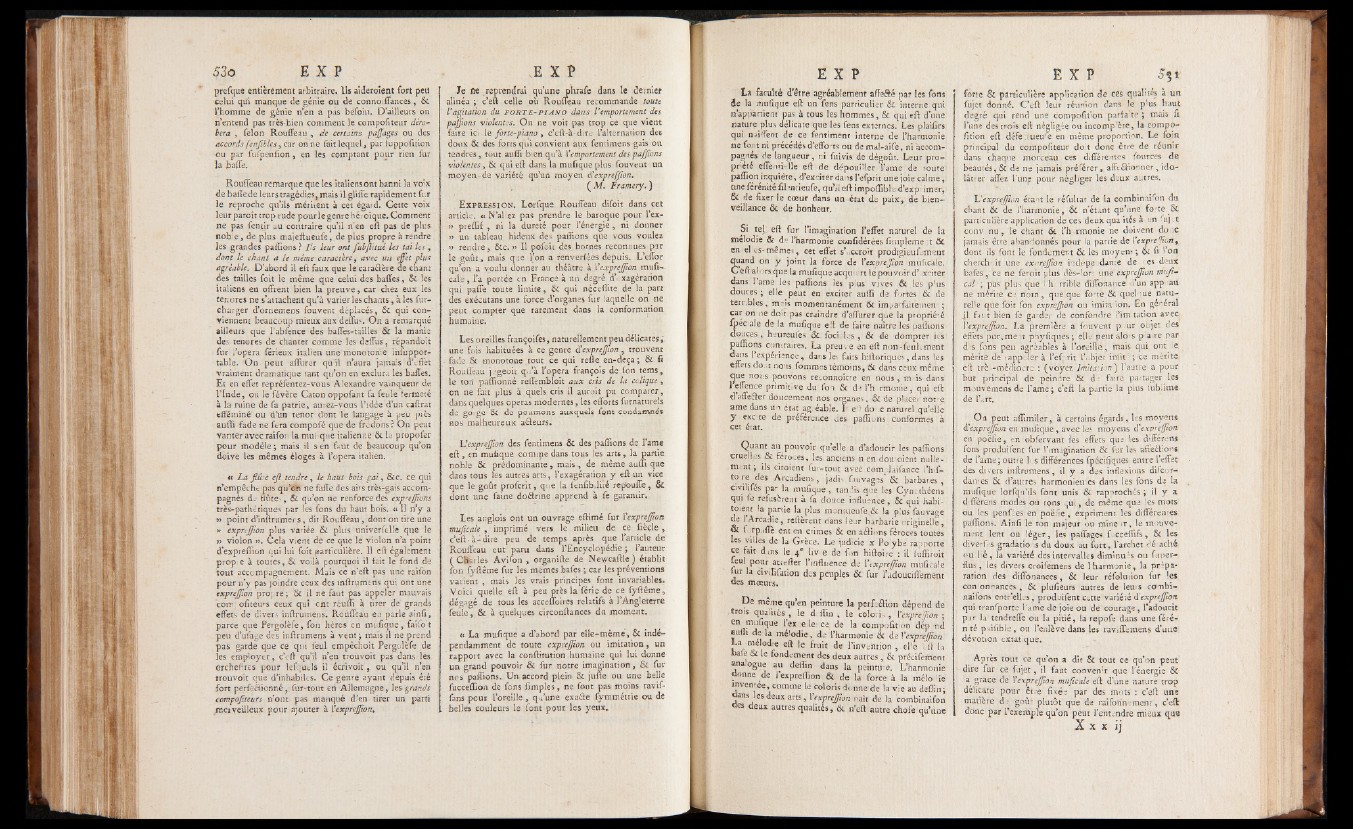
53o E X P
prefque entièrement arbitraire. Ils aideroîent fort peu
celui qiîi manque de génie ou de connoiffances, &
l’homme de génie n’en a pas bëfoin. D ’ailleurs on
n’entend pas très-bien comment le compofiteur dérobera
, félon Rouffeau , de certains paffages ou des
accords fenflblesy car on n e fait lequel, par luppofition
ou par fufpenfion, en les comptant pour rien fur
la baffe.
Rouffeau remarque que les italiens ont banni la voix
de baffede leurs tragédies, mai s il gliffe rapidement fur
le reproche qu’ils méritent à cet égard. Cette voix
leur paroît trop rude pour le genre héroïque. Comment
ne pas fentir au contraire qu’il n'en eft pas de plus.
noblje, de plus majeftueufe, de plus propre à rendre
les grandes pallions ? Ils leur ont fubflitué les tai Les ,
dont le chant a le même caractère, avec un effet plus
agréable. D ’abord il eft faux que le caraélère de chant
des tailles foit le même que celui des baffes, & les
italiens en offrent bien la p reu v e , car chez eux les
tenores ne s’attachent qu’à varier les chants, à les fur-
charger d’ornemens fouvent déplacés, & qui conviennent
beaucoup mieux aux demis. O n a remarqué
ailleurs que l ’abfence des baffes-tailles & la manie
des tenores de chanter comme les deffus, répandoit
fur l’opéra férieux italien une monotonie infuppor-
table. O n peut affurer qu il n’aura jamais d’effet
vraiment dramatique tant qu’on en exclura les baffes.
Et en effet repréfentez-vous Alexandre vainqueur de
l ’ Inde, ou le févere Caton oppofant fa feule fermeté
à la ruine de fa patrie, aurez-vous l ’idée d’un caftrat
efféminé ou d’un ténor dont le langage à pep près
auffi fade ne fera compofé que de frédons? On peut
vanter avec raifort la mufi que italienne & la propofer
pour modèle ; mais il s en faut de beaucoup qu’on
doive les mêmes éloges à l’opera italien.
« La flûte efl tendre, le haut bois gai, & c . ce qui
n’empêcht pas qu’on ne faffe des airs très-gais accompagnés
de flûtes, & qu’on ne renforce des expreflions
très-pathétiques par les fons du haut bois. « Il ri’y a
0 point d’inftrumers, dit Rouffeau , dont on tire une
» exprejjîon plus variée & plus univerfelle que le
» violon ». Ce la Vient de ce que le violon n’a point
d’expreffion qui lui foit particulière. Il eft également
propre à toutes, & voilà pourquoi il fait le fond de
tout accompagnement. Mais ce n’eft pas une raifon
pour n’y pas joindre ceux des inftrpmens qui ont une
exprejjîon propre; & il ne faut pas appeler mauvais
conv offteurs ceux qui ont réuffi à tirer de grands
effets de divers inftrumens. Rouffeau en parle ainft,
parce que Pergolèfe, fon héros en mufique, faifo’t
peu d’ufage des inftrumens à vent ; mais il ne prend
pas garde que ce qui feul empêchoit Pergolèfe de
les emp lo y e r, c’eft qu’il n’en trouvoit pas dans les
orchefîres pour lefqucls il éc r ivo it, ou qu’il n’en
trouvoit que d’inhabiles. C e genre ayant depuis été
fort perfectionné, fur-tout en Allemagne, les grands
compojiteurs n’ont pas manqué d ’en tirer un parti
meiveilleux pour ajouter à l’exprejjîon.
i X Î
Je ne reprendrai qu’une phrafe dans le dernier
alinéa ;: c’eft celle où Rouffeau recommande toute
l’agitation du fo r t e - p ia n o dans l’emportement des
pâmons violentes. On ne vo it pas trop ce que vient
faire ici le forte-piano , c’eft-à-dire l’alternation des
doux & des forts qui convient aux fentimens gais ou
tendres, tout auffi bien qu’à l’emportement des pajjîons
violentes t & qui eft dans la mufique plus fouvent un
moyen-de variété qu’un moyen Y exprejjîon.
( M. Framery. )
E x p r e s s io n . Lorfque Rouffeau difoit dans cet
article. « N’aliez pas prendre le baroque pour l’ex-
» preffif , ni la dureté pour l’énergie, ni donner
» un tableau hideux des paffions que vous voulez
» rendre, & c . » Il pofoit des, bornes reconnues par
le g o û t , mais que l’on a renverfées depuis. L ’effor
qu’on a voulu donner au théâtre à Y exprejjîon mufi-
c a le , l’a portée en France à un degré d’exagération
qui paffe toute limite, & qui néceffite de la part
des exécutans une force d’organes fur laquelle on ne
peut compter que rarement dans la conformation
humaine.
Les oreilles françoifes, naturellement peu délicates*
une Fois habituées à ce genre d'exprejjîon ^ trouvent
fade & monotone tout ce qui refie en-deça ; & fi
Rouffeau j jgeoit q-s’à l’opéra franço/s de Ion tems,
le ton paffionné rellembloit aux cris de la colique ,
on ne fait plus à quels cris il auroit pu comparer,
dans quelques opéras modernes, les efforts furnaturels
de goige & de poumons auxquels font condamnés
nos malheureux aéleurs.
L[exprejjîon des fentimens & des paffions de l’ame
eft , en mufique comrpe dans tous les arts, la partie
noble & prédominante, mais -, de même auffi que
dans tous les autres arts, l’exagération y eft un vice
que le goût proferit, que la fenfibilité rep’ouffe, &
dont une faine dodrine apprend à fe garaniir.
Les anglois ont un ouvrage eftimé fur l’exprejjîon
muficale , imprimé vers le milieu de ce f iè c le ,
c’eft-à -d ire peu de temps après que l’article de
Rouffeau eut paru dans l’Encyclopédie ; l'auteur
( Charles Avifon , organifte de Ne\vcaftle ) établit
fon fyftême fur les mêmes bafes ; car les préventions
varient , mais les vrais principes font invariables.
V o ic i quelle eft à peu près la férié de ce fy ftêm e ,
dégagé de tous les acceffoires relatifs à l’Angleterre
feule, & à quelques circonftances du moment.
« L a mufique a d’abord par elle-même, & indépendamment
de toute exprejjîon ou imitation, un
rapport avec la conftitution humaine qui lui donne
un grand pouvoir & fur notre imagination, & fur
nos paffions. Un accord plein & jufte ou une belle
fucceffion de fens Amples, ne font pas moins ravif-
fans peur l’o re ille , qu’une exaéfe fymmétrie ou de
belles couleurs le font pour les yeux..
Ë X P
La faculté d’être agréablement affefté par les fons
de la mufique eft un fens particulier & interne qui
n’appartient pas à tous les hommes, & qui eft d’une
nature plus délicate que les fens externes. Les plaifirs
qui naiffent de ce fentiment interne de l’harmonie
ne font ni précédés d’efforts ou de m al-aife, ni accompagnés
de langueur, ni fuivis de dégoût. Leur propreté
effemitlle eft de dépouiller l’am e d e toute
paffion inquiète, d’exciter da is l’efprit une joie calme ,■
une férenité fibntieufe, qu’il eft impoffiblcd’exp* imer,
& de fixer le coeur dans un état de pa ix, de bienveillance
& de bonheur.
Si tel. eft fur l’imagination l’effet naturel de la
mélodie & d “ l’harmonie confédérées fimpleme 't Ôc
en el es-mêmes, cet effet s’ accroît prodigieufement
quand on y joint la force de Yexprejjîon muficale.
C eft alors que )a mufique acquiert le pouvoir d’ . xciter
dans lame les paffions les plus vives & les p ’ us
douces ; elle peut en exciter auffi de fortes & de
terr.bles, m us momentanément Ôc imparfaite™en ;
car on ne doit pas craindre d’affùrer que la propriéié
spéciale de la mufique eft de faire naître les pallions
dou ce s , heureufes ôc focbles , & de dompter k s
paffions contraires. La preuve en eft non-feukment
dans l’expérience, dans les faits hiftoriques, dans les
effets do.it nous fournies témoins, & dans ceux même
que nous pouvons reconnoître en n ou s, m-is dans
leffence primitivç du'Ion & de l’h rmonie, qui eft
d’affe&er doucement nos organes, & de placer nore.
ame dans un état ag. éable. I ! eft do\c naturel qu’elle
y excite de préférence des paffions conformes à
cet état.
Quant an pouvoir qu’elle a d’adoucir les paffions
cruelles & féroces, les. anciens n en domoient nullemen
t; ils citoiènt fur-toùt avec com.daifance l’hifü
® Arcadiens , jadis fauvages & barbares,
civilifes par la mufique, taniîis que les Cyn;théens
qui fe refusèrent à fa douce influence, & qui habi-
toient la partie la plus montueufesÔ£ la plus fauvage
de 1 Arcadie, relièrent dans leur barbarie originelle,
«t f irp.iffe ent en crimes & en aélions féroces toutes
les villes de la Grèce. L e judicie x Po ybe rapporte
ce fait d ms le 4e liv e de fon hiftoire : il luffiroit
leul pour attefter l’influence de Yexpreffion muficale
lur la civiîifation des peuples ÔC fur l’adouciffement
des moeurs.
D e même qu’en peinture la perLélion dépend de
, trois qualités , le d ffin , le coloria , Yexprefjîôn ;
en mufique l’ex efte- ce de la compofiton dép nd
«ulh de la mélodie, de l ’harmonie & de l’exprejjîon
La mélodie eft le fruit de l’invention , elle eft b
baie & le fondement des deux autres , & préciferrient
ana ogue au deffin dans la peinture. L’harmonie
donne de lexpreffion & de la force à la mélo ie
mventee, comme le coloris donne de la vie au deffin;
dans les deux arts, Yexpreffion naît de la combinaifon
des deux autres qualités, & n’eft autre chofe qu’dne
E X P 551
forte & particulière application de côs qualités a un
fujet donné. C ’eft leur réunion dans le p'us haut
degré qui rend une compofidon parla te ; mais fl
l’une desrrois eft négligée ou-incomplète, la compo-
fition eft défeiiueu'e en même proportion. L e fom
principal du compofiteur doit donc être de réunir
dans chaque morceau ces différentes fources de
beautés, & de ne jamais préférer, affe&ionner, idolâtrer
allez l’unp pour négliger les deux autres.
L 'exprejjîon étant le réfultat de la combinaifon du
chant & de l’harmonie, & n’étant qu’ une forte ÔC
particulière application de ces deux qua ités a un uj .t
conv n u , Je chant &. l’h .rmonie ne doivent do ie
jamais être abandonnés pour la partie de Yexprejîonr
dont ils font le fondement & les moyens ; & fi l’on
cherch- it une exprejjîon iadepe dame de \ es deux
bafes f ce ne feroit plus dès-ion une exprejjîon niufl-
cal ; pas plus que 1 h rrible diffonance ci’un app au
ne mérite a n om , que'que fo rte & quelque naturelle
que foit fon exprejjîon ou imita ion. En général
4I fai t bien fe garder de confondre i’im tation aveci
Y exprejjîon. La première a fouvent p ur objet des
effets pur;me -î phyfiques; elle peut alois p'a.re par
des fons peu agréables à l’o reille, mais qui ont e
mérite de rappeler à l’ef. rit l’objet imité ; ce mérite
eft trè -médiocre : (vo y e z Imitation ) l’autre a pour
but principal de peindre & d . faire partager les
mouvemens de famé ; c’elt la partie la pius lubùme
de l’art.
On peut affimile.r, à certains égards, les moyens
d’exprejjîon en mufique, avec les moyens Yexpreffion
en poëfie, en obfervant les effets que les diffère ns
fons produifent fur l’ imagination & fur ies affections
de l’ame ; outre k s différences fpécifiques entre l’effet
des du ers inftrumens, il y a des inflexions difcor-
dantes & d’autres harmonieufes dans les fons de la
mufique lorfqu’ils font unis & rapprochés ; il y a
d fférens modes ou tçns o u i, de même que les mots
ou les penfées en po ëfte, expriment les différentes
paffions. Ainfi le ton majeur ou mine i r , le mouvement
lent ou lég e r , les paffages f.icceffifs, & les
diverfes gradations du doux au fo r t , l’archet dé aché
ou l é , la variété des intervalles diminués ou fu perdus
, les divers croifemens de 1 harmonie, la préparation
des diffonances, & leur réfolution fur les
con on rances , & plufieurs autres de leurs combi-
naifons entr’elles, produifent c -tte variété d'exprejjîon
qui tranfporte Tame de joie ou de courage, l’adoucit
par la tendreffe ou la pitié, la repofe dans une féré-
n té p d fib le , ou l’enlève dans les raviffcmens d’une
dévotion extatique.
Après tout ce qu’on a dit & tout ce qu’on peut
dire fur ce fu je t, il faut convenir que l’énergie &
a,.?race l’CxpreJJîon muficale eft d’une nature trop
deiicate pour être fixée par des mots : c’eft une
matière d e goût plutôt que de raifohnement, c’eft
donc par l ’exemple qu’on peut l’entendre mieux que