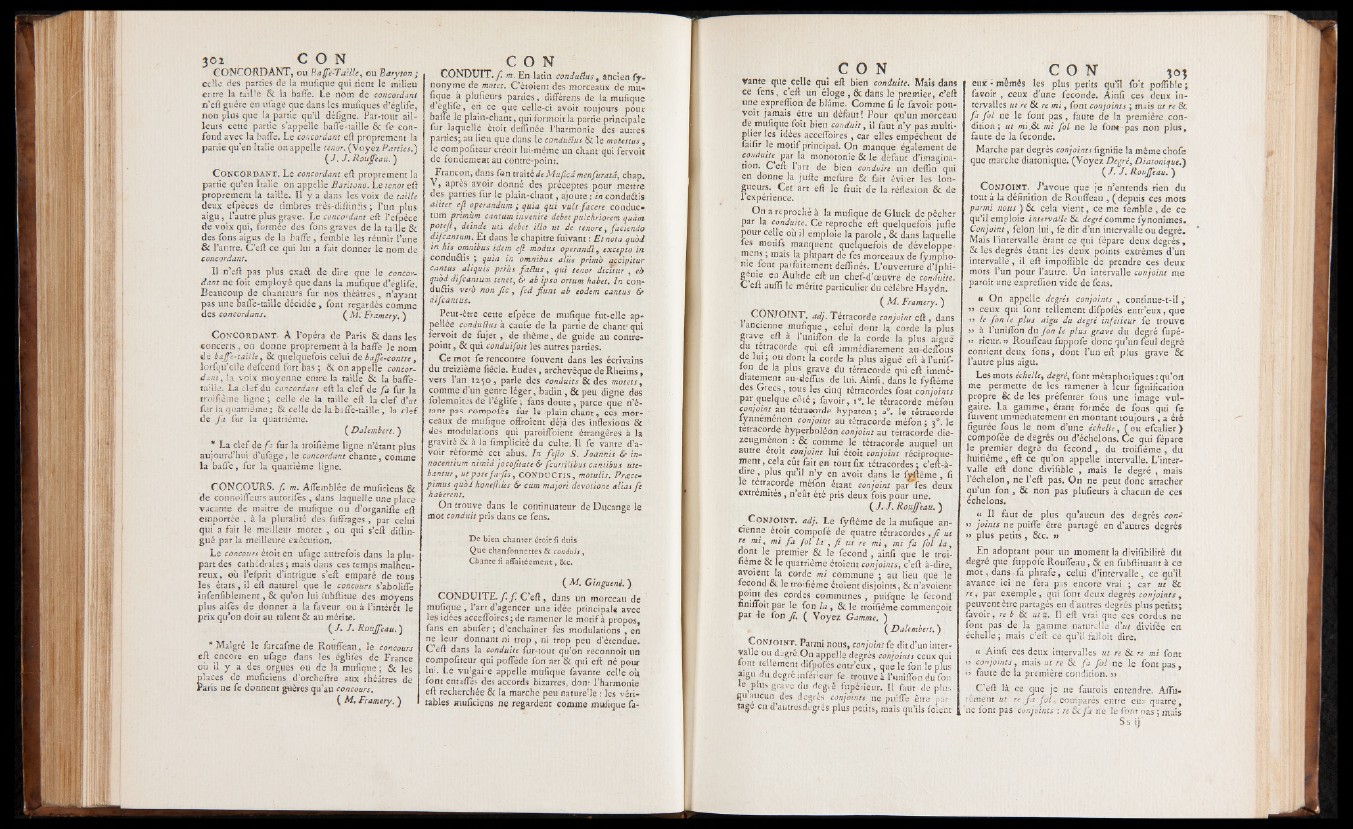
3©i C O N
CON CO R DANT, ou Baffe-Taille, ou Baryton;
celle des parties de la mufique qui .tient le milieu
entre la taille & la baffe. Le nom de concordant
rfeft guère en ufage que dans les mufiques d’églifë,
non plus que la partie qu’il défigne. Par-tout ailleurs
cette partie s’appelle baffe-taille & f e confond
avec la baffe. Le concordant eft proprement la
partie qu’en Italie on appelle ténor. (Voyez Parties.)
( J. J. Roujffeau. )
C o n co r d an t . Le concordant eft proprement la
partie qu’en Italie on appelle Baritono. Le ténor eft
proprement la taille. Il y a dans les voix de taille
deux efpèces de timbres très-diftin8s ; l’un plus
aigu, l’autre plus grave. Le concordant eft l’efpèce
de voix qui, formée des fons graves de la taille &
des fons aigus de la baffe , femble les réunir l’une
& l’autre. C ’eft ce qui lui a fait donner le nom de
concordant.
Il n’ eft pas plus exa& de dire que le concordant
ne foit employé que dans la mufique d’églife.
Beaucoup de chanteurs fur nos théâtres, n’ayant
pas une baffe-taille décidée , font regardés comme
des concordans. ( M. Framery. )
C on co r d an t . A l’opéra de Paris & dans les
concerts , on donne proprement à la baffe le nom
de baffe-taille, 8c quelquefois celui de baffe-contre,
lorfqu’elle defcend fort bas ; & on appellè concordant
, la voix moyenne entre la taille & la baffe-
taille. La cle f du concordant eft la cle f de fa fur la
troifième ligne ; celle de la taille eft la clef d'ut
fur la quatrième ; & celle de la baffe-taille , la clef
de fa fur la quatrième.
( Dalembert. )
* La clef de fa fur la troifième ligne n’étant plus
aujourd’hui d’ufage, le concordant chante, comme
la baffe, fur la quatrième ligne.
CON COU RS, f. m. Affemblée de muficiens &
de connoiffeurs autorifés , dans laquelle une place
vacante de maître de mufique ou d’organifte eft
emportée , à la pluralité des fuffrages, par celui
qui a fait le meilleur motet , ou qui s’eft diftin-
gué par la meilleure exécution.
Le concours étoit en ufage autrefois dans la plupart
des cathédrales ; mais dans ces temps malheureux,
où l’efprit d’intrigue s’eft emparé de tous
les états, il eft naturel que le concours s’aboliffe
infenfiblement, & qu’on lui fubftitue des moyens
plus aifés de donner à la faveur ou à l’intérêt le
prix qu’on doit au talent & au mérite.
( 7. 7. Rouffeau. )
* Malgré le farcafme de Rouffeau, le concours
eft éneore en ufage dans les églifes de France
où il y a des orgues ou de la mufique ; & les
laces de muficiens d’orcheftre aux théâtres de
ans ne fe donnent guères qu'au concours.
( M. Framery, ) I
C O N
CONDUIT, f . m. En latin condublus, ancien fy-
nonyme de motet. C ’étoient des morceaux de mu«
ficjue a plufieurs parues, différens de la mufique
d èglife, en ce que celle-ci a voit toujours pour
baffe le plain-chant, quiformoitla partie principale
fur laquelle étoit deflinée l’harmonie des autres
parties; au lieu que dans le condublus & le motettus,
le compofiteur créoit lui-mème un chant qui feryoit
de fondemeat au contre-point.
Francon, dans fon traite^Miuficâmenfuratâ, chap.
V , après avoir donné des préceptes pour mettre
des parties fur le plain-chant, ajoute : in condudlis
aliter efl operandum ; quia qui vult facere conduc-
tum primum cantum invenire debet pulchriorem quàtn
potefl, deinde uti debet illo ut de tenore, faciendo
difeantum. Et dans le chapitre fuivant : Et nota qubd
in his omnibus idem ejl rnodus operandl, excepto in
condu&is ; quia in omnibus alïts primo açcipitur
cantus aliquis prius fabius, qui ténor dicitur , eb
quod difeantum tenet, 6* ab ipso ortum habet. In con-
du&is vero non f i e , fed fiunt ab eodem cantus &
difeantus.
Peut-être cette efpèce de mufique fut-elle ap-
pellée conduttus à caufe de la partie de chant4 qui
fervoit de fujet , de thème, de guide au contrepoint
, & qui conduifoit les autres parties.
Ce mot fe rencontre fouvent dans les écrivains
du treizième fiècle. Eudes, archevêque de Rheims,
vers l’an 12,50, parle des conduits & des motets,
comme d’un genre léger, badin , & peu digne des
folemnites de l’églife ; fans doute, parce que n’étant
pas compofés fur le plain-chant, ces morceaux
de mufique offroient déjà des inflexions &
des modulations qui paroiffoient étrangères à la
gravité & à la fimplicité du culte. Il fe vante d’avoir
réformé cet abus. In fefio S. Joannïs & in-
nocentium nimha jocofitate & feurrilibus cantibus ute-
bantur, ut pote farfis, CONDUCTi s , motulis. P race»
pimus quoi honefhiis 6* cum majori devotione alias fe
haberent.
On trouve dans le continuateur de Ducange le
mot conduit pris dans ce fens..
De bien chanter étoit fi durs
Que chanfennettes & conduis,
Chante fi affaitéement, &c.
( M. Ginguené. )
C O N D U IT E ./ ./ C ’e ft, dans un morceau de
mufique , l’art d’agencer une idée principal« avec
le£ idées acceffoires ; de ramener le motif à propos,
fans en abufer ; d enchaîner fes modulations , en
ne leur donnant ni trop , ni trop peu d’étendue.
C eft dans la conduite fur-tout qu’on reconnoît un
compofiteur qui pofféde fon art & qui eft né pour
lui. Le vulgaire appelle mufique favante celle oi^
font enta fiés des accords bizarres, dom l’harmonie
eft recherchée & la marche peu nature’ le : les véritables
muficiens ne regardent comme mufique fac
o N
Vante que celle qui eft bien conduite. Mais dans
ce fens, c’eft un éloge , & dans le premier, c’eft
line expreftion de blâme. Comme fi le favoir pou-
voit jamais être un défaut ! Pour qu’un morceau
de mufique foit bien conduit, il faut n’y pas multi-
les acceffoires , car elles empêchent dé
faifir le motif principal. On manque également de
conduite^ par la monotonie & le défaut d’imagination.
C eft 1 art de bien conduire un deflin qui
en donne la jufte mefure & fait éviter les longueurs.
Cet art eft le fruit de la réflexion 8c de
1 expérience.
On a reproché à la mufique de Gluck de pêcher
par la conduite. Ce reproche eft quelquefois jufte
pour celle où il emploie la parole, & dans laquelle
les motifs manquent quelquefois de développe-
mens ; mais la plupart de fes morceaux de fympho-
nie font parfaitement deflinés. L ’ouverture d’iphi-
génie en Aulide eft un chef-d’oeuvre de conduite.
C eft aufli le mérite particulier du célèbre Haydn.
CONJOINT, adj. Tétracorde conjoint eft , dans
1 ancienne mufique., celui dont la corde la plus
gravq^ eft a l’uniffon de la corde la plus aiguë
du tetracorde qui eft immédiatement au-deffous
de lui; ou dont la corde la plus aiguë eft à l’unif-
lon de la plus grave du tétracorde qui eft immédiatement
au-deffus de lui. Ainfi, dans le fyftême
des Grecs, tous les cinq tétracordes font conjoints
par quelque coté ; favoir, i°. le tétracorde méfon
conjoint au tétraeorde hypaton ; 20. le tétracorde
lynnemenon conjoint au tétracorde méfon ; 30. le
tetracorde hyperboléon conjoint au tétracorde die-
zeugmenon : & comme le tétracorde auquel un
autre etoit conjoint lui étoit conjoint réciproquement
, cela eut fait en tout fix tétracordes ; c’eft-à-
dire, plus qu’il n’y en avoit dans le fWtême, fi
le tetracorde mefon étant conjoint par fes deux
extrémités, n’eut été pris deux fois pour une.
( 7. 7. Rouffeau. )
I] C onjoint, adj. Le fyftême de la mufique ancienne
étoit compofé de quatre tétracordes , f i ut
Te mi, mi fa fol la', f i ut re mi, mï fa fo l la ,
dont le premier 8c le fécond , ainfi que le troi-
tieme & le quatrième étoient conjoints, c’eft à-dire,
avoient la corde mi commune ; au lieu que le
fécond & le troifième étoient disjoints, & n ’avoient
Ç°î^î .^es cordes communes , puifque le fécond
nniffoitpar le fon la , & l e troifième commençoit
par 4e fon fi. ( Voyez Gamme. )
( Dalembert. )
C onjoint. Parmi nous, conjoint fe dit d’un intervalle
ou degré.On appelle degrés conjoints ceux qui
lont tellement difpofés entr’e u x , que le fon le plus
aigu du. degré inférieur fe trouve à Tuniffon du fon
le^plus grave du degiê fiipérieur. 11 faut dé plus
Qu aucun des degrés conjoints ne puiffe être par
fagé en d’aiitresdegrés plus petits, mais qu’ils foieht
C O N 30J
eux ^ mèmès les plus petits qu’il foit poflible ;
favoir , ceux d’une fécondé. Ainfi ces deux intervalles
ut re & re mi, font conjoints ; mais ut re &
fa fol ne le font pas, faute de la première.condition;
ut mi.Sc mi fo l ne le font-pas non plus,
faute de la fécondé.
Marche par degrés conjoints fignifie la même chofc
que marche diatonique. (Voyez Degré, Diatonique.')
( 7. 7. Roujffeau. )
C onjoint. J’avoue que je n’entends rien du
tout à la définition de Rouffeau , (depuis ces mots
parmi nous ) & cela vient, ce me femble , de ce
qu’il emploie intervalle 8c degré comme fynonimes*
Conjoint, félon lu i, fe dit d’un intervalle ou degré.
Mais l'intervalle étant ce qui fépare deux degrés ,
& les degrés étant les deux points extrêmes d’un
intervalle, il eft impofîible de prendre ces deux
mots l’un pour l'autre. Un intervalle conjoint me
paroît une expreftion vide de fens.
« On appelle degrés conjoints , contînue-t-il ,
»s ceux qui font tellement difpofés entr’e ux , que
>5 le fon le plus aigu du degré inférieur fe trouve
>3 à l’uniffbn du fon le plus grave du degré fupé-
>3 rieur, n Rouffeau fuppofe donc qu’un feul degré
contient deux fons, dont l ’un eft plus grave &
l’autre plus aigu.
Les mots échelle, degré, font métaphoriques : qu’on
me permette de les ramener à leur lignification
propre êc de les préfenter fous une image vulgaire.
La gamme, étant formée de fons qui fe
fuivent immédiatement en montant toujours , a été
figurée fous le nom d’une échelle, ( ou efcalier )
compofée de degrés ou d’échelons. Ce qui fépare
le premier degré du fécond , du troifième , dit
huitième , eft ce qu’on appelle intervalle. L’intervalle
eft donc divifible , mais le degré , mais
l’échelon, ne l’eft pas. On ne peut donc attacher
qu’un fon , & non pas plufieurs à chacun de ces
échelons.
« Il faut de plus qu’aucun des degrés con-
»3 joints ne puiffe être partagé en d’autres degrés
» plus petits, 8cc. »
En adoptant pour un moment la divifibilité du
degre que fuppofe Roufteau, & en fubftituant à ce
m o t, dans. fa phrafe, celui d’intervalle, ce qu’il
avance ici ne fera pus encore vrai ; car ut &
re, par exemple, qui font deux degrés conjoints,
peuvent être partagés en d'autres degrés plus petits;
favoir, re b 8c ut #. Il eft vrai que ces cordas ne
font pas de la gamme naturelle d'ut divifée en
échelle ; mais c’eft ce qu’il falloit dire.
a Ainfi ces deux intervalles ut re 8c re mi font
33 conjoints, mais ut re & fa fo l ne le font pas ,
33 faute de la première condition. 33
C ’eft là ce que je ne faurois entendre. Affu-
rément ut re fa fo i , comparés entre eux quatre,
11e font pas conjoints : re &c fa ne le font pas ; mais
$s y