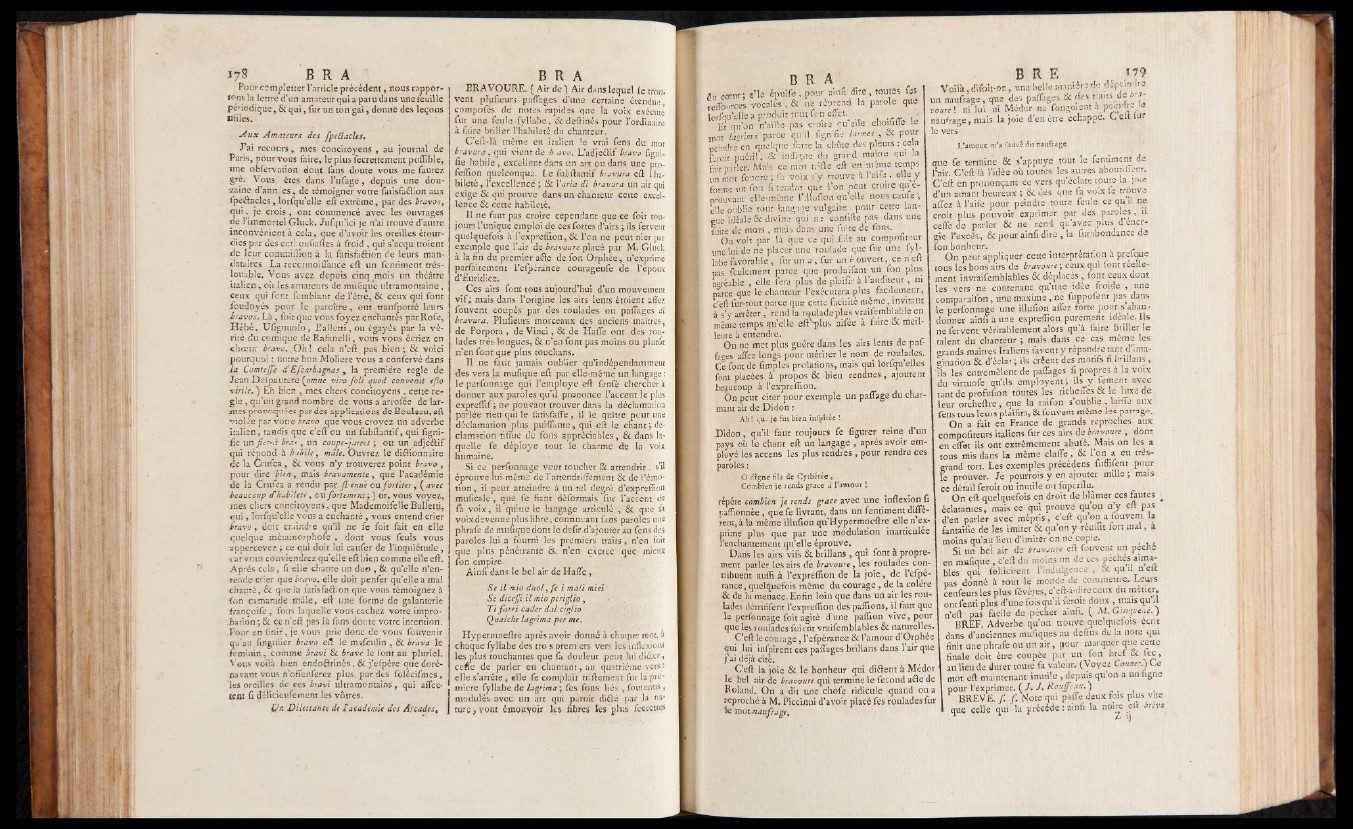
178 B R A
Pour ccmpletter l’article précédent, nous rapportons
la lettre d’un amateur qui a paru dans une feuille
périodique, & qui, fur un ton gai , donné des leçons
utiles.
A u x Amateurs des fpeflacles.
J’ai recours, mes concitoyens , au journal de
Paris, pour vous faire, le plus fecrettement poflible,
une obfervation dont fans doute vous me faurez
gré. Vous êtes dans l’u fage, depuis une douzaine
d’abnfes, de témoigner votre faiisfaélion aux
fpe&acles, lorfqu’elle eft extrême, par des bravos,
q u i, je crois , ont commencé avec les ouvrages
de l’immortel Gluck. Jufqu’ici je n’ai trouvé d’autre
inconvénient à cela, que d’avoir les oreilles étourdies
par des enthoufiaftes à froid , qui s’acquittoient
de leur commiflro.n à la fatisfaéiion de leurs mandataires
La reccnnoiffance eft un fentiment très-
louable. Vous avez depuis cinq mois un théâtre
italien, où les amateurs de muuqiie ultramontaine,
ceux qui font femblant de l’être, & ceux qui font
foudoyés pour le paroîtrè-, ont - tranfporté leurs
bravos. L à , foit que vous foyéz enchantés parRofe,
Hébé, Ufignuolo, Ealletti, ou égayés par la vérité
du comique de Rafàneili, vous vous écriez en
choeur bravo, .Oh! cela n’eft. pas bien; & voici
pourquoi : notre bon Moliere vous a confervé dans
la ComteJJe d 'Efcarbagnas , la première réglé de
Jean Deipautere (omne vira foli quoi convenu efio
virile. ) Eh bien , mes chers concitoyens , cette réglé
, qu’un grand nombre de vous a arrofée de larmes
provoquées par des applications de Bouleau,eft
violée par votre bravo que vous croyez un adverbe
italien, tandis que c’eft ou un fubftantif, qui lignifie
un fier-à bra<, un coupe-jarret ; ou un adjeftif
qui répond à h*bile, mâle. Ouvrez le di&ionnaire
de la Crufca, & vous n’y trouverez point bravo ,
pour dire bien, mais bravamente, que l’académie
de la Crufca a rendu par,Jl:enuè ou fortiter, (avec
beaucoup tf habileté, ou fortement ; ) or, vous voyez,
mes chers concitoyens, que Mademoifelle Balletti,
q u i, lbrfqu’elle vous a enchanté , vous entend crier
bravo, doit craindt e qu’il ne fe foit fait en elle
quelque métamorphole , dont vous feifis vous
appercevez ; ce qui doit lui caufer de l’inquiétude,
car vous conviendrez qu’elle eft bien comme elle eft.
Après cela, fi elle chante un duo , & qu’elle n’entende
crier que bravo, elle doit penfer qu’elle a mal
chanté, & que la latisfaélion que vous témoignez à
fon camarade mâle, eft une forme de galanterie
françoife, fous laquelle vous cachez votre impro-
Jbation ; & ce n’eft pas là fans doute votre intention.
.Four en finir, je vous prie donc de vous fouvenir
qu’au fingulier bravo eft le mafculin , 8c brava le
féminin , comme bravi & brave le font au pluriel.
Vous voilà bien endo&rinés, & j’efpére que dorénavant
vous n’offenferez plus, par des folécifmes,
les oreilles de ees bravi ultramontains, qui affectent
fi délicieufement les vôtres.
Un Dilettante de Facadémie des Arcades,
B R A
BRAVOURE. ( Air de ) Air dans lequel fe trouvent
pliifieurs paffages d une certaine étendue
compofés de notes- rapides que la voix exécute
fur une feule > fyllabe, 8c défila es pour l’ordinaire
à faire briller l’habileté du chanteur.
C ’eft-là meme en italien le vrai fens du mot
b r a v u r a , qui vient de b a v o . L’adjeéHf b ra vo figni-
fie habile , excellent dans un art ou dans une pro-
feflion quelconque. Le fubftantif b ra v u ra efi 1 lia-
bileté, l’excellence ; 8c V a r ia d i b ra v u ra un air qui
exige & qui prouve dans un chanteur cette excellence
8c cette habileté.
Il ne faut pas croire cependant que ce foit toujours
l’unique emploi de ces fortes d’airs ; ils fervent
quelquefois à l’expreffion, & l’cn ne peut nier par
exemple que l’air de b ra vo u r e placé par M. Gluck
à la fin du premier aéle de fon Orphée, n’exprime
parfaitement l’èfpérance courageufe de l’époux
d’Euridice.
Ces airs font tous aujourd’hui d’un mouvement
v if ; mais dans l’origine les airs lents étoient affez
fouvent coupés par des roulades ou paffages di
b ra v u ra . Plusieurs morceaux des anciens maîtres,
de Porpora , de Vinci, & de Haffe ont des roulades
très-longues, & n’en font pas moins ou plutôt
n’en font que plus touchans.
Il ne faut jamais oublier qu’indépendamment
des vers la mufique efi par elle-même un langage :
le perfonnage qui l’employc efi fenfé chercher à
donner aux paroles qu’il prononce l’accent le plus
exprefîif ; ne prouvant trouver dans la déclamation
parlée rien qui le fatisfaffe , il le quitre pour une
déclamation plus puifiante, qui efi le chant ; déclamation
tiffue de fous appréciables, &daps laquelle
fe déployé tout le charme de la voix
humaine.
Si ce perfonnage veut toucher & attendrir. s’il
éprouve lui-même de l’attendriffenient & de l’émotion,
il peut atteindre à un tel degré d’exprefîion
muficale, que fe fiant déformais fur l’accent tic
fa voix , il quitte le langage articulé , & que fa
voix devenue plus libre , continuant fans paroles une
phrafe de mufique dont le defir d’ajouter au fens des
paroles lui a fourni les premiers traits, n’en foit
;que plus pénétrante & n’en exerçe que mieux
fon empire.
Ainfi dans le bel air de Haffe§
S e i l mio d u o f f e i m a l t m ie i
S e d ic e jfi i l m io p e r ig l to ,
T i f a r e i ca d e r d a l c ig lio
Q u a lc h e la g r im a p e r m e .
Hypermnefire après avoir donné à chaque mot, à
chaque fyllabe des tro’s premiers vers les inflexions
les plus touchantes que fa douleur peut lui diéter,
cene de parler en chantant, au quatrième vers.‘
elle s’arrête, elle fe complaît triflement fur la première
fyllabe de l a g r im a ; fes fons liés , foutenus,
modulés avec un art qui paroît diélé par la nature,
vont émouyoir les fibres les plus fecrettcs
B R A
an c c e m e’ ic épulfe , paur ainfi dire , toutes Cas
refîb'trces vocales', & ne reprend la parole que
lorfqu’elle a produit tout fon efiet. ■ ' , •
■ Et qu’on n’aille pas croire c,u elle choifiue le
ri,6t ■ ü g r im r parce qu’il fign’-fi■; U r m â , & polir
pèinc're en quelque forte.la chute des pleurs : ce a
f-roit pucril, & indigne du grand maître qui la
fait parier. Mais ce mot trifle .eft en même temps
un' mot foncre ; fa v oix s y trouve à l’aife . elle y
forme im fon fi tendre que l’on peut croire que-
prouvant elle-même l’ilUifion quelle nous caille',
elle publie tout langage vulgaire. pour cette langue
idéale 8c divine qui ne confifte pas dans une
fuite de mots , mais dans une fnite de fons.
On voit par là que ce qui fait- au compofiteur
une loi de ne placer une roulade que fur une fy llabe
favorable , fur un a , fur un è ouvert, ce n eft
pas feulement parce que produifant un fon plus
agréable , elle fera plus de plaifir à l’auditeur, ni
parce que le chanteur l'exécutera plus facilement, 1
c’éft fur-tout parce que cette facilité même, invitant
à s’y arrêter, rend la roulade plus vraifemblable en
même temps qu’elle eft^plus aifée à faire 8c meilleure
à entendre.
On ne. met plus guère dans les airs lents de paffages
affez longs pour mériter le nom de roulades.
Ce font de fimples prolations, mais qui lorfqu’elles
font placées à propos & bien rendues, ajoutent
beaucoup à l’exprefiion.
On peut citer pour exemple un paffage du charmant
air de Didon :
Ah ï t’U, je fus bien infpirée !
Didon, qu’il faut toujours fe figurer reine d’un
pays où le chant eft un langage , après avoir employé
les accens les plus tendres, pour rendre ces
paroles :
O digne fils de Cythérée,
Combien je rends grâce à l’amour 1
répété com b ie n j e r e n d s grâce avec une inflexion fi |
paflionnèe, que fe livrant, dans un fentiment différent,
à la même illufion qu’Hypermneftre elle n exprime
plus que par une modulation inarticulée
l’enchantement qu’elle éprouve.
Dans les airs vifs & brillans , qui font à proprement
parler les airs de b r a v o u r e , les roulades contribuent
auffi à l’expreffion de la jo ie , de l’efpé-
rance, quelquefois même du courage, de la colère
& de la menace. Enfin loin que dans un air les roulades
détruifent l’expreflion des pallions, il faut que
le perfonnage foit agité d’une paffion vive, pour
que les roulades foierit vraifemblables 8c naturelles.
C’eft le courage, l’efpèrance & l’amour d’Orphée
qui lui infpirent ces paffages brillans dans l’air que
j ai déjà cité.
C’eft la joie & le bonheur qui diélent à Médor
le bel air de b ra vo u r e qui termine le fécond aâe de
Roland. On a dit une chofe ridicule quand on a
reproché à M. Picçinni d’avoir placé fes roulades fur
le ïtiO\.-naufrage%
B R E , »79
V o ilà , dîfoit-on, uno belle manière de clïpçimire
un naufrage , que des paffages & des traits de :a-
voure ! ni lui ni Médor ne fongoieat a peindre le
naufrage, mais la joie d’en être échappe. C elt iur
levers
L’amdut m’a fauve du naufrage
que fe termine & s’appuye tout le fentiment de
l’air. C ’eft-là l’idée où toutes les autres aboimüent.
C ’eft en prononçant ce-vers qu’éclate toute la ]oie
d’un amafit heureux ; & dès que fa voix fe trouve
affez à l’aife pour peindre toute feule ce qu il ne
croit plus pouvoir exprimer par des paroles, u
ceffe de parler & ne rend qu’avec plus .d’énergie
l’excès, & pour ainfi dire , la furabondance de
, fon bonheur. , .
On peut appliquer cette interpretat.on a preique
tous les bons airs de bravoure ; ceux qui font réellement
invraifemblables & déplaces , font ceux dont
les vers ne contenant qu’une idée froide , une
comparaifon , une maxime , ne fuppofent pas dans
le perfonnage une illufion a.flèz forte pour s abandonner
ainfi à une expreflion purement idéale- Ils
ne fervent véritablement alors qu a faire briller le
talent du chanteur mais dans ce cas meme les
grands maîtres Italiens favent y répandretanr d’ima-
gination & d’éclat.; ils créent des motifs fi brillans ,
’ils les entremêlent de paffages fi propres à la voix
du virtuofe qu’ils employent ; ils y fement avec
tant de profufion toutes les richeffes & le luxe de
leur orcheftre, que la raifon s’oublie, larffe aux
fens tous leurs plaifirs,& fouvent même les partage.
On a fait en France de grands reproches aux
compofiteurs italiens fur ces airs de bravoure , dont
i en effet ils ont extrêmement abufé. Mais on les^ a
tous mis dans la même clalfe, & 1 on a eu très-
grand tort. Les exemples précédens fuffifent pour
S prouver. Je pourrois y en ajouter mille ; mais
ce détail feroit ou inutile ou fuperflu.
On eft quelquefois en droit de.blâmer ces fautes ^
éclatantes, mais ce qui prouve qu on n y eft pas
d’en parler avec mépris, c’eft qu’on a fouvent la
fantaifie de les imiter & qu’on y -réuflit fort mal, a
moins qu’au lieu d’imiter on ne copie.
Si un bel air de bravoure eft fouvent un peche
en mufique, c’eft du moins-un de ces péchés aimables
qui foliieitent l’indulgence , ôc qu il n eft
pas donné à tout le monde de commettre. Leurs
cenfeurs les plus févères, c’eft-à-dire ceux du métier,
ontfenti plus d’une fois qu’il feroit doux , mais qu’il
n’eft pas facile de pécher ainfi. ( M. Gingueké. f
BREF. Adverbe qu’on trouve quelquefois écrit
dans d’anciennes mufiques au deffus de la note qui
finit une phrafe ou un air, pour marquer que cette
finale doit être coupée par un fon bref 8c fe c ,
au lieu de durer toute fa valeur. (Voyez Couoer.j C e
Imot eft maintenant inutile , depuis qu on a un ligne
pour l’exprimer. ( / . J. Roujfeau» )
BREVE, y: ƒ . Note qui paffe deux fois plus vite
que celle qui la précède : ainfi la noire eft brève
L q