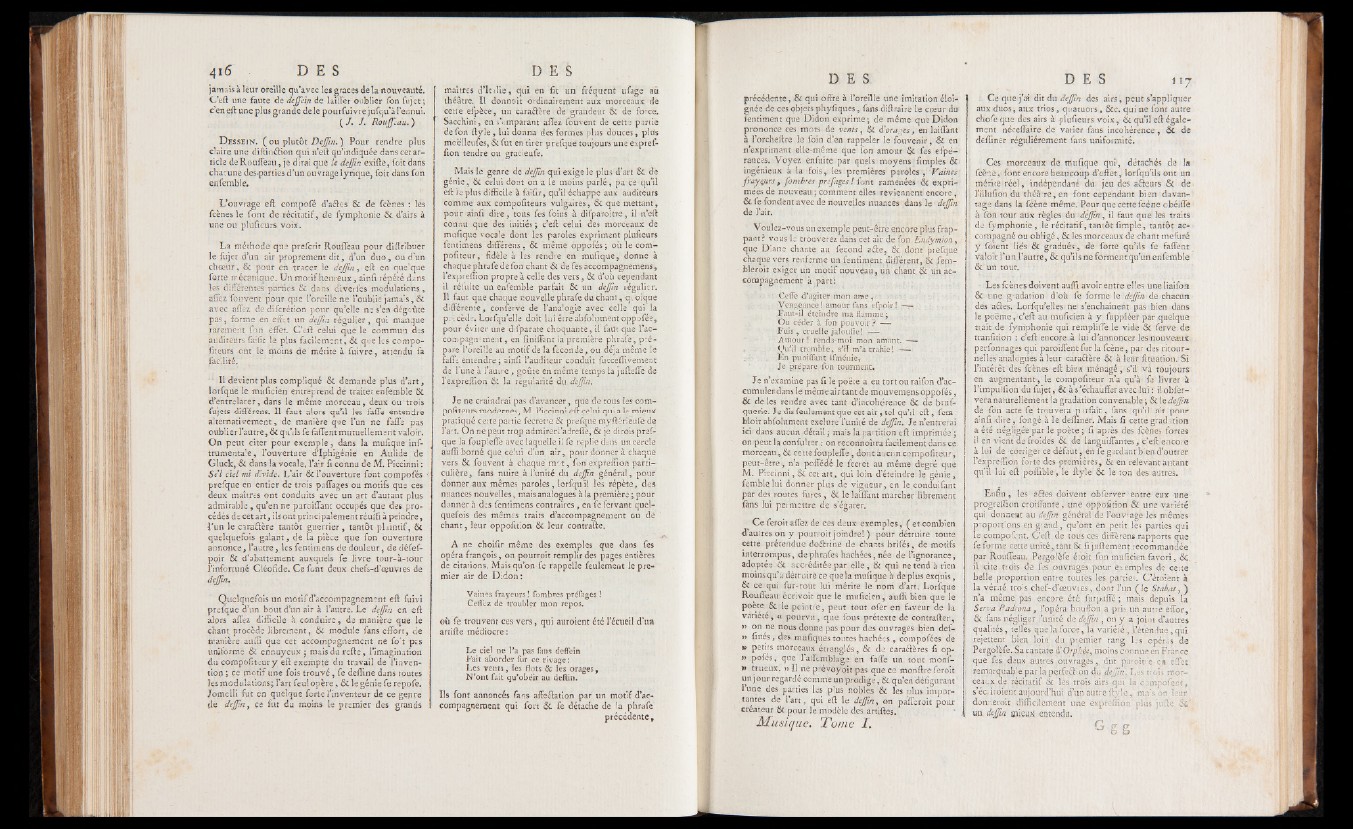
4 x 6 D E S
jamais à leur oreille qu’avec les grâces de la nouveauté.
C ’eft une faute de dejfeip. de lailTer oublier fon fujet;
c’en eft une plus grande de le pourfuivre jufqu’à l’ennui.
( ƒ . J . R o u jfid it.)
D essein. ( ou plutôt D ejjin . ) Pour rendre plus
claire une diftinôion qui n’eft qu’indiquée dans cet article
deRoufleau, je dirai que le dejjin exifte, foit dans
chacune des-parties d’un ouvrage lyrique, foit dans fon
enfemble.
L’ouvrage eft compofé d’aéies & de fcènes : lès
fcènes le font de récitatif, de fymphonie & d’airs à
une ou plufieurs voix.
La méthode que prefcrit Roufleau pour diflribuer
le fujer d’un air proprement dit, d’un duo, ou d’un
choeur, & pour en tracer le d ejjin , eft en quelque
forte mécanique. Un motif heureux, ainfi répété dans
les différentes parties & dans diverfes modulations ,
affez foi ivent pour que l’oreillè ne l’oublie jamais, &
avec allez de diferétion pour qu’elle ne s’en dégoûte
pas, forme en effet un dejjin. régulier, qui manque
rarement fon effet. C ’eft celui que le commun des
auditeurs fa:fit le plus facilement, & que les compo-
fiteurs ont le moins de mérite à fuivre, attendu fa
facilité.
1 II devient plus compliqué & demande plus d’art,
lorfque le muficien entreprend de traiter enfemble &
d’entrelacer, dans le même morceau, deux ou trois
fujets différens. Il faut alors qu’il les fafTe entendre
alternativement, de manière que l’un ne fafTe pas
oublier l’autre, & qu’ils fe fafTent mutuellement valoir.
On peut citer pour exemple, dans la mufique inf-
trumentale, l’ouverture d’Iphigénie en Aulide de
Gluck, & dans la vocale, l’air fi connu de M. Piccinni :
S e l c ie l mi dlvide. L’air & l’ouverture font compofés >
prefque en entier de trois paffages ou motifs que ces
deux maîtres ont conduits ayec un art d’autant plus
admirable , qu’en ne paroiffant occupés que des procédés
de cet art, ils ont principalement réuifl à peindre,
l ’un le earaétère tantôt guerrier, tantôt plaintif, ÔC
quelquefois galant, de la pièce que fon ouverture
annonce, l’autre, les fentimens de douleur, de défef-
poir & d’abattement auxquels fe livre tour-à-tour
l’infortuné Cléofide. Ce font deux chefs-d’oeuvres de
dçjjin.
Quelquefois un motif d’accompagnement eft fuivi
prefque d’un bout d’un air à l’autre. Le dejjin en eft
alors afTez difficile à conduire, de manière que le
chant, procède librement, & module fans effort, de
manière auffi que cet accompagnement ne fo't pts
uniforme & ennuyeux ; mais du refte, l’imagination
du cpmpoflteury eft exempte du travail de l’invention
à çe motif une fois trouvé, fe defîine dans toutes
les modulations; l’art feul opère, & le génie fe repofe.
Jomelli fut en quelque,forte l’inventeur de ce genre
de dejjin t çe fut du moins le premier des grands
D E S
maîtres d’Italie, qui en fit un fréquent ufage au
théâtre. Il donnoit ordinairement aux morceaux de
cette efpèce, un caractère de grandeur & de force.
Sacchini , en s’emparant afTez fouvent de cette partie
de fon fty le , lui donna des formes plus douces, plus
moëlleufes, & fut en tirer prefque toujours une expref-
fion tendre ou gracieufe.
Mais le genre de dejjin qui exige le plus d’art & de
génie, & celui dont on a le moins parlé, pa ce qu’il
eft la plus difficile à faifir, qu’il échappe aux auditeurs
comme aux compofiteurs vulgaires, & que mettant,
pour ainfi dire, tous fes foins à difparoître, il n’eft
connu que des initiés ; c’eft celui des morceaux de
mufique vocale dont les paroles expriment plufieurs
fentimens différens. & même oppofés ; où le com-
pofiteur, fidèle à les rendre en mufique, donne à
chaque phrafe de fon chant & de fes àccompagnemens,
Texpreffion propre à celle des vers, & d’où cependant
il rélulte un enfemble parfait & un dejjin régulier.
Il faut que chaque nouvelle phrafe du chant, quoique
différente, conferve de l’analogie avec celle qui la
précède. Lorfqu’elle doit lui êtreabfolument oppofée,
pour éviter une difparate choquante, il faiït que l’accompagnement,
en finiffent ia première phrafe , prépare
l’oreille au motif de la fécondé, ou déjà même le
fafTe entendre ; ainfi l’auditeur conduit fucceffivement
de l'une à l’auire , goûte en même temps la jufteffe de
Texpreffion & la régularité du dejjin.
Je ne craindrai pas d’avancer, que de tous les compofiteurs
modernes, M. Piccinni eft celui qui a le mieux
pratiqué cette partie fecrette & prefque myftérieufe de
l’art. On ne peut tro.p admirer Ta dreffe, & je dirois prefque
la foupleffe avec laquelle ii fe replie dans un cercle
auffi borné que celui d’un air, pour donner à chaque
vers & fouvent à chaque'mot, fon expreffion particulière,
fans nuire à l’unité du dejjin général , pour
donner aux mêmes paroles, lorfqu’il les répète, des
nuances nouvelles, mais analogues à la première ; pour
donner à des fentimens contraires, en Te fervant quelquefois
des mêmes traits d’accompagnement ou de
chant, leur oppofition & leur contrafte.
A ne choifir même des exemples que dans Tes
opéra françois, on pourroit remplir des pages entières
de citations. Mais qu’on fe rappelle feulement le premier
air de Didon:
Vaines frayeurs! fombres préfages !
Ceifez de troubler mon repos.
où fe trouvent ces vers, qui auroient été l’écueil d'ua
artifte médiocre:
Le ciel ne l’a pas fans deffein
Fait aborder fur ce rivage :
Les vents, fes flots & les orages,
N’ont fait qu’obéir au deftin.
Ils font annoncés fans affectation par un motif d’ac-
çompagnement qui fort & fe détache de la phrafe
précédente v
précédente, & qui offre à l’oreille une imitation éloignée
de ces objets phyfiques, fans diflrairé le coeur du
fentiment que Didon exprime ; de même que Didon
prononce ces mots de vents, & à'oraoes 9 en laiffant
à Torcheftre le foin d’en rappeler le fouvenir, & en
n’exprimant elle-même que fon amour & fes efpé-
rances. Voyez enfuite par quels moyens ; {impies &>
ingénieux à la fois, les premières paroles', Vaines'
fra y eu r s , fombres préfages ! font ramenées & exprimées
de nouveau : comment elles reviennent encore,
& fe fondent avec de nouvelles nuances dans le dejjin
de l’air.
Voulez-vous un exemple peut-être e.ncore plus frappant
? vous-lé trouverez dans cet air de fon Eùdymion,
que Diane chante au fécond aéte, Sc dont prefque
chaque vers renferme un gentiment différent, & fem-
bleroit exiger un motif nouveau , un- chant & un accompagnement'à
part':
■ Ceffe d’agiter mon anse, ■ : •
Vengeance! amour fans efpoir! —7-
jpaut-il éteindre ma flamme;
Ou céder à fon pouvoir? —
Fuis , cruelle jaloufîe ! —
Amour ! rends-moi mon amant. —
Vu’il tremble, s’ il m’a trahie! -4 -^i
, En puniffant lfméniey .
. Je prépare Ton tourment.
Je n’examine pas fi le poète a eu tort ou raifon d’ac-
cumuler dàns le même air tant de mouvemens oppbfés,
& de les rendre avec tant d’incohérence & de bruf-
querie. Je dis feulement que eet air, tel qu’il eft, fem-
bloit abfolument exclure Tunité de dejjin. Je n’entrerai
ici dans aucun détail ; mais la partition eft imprimée ;
on peut la confulter : on reconnoîtra facilement dans ce
morceau, & cette Toupleffe, dont aucun compofiteur,
peut-être , n’a poffédé le fecrèt au même degré que
M. Piccinni, & cet art , qui loin d’éteindre le génie,
femblelui donner plus de vigueur, en le conduifant
par des routes Tures, & le laiffant marcher librement
fans lui permettre de s’égarer.
Ce feroit affez de ces deux exemples, ( et combien
d’autres on y pourroit joindre! ) pour détruire toute
cette prétendue doétrine de chants brifés, de motifs
interrompus, dephrafes hachées, née de l’ignorance,
adoptée & accréditée par elle , & qui ne tend à rien
moins qu’a détruire ce que la mufique à déplus exquis,
& ce qui fur-tout lui mérite le nom d’art. Lorfque
Roufleau écrivoit que le muficien, auffi bien que le
poète & le peintre, peut tout ofer en faveur de la
variété, « pourvu, que fous prétexte de contrafter,
« on ne nous donne pas pour des ouvrages bien def-
n finés, des mufiques toutes hachées , compofées de
» petits morceaux étranglés, & de caraétères fi op-
” pofos, que Tafltmblage en faffe un tout monf-
w trueux. » Il ne prévoyoit pas que ce monftre feroit
un jour regarde comme un prodige , & qu’en défigurant
l’une des parties les plus nobles & les plus importantes
de l’art, qui eft le dejjin, on pafferoit pour
créateur & pour le modèle des artiftes.
Musique. Tome I.
: Ce que j’ai dit du dejjin dés airs, peut s’appliquer
; aux duos, aux trios, quatuors, &c. qui ne font autre
chofe que des, airs à plufieurs voix -, & qu’il eft également
néceffaire de varier fans incohérence, & de
defliner régulièrement fans uniformité.
Ces morceaux de mufique qui', détachés de la
fcèr.é, font encore beaucoup d’effet, lorfqu’ils ont un
mérijeë : réel, indépendant du jeu des aéteurs & de
j. Ti-llufion du théâtre, en font cependant bien davan-
: tage dans la fcène même. Pour que cette fcène obéiffe
! à fon tour aux règ le sd u dejjin, il faut que les traits
| de fymphonie, le récitatif, tantôt fimple, tantôt ac-
| compagné ou obligé, & les morceaux de chant mefuré
î ÿ foient liés & gradués , de forte qu’ils fe fafTent
valoir l’ un l’autre, & qu’ils ne forment qu’un enTemble
- & un tout.
Les fcènes doivent auffi avoir entre elles une liaifon
& une g-adation d’où fe forme 1 e . dejjin de.chacun
des aétes. Lorfqu’elles net s’enchaînent pas bien dans
le poeme, c’eft au muficien à y fuppiéer par quelque
trait de fymphonie qui rempliffe le vide & ferve de
tranfition : c’eft encoreJi lui d’annoncer les nouveaux
•; perfonnages qui paroiffentfur la fcène, par des ritournelles
analogues à leur caractère & à leur fituation. Si
l’intérêt des fcènes- eft bien ménagé,-s’il' va toujours
en augmentant , le compofiteur n’a qu’à fe livrer à
l’impulfion du fujet, & à s’échauffer aveç.lui : ilobfer-
veranaturellement la gradation convenable ; & le dejjin
de fon acte fé trouvera parfait, fans qu’il ait pour
ainfi dire, fongé à le deffinér. Mais fi cette gradation
a été négligée par le poète ; fi après des fcènes fortes
il en vient de froides & de languiflantes , c’eft encore
à lui de corriger ce défaut, éii le gardant bien d’outrer
Texpreffion forte des premières, & en relevant autant
qu’il lui eft poffible, le ftyle & le ton des autres.
Enfin, lès a êtes doivent obferver entre eux une
progreffion croiffante, une oppofition & une variété
qui donnent au dejjm général de l’ouvrage les mêmes
proportions en g;and, qu’ont en petit les parties qui
le compofont. C ’eft de tous ces différens rapports que
fe fo rme cette unité, tant & fi j.uftement recommandée
par Rouffeau. Pergolèfe étoit fon muficien favori, &.
il cite trois de fes,ouvrages pour exemples de cette
belle proportion entre toutès Tes parties. C ’étoient à
la vérité trois chef-d’oeuvies, dont l’un (le Stabat, )
n’a même pas encore été furpafle ; mais depuis la
Serva Padrona , l’opéra bouffon a pris un autre effor,
& fans négliger i’unité de dejjin , on y a joint d’autres
qualités, telles que la force, la variété , l’étendue, qui
rejettent bien loin du premier rang Es opéras de
Pergolèfe. Sa cantate d’Orphée, moins connue en France
que fes deux autres :ouvragesdut pâroîtiV es effet
remarquable par la peiffeéfion du dejjin. Les trois morceaux
de récitatif & les trois airs qui la compofent,
s’éci irotent aujourd’hui d’un autre ftyle, ma's on leur
don-.eroit difficilement une expreffion plus jufte % ’
un dejjin mieux entendu.
G g 'g