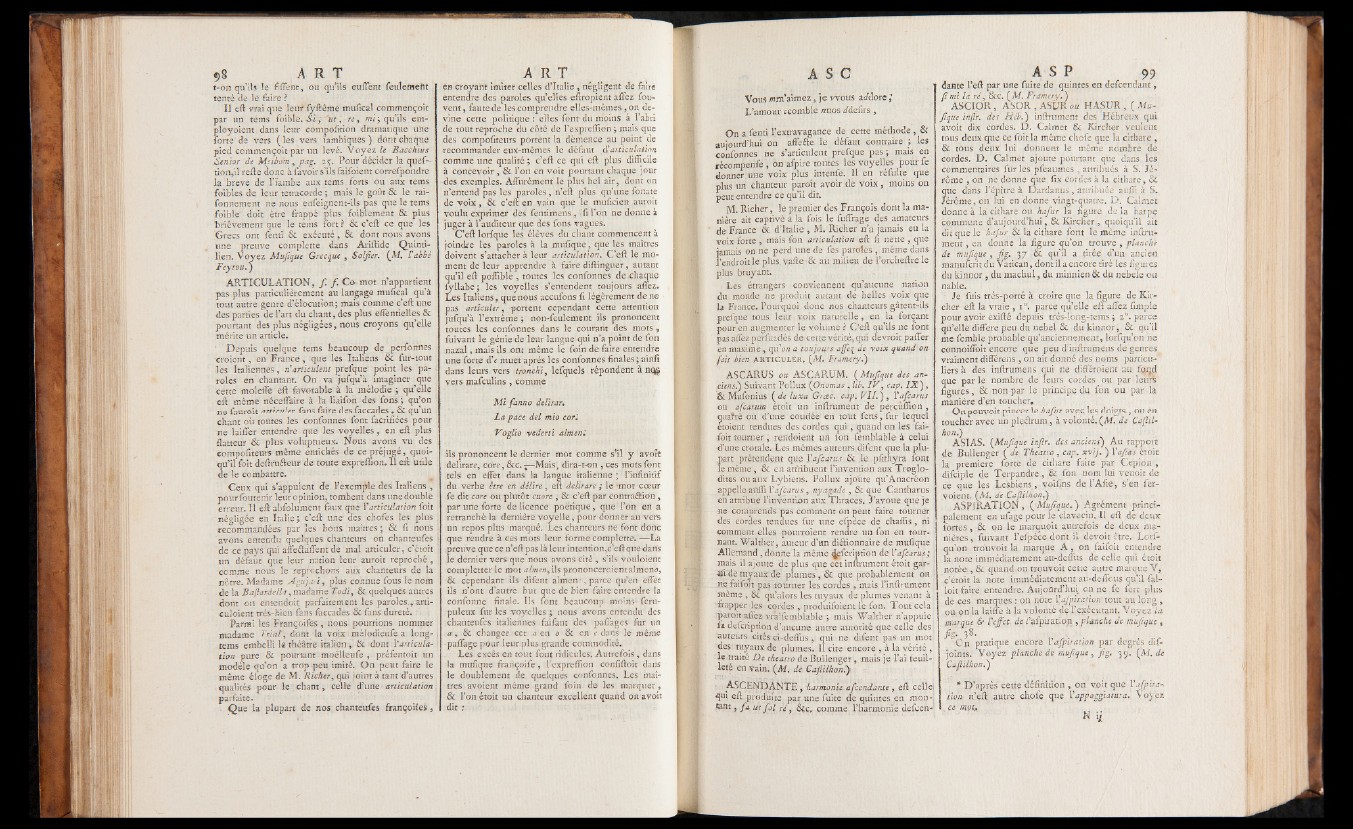
9 8 A R T
t-on qu’ils le fifTeht, ou qu’ils euffent feulefweht
tenté de le faire ?
Il eft vrai que leur fyftême mufical commençoit
par un te ms foible. S i ; u t , re, mi; qu’ils em-
ployoient dans leur composition dramatique une
forte de vers ( les vers ïambiques ) dont Ghaque
pied commençait par un levé. V o y e z le Bacchïus
Senior de Msibim, pag. 25. Pour décider la quef--
tionÿl relie donc à favoir s’ils Faifoient correfpondre
la breve de l’ïambe aux tems Torts ou aux tems
foibles de leur tetracorde ; mais le goût & le rai-
fonnement ne nous enfeignent-ils pas que le tems
foible' doit être frappé plus foiblement & plus
brièvement que le tems fort ? ■ & c’eft ce que les
Grecs ont fenti & exécuté, & dont nous avons
une preuve complette dans Ariftide Quinti-
lien. Vo yez Mufique Grecque , Solfier. (Ai. l'abbé
Fey tou. )
A R T IC U L A T IO N , ƒ. /. Ce- mot n’appartient
pas plus particulièrement au langage mufical qu’à
tout autre genre d’élocution; mais comme c’efl: une
des parties de l’art du chant, des plus effentielles &
pourtant des plus négligées, nous croyons qu’elle
mérite un article.
Depuis quelque tems beaucoup de perfonnes
croient, en France, que les Italiens & fur-tout
les Italiennes, narticulent prefque point les paroles
en chantant. On va jufqu’à imaginer que
cette moleffe eft favorable à la mélodie ; qu’elle
eft même néceflaire à la liaifon des fons ; qu’on
ne fauroit articuler fans faire des faccades , & qu’un
chant où toutes les confonnes font facrifiées pour
ne laifler entendre que les v oy elles , en eft plus
flatteur & plus voluptueux. Nous avons vu des
eompoftteurs même entichés de ce préjugé, quoiqu’il
foit deftru&eur de toute expreffton. 11 eft utile
de le combattre.
Ceux qui s’appuient de Fexemple des Italiens ,
pourfoutenir leur opinion, tombent dans une double
erreur. Il eft abfolument faux que Iyarticulation foit
négligée en Italie ; c’eft une des choies les plus
recommandées par les bons maîtres ; & fi nous
avons entendu quelques chanteurs où chanteufes
de ce pays'qui affeélaflentde mal articuler, c’étoit
un défaut que leur nation leur auroit reproché ,
comme nous le reprochons aux chanteurs de la
notre. Madame ~-dguja:< i , plus connue fous le nom
de la B afar délia, madame Todi, & quelques autres
dont 011 entendoit parfaitement les paroles., arti-
culoient très-bien fans-faccades & fans dureté. n
Parmi les Françoifës , nous pourrions nommer
madame T r ia l 9 dont la voix mélodieufe a long-
tems embelli îé théâtre italien y & dont A'articulation
pure & pourtant moëlleufe , préfentoit un
modèle qu’on a trop peu imité. On peut faire le
même éloge de M. Richer, qui joint à tant d’autres
qualités pour le chant, celle d’unq articulation
parfaite.
Que la plupart de nos, chanteufes françoifes,
A R T
en croyant imiter celles d’Italie, négligent de faire
entendre des paroles qu’elles eftropient allez fou-
vent, faute de les comprendre elles-mêmes, on devine
cette politique : elles font du moins à l’abri
de tout reproche du côté de l’expreflion ; mais que
des eompoftteurs portent la démence au point de
recommander eux-mêmes le défaut fié articulation
comme une qualité ; c’eft ce qui eft plus difficile
à concevoir , & l’on en voit pourtant chaque jour
des exemples. Aflùrément le plus bel air, dont on
n’entend pas les paroles, n’eft plus qu’une fonate
de voix , & c’eft en vain qiie le mufteien auroit
voulu exprimer des fentimens , fft l’on ne donne à
juger à l’auditeur que des fons vagues.
C ’eft lorfque les élèves du chant commencent à
joindre les paroles à la muftque, que les maîtres
doivent s’attacher à leur articulation. C ’eft le moment
de leur apprendre à faire diftinguer, autant
qu’il eft poflible , toutes les confonnes de-chaque
ly llabe; les voyelles s’entendent toujours affez.
Les Italiens, que nous accufons fi légèrement de ne
pas articuler, portent cependant cette attention
jufqu’à l’extrême ; non-feulement ils prononcent
toutes les confonnes dans le courant des mots ,
fuivant le génie de leur langue qui n’a point de fou
nazal, mais ils ont même le foin de faire entendre
une forte tfe muet après les confonnes finales ; ainfi
dans leurs vers tronchi, lefquels répondent ànqg»
vers jnafculins, comme
Mi fanno deVtrar*
La pace del mio corl
Vogtio vederti almenl
ils prononcent le dernier mot comme s’il y avoît
delirare, edre, & c. — Mais, dira-t-on , cés mots font
tels en effet dans là langue italienne : l’infinitif
du verbe être en délire , eft detirare ; le *mot coeur
fe dit core ou plutôt cuore , & c’eft par contraélion,
par une forte de licence poétique, que l’on en a
retranché la dernière voy e lle , pour donner au vers
un repos plus marqué. Les chanteurs ne font donc
•que rendre à .ces mots leur forme complette* — La
preuve que ce n’eft pas là leur intention,c’eft que dans
le dernier vers que nous avons cité , s’ils vouloient
completter le mot almen, ils pronenceroientalmem?,
& cependant ils difent almen r, parce qu’en- effet
ils n’ont d’autre but que de bien faire entendre là
confonne finale. Us font beaucoup- moins* feru-
puleux fur les voyelles ; nous avons entendu des
chanteufes italiennes . faifant des paffages fur un
■ a , & changer cet a en 0 & en e dans le même
pafifage pour leur plus grande commodité.
Les excès en tout font ridicules. Autrefois , dans
la muftque frariçoife, l'expreflion confiftoit dans
le doublement de quelques confonnes. Les maîtres
avoient même grand foin de les marquer,
& l ’on étoit un chanteur excellent quand on avoit
dit : .
A S C
Vous mm’aimez, je vvous a^dore ?
L ’amour ccomble «nos </defirs ,
On a fenti l’extravagance de cette méthode, &
aujourd’hui on affeéle le défaut contraire ; les
confonnes ne s’articulent prefque pas ; mais en
récompenfe , on afpire toutes les voyelles pourfe
donner:une voix plus intenfe. H en réfulte que
plus un chanteur paroît avoirjde v o ix , moins on
peut entendre ce qu’il dit.
M. Richer, le premier des François dont la manière
ait captivé à la fois le fuffrage des amateurs
de France & d’Italie , M. Richer n’a jamais eu la ;
voix forte, mais fon articulation eft fi nette , qué !
jamais on ne perd une de fes paroles , même dans .
l ’endroit le plus. vafte & au milieu de l’orcheftrele
plus bruyant.
Les étrangers conviennent qu’aucune nation
du monde ne produit autant de belles -voix que
la France. Pourquoi donc nos chanteurs gâtent-ils
prefque tous leur voix naturelle, en la forçant :
pour en augmenter le volume ? C ’eft qu’ils ne fo n t .
pas affez perfuadés de cette vérité, qui dëvroit paffer j
en maxime, qu’0/2 a toujours affe^ de voix quand on
fait bien ARTICULER. (M. Framery.)
ASCARUS ou ASCARUM. ( Mufique des anciens.)
Suivant Pollux ( Onomas , lïb. IV ^ cap. IX ) ,
& Mufonius ( de luxa Grcec. cap. V I I .) , Yafcarus
ou afearum étoit un infiniment de percùflion ,
qualré ou d’une coudée en tout fens, fur lequel
etoient tendues des cordes q u i, quand on les fai- ’
foit tourner, reridoient un ion femblable à celui
d’une crotale. Les mêmes auteurs difent que la plupart
prétendent que Yafcarus & .le pfithyra font
le même, & en attribuent l’invention aux Troglo-
dites ou aux Lybiens. Pollux ajoute qu’Anacréon ;
appelle aiiffi Yafcarus , nyagade , & que Cantharus
en attribue l’invention aux Thraces. J’avoue que je ;
ne comprends pas comment on peut faire tourner
des cordes tendues fur une éfpèce de chaflis, ni
comment elles pourroient rendre un fon en tournant.
Walther, auteur d’un dictionnaire de mufique
Allemand , donne la même ^feription de Yafcarus ;
mais il ajoute de plus que cet infiniment étoit gar- ;
ffli'de tuyaux de plumes, & que probablement on
11e faifoit pas tourner les cordes , mais l’inftrument
même , & qu’aîors les tuyaux de plumes venant à
frapper les cordes produifoient le fon. Tout cela:
paroît aflez vraîfcmblable ; mais Walther n’appuie
i l defeription d’aucune autre autorité que celle des j
auteurs cités ci-deflùs , qui ne difent pas un mot
des' tuyaux de plumes. Il cite encore , à la vérité ,
le traité De theatro de Bullenger , mais je l’ai feuilleté
en vain. (A/, de Caflilhonl)
A S P 99
dante l’eft par une fuite de quintes, en defeendant,
fi mi la ré, &c. ( Af. Framery. )
A S C IO R , ASOR , ASÛR ou HASUR , ( Mufique
infir. des Hêb.) infiniment des Hébreux qui
avoit dix cordes. D». Calmet & Kircher veulent
tous deux que ce foit la même chofe que la cithare ,
& tous deux lui donnent le même nombre de
cordes. D. Calmet ajoute pourtant que dans les
commentaires fur les pfeaumes , attribués à S. Jérôme
, on ne donne que fix cordes à la cithare, &
que dans l ’épître à Dardanus, attribuée aufil à S.
Jérôme, on lui en donne vingt-quatre. D. Calmet
donne à la cithare ou hafur la figure de la harpe
commune d’aujourd’hui, & Kircher , quoiqu’il ait
dit que le hafur & la cithare font le même infiniment
, en donne la figuré qu’011 trouve , planche
de mufique , fig. 3 7 . & qu’il a tirée d’un ancien
manuferit du Vatican, dont il a encore tiré les figures
du kinnor, du machul, du minnien & du nebele ou
nable.
Je fuis très-porté à croire que la figure de Kircher
eft la vraie , i°. parce qu’elle eft affez fiinple
pour avoir exifté depuis très-iong-tems ; z°. parce
qu’elle différé peu du nebel & du kinnor , & qu’il
me femble probable qu’anciennement, lorfqu’on ne
connoifToit encore que peu d’inftrumens de genres
vraiment differens , on ait donné des noms particuliers
à des inftrumens qui ne différoient au fqqd
que par le nombre de leurs cordes ou par ienrè
figures, & non par le principe du fon ou par la
manière d’en toucher.
On pouvoit pincer le hafur avec les doigts , ou en
toucher avec un plçârum, à volonté. (Ai. de Caflilhon.)
ASIAS. (.Mufique infir. des anciens) Au rapport
de Bullenger ( de Theatro, cap. xvij. ) Yafias étoit
la première forte de cithare faite par Cepion ,
difciple de Terpandre, & fon nom lui venoit de
ce que les Lesbiens, voifins d e l ’Afie, s’en fer-
voient. (Ai. de Caftilhon.)
A S P IR A T IO N , Q Mufique,.) Agrément principalement
en ufage pour le clavecin. Il eft de" deux
fortes , • & on le marquoit autrefois de deux manières,
fuivant l ’efpèce dont il devoit être. Lorfqu’on
troùvoit la marque A , on faifoit entendre
la note immédiatement au-defîùs de celle qui étoit
notée., 8c quand on troùvoit cette autre marque V ,
c’étoit la note immédiatement aii-deffous qu’il falloir
faire entendre. Aujoflrd’hui en ne fe fert plus
de ces marques .: on note Ya/piration tout au long ,
ou, on la lame à la volonté de Pexécutant. Vo yez la
m'arque & l'effet de fafpiratiap , planche de mufique ,
fig. 38. , '
On pratique encore Yafpiration par degrés disjoints.
Vo yez planche de mufique , fig. 39. (Ai. de
Çafiilhon.)
r. a s c e n d a n t e , harmonie ascendante , eft cellei
qui eft produire par une fuite de quintes .en moù-j
tou t, fa ut fo l ré, ôçç, çomme l ’harmonie defeen-
* D ’après cette définition > °n voit que Vafpira-.
lion n’çft autfe chofe que Yappoggiatura. Voyez
çe mçu
N ii