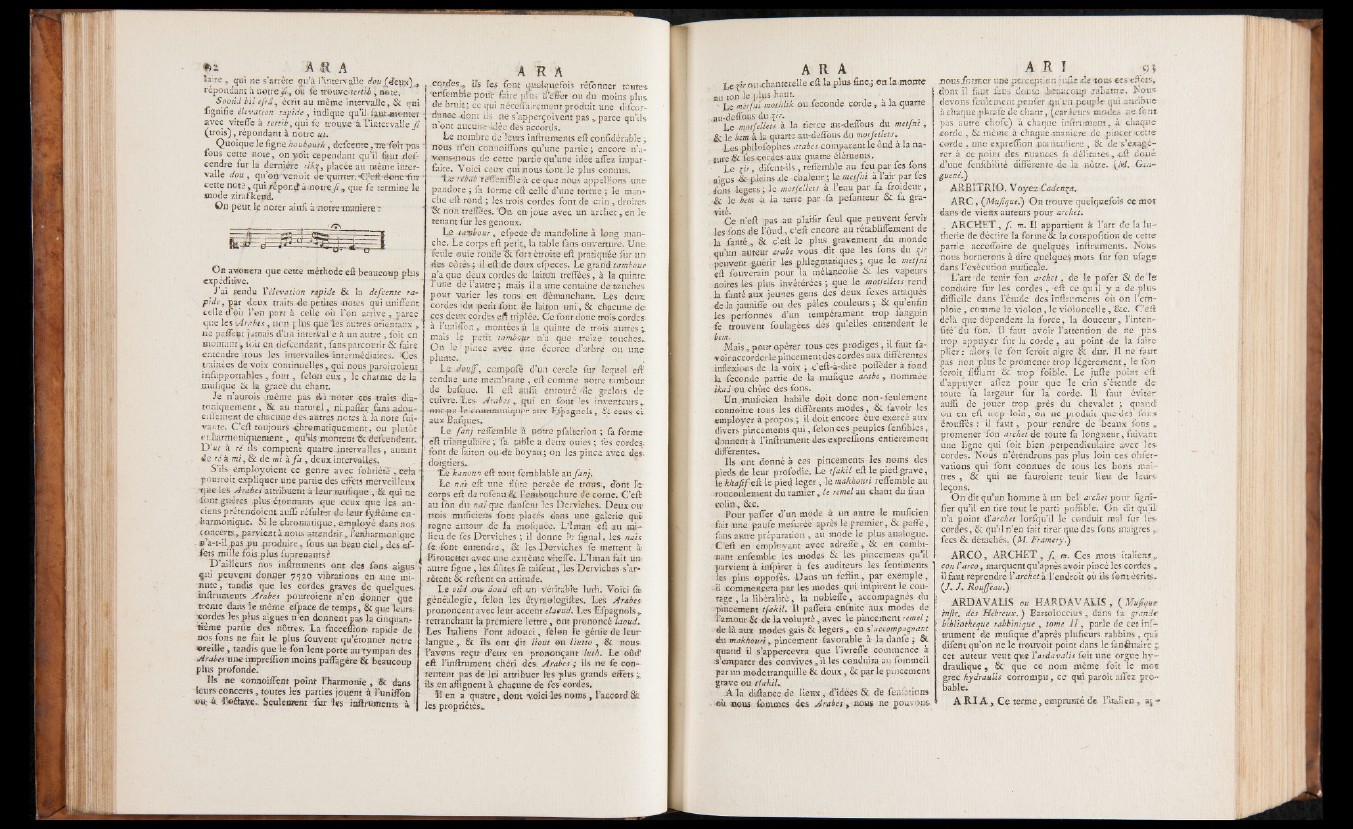
A R A
laire , qui ne s’arrête qu’à l'intervalle
répondant à notre f i y Où fe ikoxfroherFib » note.
Sooiîd bil efrà, écrit au même intervalle, & qui
lignifieélévation rapide, indique qu’il, fâjatjaî-emer
avec vîtetfc à tertib, qui fc trouve àt l’intervalle f i
(trois), répondant à notre u,t.
Quoique le ligne koubouth, defcerîte ,T[e*fbit pas
fous cette no te , on yoit cependant qu’il font def-
eendre fur la dernijère r ik ^, placée au même intervalle
dou , qu’on-ven oit de 'qurrter. *Cfeft‘dont *ftrr
cette note » qui/épor.çfàmétréf i que fe termine le
mode zirafkeyrd.
On peut le noter aiirii à notre •maniéré/:.
On avouera que cette méthode eft beaucoup plus
expéditive.
J’ai rendu Félévation rapide & la defeente rapide
, par deux traits de petites-notes qui unifient
celle d’éù l’on part à celle où l’on arrive a parce
que les 'Arabes , non pliis que'les autres orientaux ,.'
ne palTe^t jamais d’im interVal'e à un autre , foit en
montant, l'oit en defeendant, fans parcourir & faire
entendre -tous les intervalle* intermédiaires. C e s
traînées de voix continuelles,, qui nousparoîtreient
iqfupponables , fo n t , félon eu x ,Te charme de la ’
mufique .& la grâce du chant.
Je n’aurois .même pas d i 'noter ces traie dia-î
toniquement, 8c au. naturel., nipaÛer fàns.admi- .
eiffemeat de chacune des-autres notes à la note fui-
vante. C ’eft toujours ‘chromatiquement, ou plutôt
riihflrmoniqHetaent, qu’ils montent i k tféfcendent* 1
D ’k/ à ré ils comptent quatre intervalles , autant
de ré à miy & de. mi à fa , deux intervalles.
S’ils ejnployoient ce genre avec fobriéte ,,ceh ‘
pourroit expliquer une partie des effets merveilleux
-que les Arabes attribuent à leur-njurique , & qui ne
Sont gué res ,plus étonnants :que ceux que les anciens
prétendoient auffi téfulter de leur fyMme enharmonique.
Si le chromatique » employé dans n os
concerts., parvient à nous attendrir , l’enharmonique
n’a-t-il pas pu produire, fous un beau c ie l , des effets
mille fois plus {«prenants ?
p ’ailléurs nos infiruments ont de« ions aigus
qui peuvent donner 7520 vibrations en -une minute
, tandis que. les cordes graves de quelques
ïnftnunents Arabes pourroient n’en donner que
trente dans le même efpace de temps, & que leurs; :
•cordes les plus aigues n’en donnent pas la cinquaa-
tième partie des nôtres. La fticcéffîon> rapide de
nos fons ne fait le plus fouvent qu’etopner notre
« reille, tandis que le fon lent porte au tympan des
A robes une impreiTion moins paffagère & beaucoup
plus profonde*
Ils ne conaoi/fent point l’harmonie 1 & dans
leurs concerts » toutes les parties jouent à l ’uniffon
«u; -à ’Foftave». Seulement 'fur les iaftruments à j
A H A
cordes,, ils les. font quelquefois rêfonner toutes
'eiîfemfrle pour faire pfus cTdfet ou du moins plus
cre bruit; ce qui néceffaircment produit une difeor-
danee dont ils ne s’apperçoivent pas » parce qu’ils
n ont aucune -idée des accords»
Le nombre de’leurs mftruments eft confîdérable ;
nous n”en connoiffons qu’une partie ; encore n’a-
vonsiiious de cette partie' qu’une idée affez imparfaite.
Voici ceux qui nous font :1e plus connus.
Le- r&rfb reffemolelà c e que nous appellions une
pandore ; fa forme eft celle d’une tortue. ; le manche
efl rond ; les trois cordes font de crin , droites:
: 3c non trëffêes. 'On- en joue avec un. archet » en le
tenant fur les genoux.
Le tambour, efpeae de mandoline à long man-
; che. Le corps eft petit;, la table fans-ouverture. Une
feiile ouïe ronde '‘Sc forir étroite efl pratiquée fur un
des côtés.; .ileftde deux efpeces. Le grand tambour
n’a que deux cordes de laiton treffées, à l'a quinte;
Fune de l’autre ; mais il a une centaine de touches
pour varier les tons en démanchant. Les deux
cordes tdu petit font de laiton vmi:, & chacune de
pes deux cordes eft triplée. Ce font donc trois cordes
à l’uniffon, montées jà la quinte de trois autres ;.
mais Ip petit \tnmbopr n’a que- treize touches.
On le < pince avec- une écorce d’ar-brë ou une-
■ plume.,
l e douf, compofé d’un cercle fur lequel eft
tendus une membrane , eft comme notre tambour
de banque. Il eft aiiffi- entouré 41e grelots, de
cuivre. L e s Arabes , qui' en fo n t ’es inventeurs
. '©nt-pu'le-GOîiïrmuîîquer aux Espagnols,. 8c ceux-ci
aux Banques.
Le fanj reffembîe là notre pfaîterion ; fa forme-
, eft triangulaire ; 'fa table a deux ouies ; fes cordes
:! font dfe laiton ou-de boyau.; on les pince, avec, des
dôigtiers.
; ‘Le kanoun eft tout femblafclé au fanp.
Le naï- eft une flûte percée de trous;, dont fe
corps eft de rofeau& Fembouchure de corne.C’efl
au fon dit naï que d’anfénî les Derviches. Deux où;
trois mufîcieiis font placés dans une galerie quii
régné autour de la molquée. L’Iman eft au milieu;
de fès Derviches ; il donne !b fignal, les nais
fe. »font entendre ., &c l'es Derviches fe mettent à*
Pirouetter avec une .extrême vrteffe. L’Iman fait un<
autre ligne » lies flûtes fë taifent , les Derviches s'arrêtent
® relient en atdfude.
Le oû’d .ou» âoud eft .un véritabfe luth. Voici fâ
généalogie, félon les êtyraolqgiftes. Les Arabes-.
prononcent avec leur accent claeud. Les Efpagnols»
retranchant la première lettre, ont prononcé laoud..
Les Italiens Font adouci, félon î'e génie de leur
langue y & ris ont dit liout ©u. liutto , & nous-
l ’avons reçu d’eux on prononçant luth. Le oûd*
eft l’inftrujnent chéri de9. Arabes ; ils ne fe contentent
pas de lqi attribuer les plus grands effets ^
Us en alignent à chacune de fes cordes.
ï l en a quatre, dont voici les.noms , l’aficord âè
lés propriétés^
A R A
Xrf.çirmi.claasiterelle efi 1» plusfine^ on I*. mante
au ton Je iaut. -
- Le mit fia mochlih ou leconde corde, a ,1a quarte
.sui-deffous du fir.
Le nwtfilleu à -la tierce an-deffous du metjm ,
. & .le iem .à la quarteau.deiTqus du moifillets.^
•Les -plidoCqphe&ural’rr comparentlé ôudà la na-
, *ure&. fesçer.des aux quatre élénjeuts.
Le fii r dilent-ils , reffemhle au feu .par Tes fons
aigus pleins de clialeur j l e metfiii à l.air par fes
fons legets ; le motfiiUis à l’eau par .fa froideur ,
C e n’eft ;pas an piaifir feul que peuvent fervir
les fous .de J j jp L c’edl encore au rétabliffement de
la fanté., & c’eft le plus gravement du monde
qu’un auteur arabe vous dit que -les fous du fir
peuvent -guérir les phlegmadques > que le metjni
eft fouverain pour la mélancolie &L les vapeurs
noires les plus invétérées; que le matfelleis rend
la fanté aux jeunes gens des deux fexes attaqués
de.k.jaunifle ou des pâles ocmleurs; &.qu’enfin
les perfonnes d’un tempérament trop Lui gui n
fe trouvent foulage es dès quelles entendent le
beni. i
Mais , pour opérer tous ces prodiges , il faut fa-
■ voiraccorder le pincement des cordes aux differentes
.inflesdous de .la voix ; .c’eft-à-dire pofleder à fond
la ifefionde panie de la mufique arabe , nommée
ikaâ ou cbûie des fons.
Un. muficien habile doit donc non-feulement
eonnoître tous les différents modes , &. favoîr les
employer à propos ; il doit encore être exerce aux
divers pincements q u i, félon ces peuples fenfihles,
donnent à l’infirument des exprelfions entièrement
différentes.
Ils ont donné à ces pincements les noms des
pieds de leur profodie. Le tfakil efl le pied grave,
le khajife& le pied léger, le makhomi reffemble au
roucoulement du ramier > le retnel au chant du fa n
colin., Sic.
Pour paffer d'un mode à un antre le muficien
fait une paufe meferée' après le premier, Si pafle,
fans autre préparation , au mode le plus analogue.
C ’eft en employant avec adrefle » Si en combinant
enfenrble les modes Si les pincemens qu*il
parvient à infpirer à fes auditeurs les fentiments
les plus eppofés. Dans un feftin., par exemple,
Il commencera par les modes qui infpirent le courage
, la libéralité, la nobleffe, accompagnés du
pincement tfakil. Il paflëra enfuite aux modes de
xamour Si de la volupté, avec le pincement remet ;
de là aux modes gais 8i légers, en s’accompagnant
du makhouri, pincement favorable à la danfe ; &
quand il s’appercevra que i ivrelTe commence a
s ’emparer des convives, il les conduira au fommeil
par un mode.tranquille & doux, Si par le pincemens
grave ou tfakil. .
A la diflance de lieux, d’idées Si de fenfations
où nous femmes des Arabes f nous ne pouvons*
A R I 9 5
nous former une perception j. rJlc .de <tous ecs «ftc-ts,
.dont il faut fans don lu bÆauxotip rabattre. Nous-
devons feulement p en fer qu'un peuple qu-i.auribue
à chaque .phrafe de ch ant, (.canleurs modes ne fon t
pas autre chofe) a chaque în ftm msn t, à chaque
cor.de , & même à chaque .maniéré de pincer ce tte
corde., une expreflion .paniculierc , 8c de s’ex a g é rer
à ce point .des nuances ft dé licates, eft d ou é
d’une fenfibilité différente de la nôtre. (M. Gin-
#ucné.)
AR B ITR IO . Voyez, Cadença.
A R C , (Mufique.') On trouve quelquefois ce mot
dans:de vieux auteurs pour archet.
. A R CH E T , f . m. Il appartient à l’art de la lutherie
de décrire la forme oc la compofition de cette
partie acceftbire de quelques inftrwments. Nous-
nous bornerons à dire quelques mots fur fon triage
dans l ’exécution muficme.
L ’art de tenir fon archet, de le pofer 3c de l e
conduire fur les cordes » ;eft ce qu'il y a de plus
difficile dans l ’étude des înftrnments où on l’emploie
, .comme le violon, le violoncelle, ‘&c. C ’éft
delà que dépendent la force, la douceur, l’infen-
friéTlu fon. 11 faut avoir l ’attention de ne pas
trop appuyer fur la corde , au point de la faire
plier: alors le fon feroit aigre/3c dur. 11 ne faut
pas non plus le promener trop légèrement, le fon-
feroit limant & trop foi'ble. Le jufte point eft:
d’appuyer affez pour que le crin s'étende de
toute fà largeur fur la corde. I l faut éviter
auffi de jouer trop près du chevalet ; qnancl
on en eft trop loin, ©n ne produit que des fons
étouffés : il fa u t, pour rendre de beaux fons ,
promener fon archet de toute fa longueur, fuivant
une ligne qui foit bien perpendiculaire a-vee les
cordes. ‘Nous n’étendrons pas plus loin ces ôbfer-
varions qui font connues de tous les bons maî tres
, & qui ne fauroient tenir lieu de leurs
leçons.
On dit qu’un homme à un bel archet pour lignifier
qu’il en tire tout le parti poffible. On dit qu’il
n’a point Üarchet lorfqifil le conduit mal fur les
cordes, & qu’il n’en fait tirer que des;fons maigres y
fecs & détachés. (M. Framery.)
A R C O , ARCHET , f . m. Ces mots italiens v
con l'arco, marquent qu’après avoir pincé les cordes y
11 faut reprendre Varchetia Fendroit où ils font écrits*
(ƒ* J. Roujfeau.)
A RD A V A L IS M KA R D A V A L IS , (Mufique’
injlr. dés Hébreux. ) Bartoloccius, dans fa grande’
bibliothèque rabbinique , tome I I , parle de cet inf-
trument dé mufique d’après phriieurs rabbins , qui
difent qu’on ne le trouvoit point dans le fanôuaire y
cet auteur veut que Yardavalis foit une orgue hydraulique
, & que ce nom même foit le mot
grec hydraulis corrompu, c e qui paroît affez probable
»
A RJ À , Ce terme, emprunte de ritidiena; r