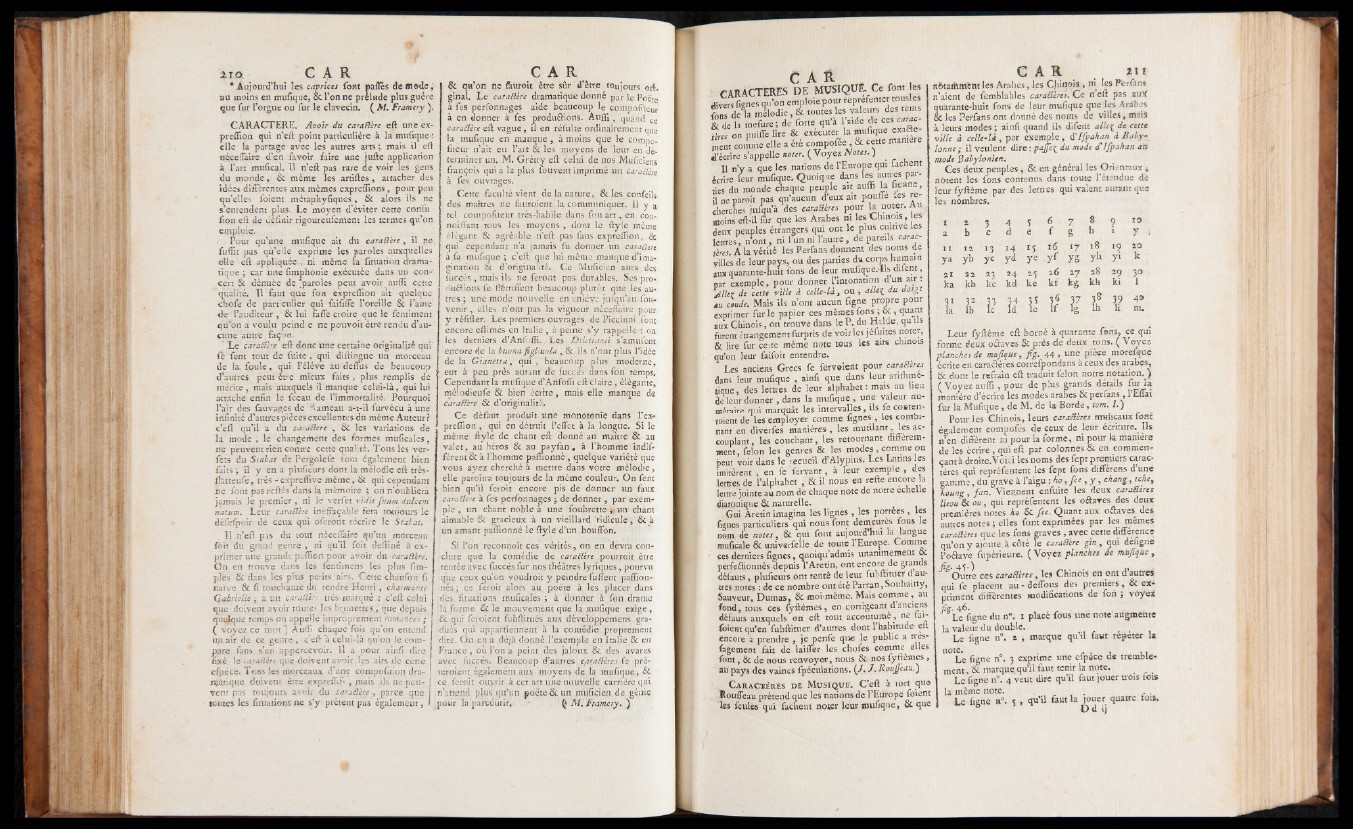
i m C A R
* Aujourd’hui les caprices font paflês de m ode,
au moins en mufique, & l’on ne prélude plus guère
que fur l’orgue ou fur le clavecin. ( M. Framery ).
CARACTERE. Avoir du caraSlère eft une ex-
preflion qui n’eft point particulière à la mufique :
elle la partage avec les autres arts ; mais il eft
néce(Taire d’en favoir faire une jufte application
à l’art mufical. Il n’ eft pas rare de voir les gens
du monde, & même les artiftes, attacher des
idées différentes aux mêmes expreflions, pour peu
qu’elles foient métaphyfiques, & alors ils ne
s’entendent plus. Le moyen d’éviter cette confu
fi on eft de définir rigoureufement les termes qu’on
emploie.
/ Pour qu’une muftque ait du caractère, il ne
fuffit pas qù’e'le exprime les paroles auxquelles
elle eft appliquée , ni même la fttuation dramatique
; car une {imphonie exécutée dans un concert
& dénuée de 'paroles peut avoir auflf cette
qualité. 11 faut que foa expreffion ait quelque
cuofe de particulier qui faififle l’oreille & lame
de l’auditeur , 8c lui rafle croire que le fentiment
qu’on a voulu peindre ne pouvoit être rendu d’aucune
autre Façon,
Le caraSlère eft donc une certaine originalité qui
fè font tout de fuite , qui diftineue un morceau
de la. foule, qui l’éléve au defîus de beaucoup
tfautres peut être mieux faits , plus remplis de
mérite ,- mais auxquels il manqué celui-là, qui lui
attache enfin le fceau de l’immortalité. Pourquoi
l ’air des fauvages de Hameau a-t-il furvécu à une
infinité d’autres pièces excellentes du même Auteur?
c’eft qu’il a du caraSlere , & les variations de
la mode , le changement des formes muficales,
ne peuvent rien contre Cette qualité. Tous les ver-
fets du St abat de Pergolefe font également bien
faits ; il y en a plufieurs dont la mélodie eft très-
ffatteufe, très - expreflive mêm e & qui cependant
ne font pas reftés dans la mémoire ; oh n’oubliera
jamais le premier * ni le verfet vidit fuum dulcem
natum. Leur caraSlère ineffaçable fera toujours le ,
défefpoir de ceux qui ©feront récrire le St abat. ;
Il n’eft pas du tout nécefîàire qu’un morceau
fôit du grand genre , ni qu’il foit deftiné à exprimer
une grande paflion pour avoir du caraSlère.
Ôn en trouve dans les fentimens les plus /impies
& dans les plus perits airs. Cette chanfon fi
naïve & fi touchante du tendre Henri , charmante
Gabridle , a un carqSler très-marqué^: .c’eft celui
que doivent avoir toutes les brunettes/, que depuis,
quelque temps on appelle improprement romancés ;
( voyez ce mot ) Aüfli chaque fois qu’on entend
un air de ce genre , c’eft à celui-là qu’on le compare
fans, s’en appercevoir. Il a pour ainfi dire-
fijté le caraSlère que doivent a voir, les airs de cette
efpéce. Tous les morceaux d’une compofition dramatique
doivent être expreflifi , mais ils ne peuvent
pas toujours avoir du caraSlère , parce que j
toutes lés fitüations ne s’y prêtent pas également, »
C A R
8c qu’on ne fauroit être sûr d’ètre toujours orL
ginal. Le caraSlère dramatique donné par \e p0ëte
à fes perfonnages aide beaucoup le compofiteu*
à en donner à fes produ&ions. Aufli f quand ce
caractère eft vague, i l en réfulte ordinairement que
la mufique en manque, à moins que le eomoo-
fiteur n’ait eu l’art & les moyens de leur en déterminer
un. M. Grêtry eft celui de nos Muficiens
françois qui a le plus iouvent imprimé un caraSlère
à fes ouvrages.
Cette faculté vient, de la nature* & les confeil-j
des maîtres ne fauroient la communiquer. 11 y a
tel compofiteur très-habile dans fon ar t, en con-
noiflant tous les moyens , dont le ftyle même
élégant 8c agréable n’eft pas fans expreffion ; &
qui cependant n’a jamais fu donner un caraSlere
à fa mufique ; c’eft que lui même manque d’imagination
& d’originalité. Ce Muficien aura , des
luccès , mais ils ne feront pas durables. Ses produirions
fe flétriflent beaucoup plutôt que les autres
; une mode nouvelle en enlève ju(qu’au fou-,
venir , elles n’ont pas la vigueur néceflaïre pour
y réfifter. Les premiers ouvrages de Piccinni font
encore eftimés en Italie , à peine s’y rappelle-t on
lès derniers d’Anfoflî.. Les Dilatanti s’amufent
encore de la buona figliuola ,.8c ils n’ont plus l’idée
de la Gianetta, qui , beaucoup plus moderne,
eut à peu près autant de fuccès1 dans fon temps.
Cependant la mufique d’Anfoflî eft claire, élégante,
mélodieufe & bien écrite, mais elle manque de
caraSlère 8c d’originalité.
Ce défaut produit une monotonie dans l’ex-
preflion , qui en détruit l’ effet à la longue. Si le
même ftyle de chant eft donné au maître & au
valet, au héros & au payfan, à l’homme indifférent
& à l’homme paffionné , qüelque variété que
vous ayez cherché a mettre dans votre mélodie,
elle paroîtra toujours de la même couleur. On fent
bien qu’il feroit encore pis de donner un faux
caraSlere à fes perfonnages ; de donner , par exemple
, un chant noble à une foubrette *,un chant
i aimable & gracieux à un vieillard ridicule, & à
un amant paffionné le ftyle d’un bouffon.
Si l’on reconnoît ces vérités, on en devra conclure
que la comédie de c ara Stère pourroit être
tentée avec fuccès fur nos théâtres lyriques, pourvu
que ceux qu’on voudroit y peindre fu fient paflîon-
nés.; ce féroit alors au poète à les . placer dans
dès fitüations muficales ; à donner .à fon drame
la forme & le mouvement que la mufique exige,
& qui feroient fubftitués aux développement gradués
qui appartiennent à la comédie proprement
dite. On.en a déjà donné l’exemple en Italie 8c en
France, où l’on a peint des jaloux 8c des avares
avec fuccès. Beaucoup d’autres caraSlères fe prê-
teroient également aux moyens de. la mufique, &
ce feroit ouvrir à cet art une nouvelle carrière qui
n’attend plus qu’un poète & un muficien de génie
pour ta parcourir, - (* M. Framery. )
CAS. ■ A „
r iH A C T E R E S DE MUSIQUÊ. Ce font les
diverefignes qu’on emploie pour repréfenter tousles
fons deêla mélodie, & toutes les valeurs des tems
& de la rnefure; de forte qu’a l aide de ces carac-
ièns on puifle lire & exécuter la mufique exaéle
ment comme elle a été compofée, & cette maniéré
d’écrire s’appelle noter. (V o y e z Notes. )
Il n’y a que les nations de l’Europe qui fâchent
écrire leur mufique. Quoique dans les autres parties
du monde chaque peuple ait aufli la fienne,
il ne paroît pas qu’aucun d’eux ait poufle tes recherches
juiqu’à des caraBères pour U noter.. Au
moins eft-il fur que les Arabes ni les Chinois, les
deux peuples étrangers qui ont le plus cultivé les
lettres, n’ont, ni l’un ni l’autre, de pareils caractères.
A la vérité les Perfans donnent des noms de
villes de leur pays, ou des parties du corps humain
aux quarante-huit fons de leur mufique.-lls ditent,
par exemple, pour donner l’intonation dun air:
Allez de cette ville à celle-là, ou j allez au doigt
au coude. Mais ils n’ont aucun ligne propre pour
exprimer fur le papier ces mêmes fons ; , quant
aux Chinais, on trouve dans le P. du Halde, qu ils
furent étrangement furpris de voir les jéfuites notei,
& lire fur cette même note tous les airs chinois
qu’on leur faifoit entendre.
Les anciens Grecs fe fervoient pour caraSlères
dans leur mufique , ainfi que dans leur arithmétique
, des lettres de leur alphabet : mats au heu
de leur donner , dans la mufique , une valeur numéraire
qui marquât les intervalles, us fe conten-
toient de les employer comme figues , les combinant
.en diverfes manières , les mutilant, les accouplant
, les couchant, les retournant différemment
, félon les genres & les modes, comme on
peut voir dans le recueil d’Alypius. Les Latins les
imitèrent , en fe fervant, à leur exemple , des
lettres de l’alphabet , & il nous en refte encore la
Jettre jointe au nom de chaque note de notre echelle
diatonique fit naturelle. ,
Çui Aretin imagina les lignes, les portées , les
lignes particuliers qui nous font demeures fous le
nofli de n o te s , & qui font aujourd hui la langue
muficale 8c univerfelle de toute l’Europe. Comme
ces derniers fignes, quoiqu’admis unanimement ©c
perfeâionnés depuis VAretin, ont encore de grands
défauts, plufieurs ont tenté de leur fubftittfer d autres
notes : de ce nombre ont été Parran,Souhaitty,
Sauveur, Dumas, & moi-même. Mais comme, au
fond', tous ces fyftêmes, en corrigeant d anciens
défauts auxquels on eft tout accoutumé, né fai-
foient qu’en fubftituer d’autres dont l’habitude eft
(encore à prendre , je penfe que le public a tres-
fagement fait de laiffer les chofes comme^ elles
font, 8c de nous renvoyer, nous 8c nos fyftêmes,
au pays des vaines fpéculations. ( J . J • Roujfeau.)
C aractères de Musique. C ’eft à tort que
Rouffeau prétend que les nations de l’Europe foient
les fpnW nui Afhpnt noter leur muficme. 8c QUe
C A R
nôtaiftment les Arabes * les Chinois, ni les Pèrfâns
n’aient de femblables caratkrés. Ce n’eft pas aütf
quàranté-huit fons de leur mufique que les Arabes
8c les Perfans ont donné des noms de villes, màiâ
à leurs modes ; ainfi quand ils diferit alle^ de cette
ville à celle-là , par exemple , d'Ifpahan à Baby~
lonne ; il veulent dire : du mode &tfpàhan au
mode Babylonien.
Ces deux peuples , 8c en général les Orientaux *
notent les fons contenus dans toute l’étendue de
leur fyftême par des lettres qui valent autant que
les nombres.
I 2 5 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e { g h î y
z i 12 14 «î 16 17 18 19 20
ya yb y c yd ye R yg yh 1 k
21 22 23 14 26 27 28 19 30
ka kb kc kd ke k f kg kh ki I
3 1 32 54 35 36 40
V 3,8 3.-9
la 1b le ld le If h lh li ni.
Leur fyftême eft borné à quarante fons, ce qui
forme deux oâaves 8c près de deux tons. ( Voyez
planches de rjmfiiue, fig . 44» une pièce morefque
écrite en caractères correfpondans à ceux des arabes,
& dont le refrain eft traduit félon notre notation. )
(V o y e z au fli, pour de plus grands détails fur la
manière d’écrire les modes arabes 8c perfans, i’Effai
fur la Mufique, de M. de la Borde, tom. I. )
Pour les Chinois, leurs caraSlères mHficaux font
également compofés de ceux de leur écriture. Ils
n en diffèrent ni pour la forme, ni pour la manière
de les écrire, qui eft par colonnes 8c en commençant
à droite.Voici les noms des fept premiers caractères
qui repréfentent les fept fons différens d’une
gamme, du grave à l’aigu : h o , fe e , y , c h a n g , tche9
k o u n g , fa n . Viennent enfuite les deux caraSteres
l ie o u fk o u , qui repréfentent les oftaves des deux
premières notes ho 8c fe e . Quant aux oôaves des
autres notes ; elles font exprimées par les mêmes
caraSlères que les fons graves , avec cette différence
qu’on y ajoute Ji côté le caraSIère gin , qui défigne
Poâave fupérieure. (V o y e z planche s de mufique ,
^ Outre ces caraSlères, les Chinois en ont d autres
qui fe placent au - deflous des premiers , 8c expriment
différentes modifications de fon ; voyez
fie. 46. I .
Le figne du n®. 1 placé fous une note augmente
la valeur du double.
Le figne n°. * » marque quil faut repeter la
n° Le figne n°. 3 exprime une efpèce d« tremblement,
& marque, qu’il faut tenir la note. .
Le figne n°. 4 veut dire qu’il faut jouer trois fois
la même note.
Le figne it°. $ , qu’il faut la jouer quatre fois.
D d i j