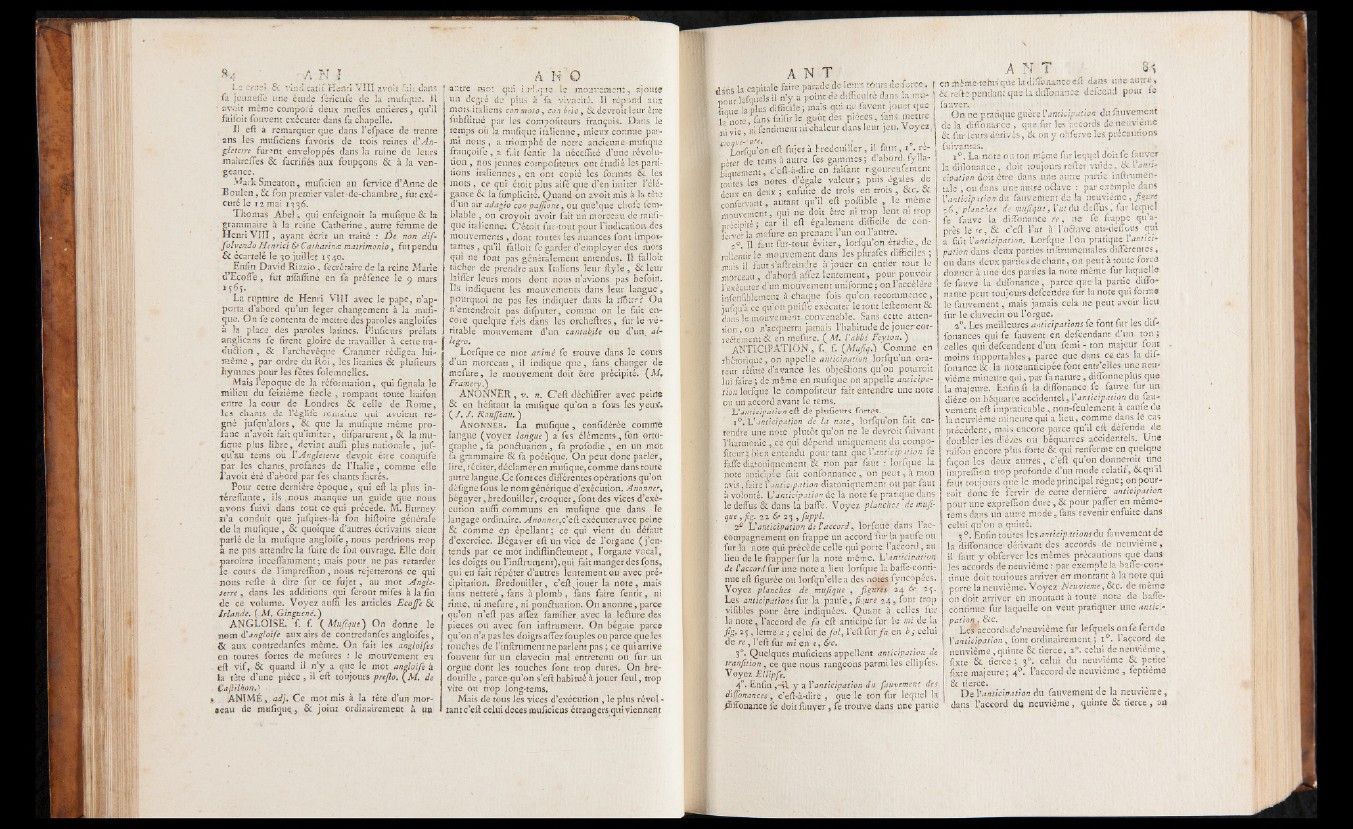
& 4 • , N I
, La cruel 8c vindicatif Henri VIII avoit fiii: dans
fa jcunelTe une étude férieufe- de la mufiqtie. Il
" »voit même compoié deux meffes entières, qu’il
faifoit fouvent exécuter dans fa chapelle.
, Il eft à remarquer que dans l’efpace de trente
ans les muficiens favoris de trois reines $ Angleterre
furent enveloppés dans la ruine de leurs
maîtreffes & facrifiés aux foupçons & à la vengeance.
MarkSmeaton, muficien au fervice d’Anne de
B oulen, & fon premier valet-de-chambre, fur exécuté
le 1 2 mai 1 3 3 6.
Thomas A b e l-, qui enfeignoit la mufique & la
grammaire à la reine Catherine, autre femme de
Henri V I I I , ayant écrit un traité : De non dif-
folvendo Henrici & Catharinee matrimonio, futpendu
& écartelé le 30 juillet 1540.
Enfin David Rizzio, fecrétaire de la reine Marie
d’Ecoffe , fut affafiiné en fa préfence le 9 mars
La rupture de Henri VIII avec le pape, n’apporta
d’abord qu’un leger. changement à la mufi-
que. On fe contenta de mettre des paroles angloifes
à la place des paroles latines. Plufîeurs prélats
anglicans fe firent gloire de travailler à cette tra-
duâion , & l’archevêque Cranmer rédigea lui-
même , par ordre du R o i, les litanies & plufîeurs
hymnes pour les fêtes folemnelles.
Mais l’époque de la réformation, qui fignala le
milieu du feiziêmè fiecle , rompant toute liaifon
entre la cour de Londres St celle de Rome ,
les chants de l’églife romaine qui avoient régné
jufqü’alors, & que la mufique même profane
n’avoit fait qu’imiter, difparurent, & la mufique
plus libre, devint aufli plus nationale, juf-
qu’&u tems où l'Angleterre devoit être conquife
par les chants, profanes de l ’Italie, comme elle
î avoir .été d’abord par fes chants facrés.
Pour cette dernière époque, qui eft la plus in-
téreffante, ils (nous manque un guide que nous
avons fuivi dans tout ce qui précède. M. Burney
si’a conduit que jufqiies-là fon hiftoire générale
de la mufique , & quoique d’autres écrivains aient
parlé de la mufique angloife, nous perdrions trop
à ne pas attendre la fuite de fon ouvrage. Elle doit
paraître inceflamment • mais pour ne pas retarder
le cours de l ’impreflion, nous rejetterons ce qui
nous refie à dire fur ce fu je t, au mot Angleterre
, dans les additions qui feront mifes à la fin
de ce volume. Voyez auffi les articles Eco (Te 8c
Irlande. (M . Ginguené.)
ANGLOISE. f. f. ( Mufique') On donne le
nom d’angloife aux airs de contredanfes angloifes,
& aux contredanfes même. On fait les angloifes
en toutes fortes de mefures : le mouvement en
eft v if , 8t quand il n’y a que le mot angloife à
la tète d’une p iè ce , il efi toujours prefto. (M . de
Çaflilhon.i)
ANIMÉ , ad]. Ce mot mis à la tête d’un mor-
teau de mufiquç, 8c joint ordinairement à un
A N O
j -autre mot qui i.idkp-e le mouvement, ajoute
un degré de plus à fa vivacité. Il répond aux
motsûtaliens conmoto, con brio, & devroit leur être
fubftitué par les compofiteurs françois. Dans le
temps où la mufique italienne, mieux connue parmi
nous, a triomphé de notre ancienne mufique
françoife, a fait fentir la nécefiité d’une révolution
, nos jeunes compofiteurs ont étudié les partitions
italiennes, en ont copié les formes & les
mots , ce qui étoit plus aifé que d’en imiter l’élégance
8c la fimplicité. Quand on avoit mis à la tête
d’un air adagio con pajjione, ou que1 que chofe fem-
blable , on croyoit avoir fait un morceau de rnûfi-
que italienne; C ’étoit fur-tout pour l’indication des
mouvements , dont toutes les nuances font importantes
, qu’il falloir fe garder d’employer des mots
qui ne font pas généralement entendus. Il falloir
tâcher de prendre aux Italiens leur fiyle , & leur
laiffer leurs mots dont nous n’avions pas befoin.
Ils indiquent les mouvements dans leur langue,
pourquoi ne pas les indiquer dans la nôtre? On,
n’entendrait pas difputer, comme on le fait encore
quelque f .fis dans les orchéftres, fur lë v é ritable
mouvement d’un cantabile ou d’un. al-
legro.
Lorfque ce mot animé fe trouve dans le cours
d’un morceau , il indique que, fans changer dé
mefure, le mouvement doit être précipité. (M .
Frarnery.)
ANONNER, v. n. C ’eft déchiffrer avec peins
& en héfitant la mufique qu’on a'fous les yeux:.
( /. J. Rouffeau. }
Anonner. La mufique , confédérée commé
langue (voyez langue) a fes éléments, fon ortô-
graphe , fa pon&uation , fa profodie , en un mot
fa grammaire Si fa poétique. On peut donc parler ,
lire, réciter, déclamer en mufique, comme dans toute
autre langue.Ce font ces différentes opérations qu’on
défigne fous le nom générique d’exécution. Anonner\
bégayer, bredouiller," croquer, font des vices d’exécution
aufli communs en mufique que dans le
langage ordinaire. Anonner,c’eft exécuter avec peine
8c comme ep épellant; ce qui vient du défaut
d’exercice. Bégayer eft un vice de l’organe ( j ’entends
par ce mót indiftinéiement, l’organe vocal,
les doigts Ou l ’inftriinjent), qui fait manger des fous,
qui en fait répéter d’autres lentement o.u avec précipitation.
Bredouiller, c’eft jouer la note, mais
fans netteté , fans à plomb , fans faire fentir, ni
rime, ni mefure, ni ponctuation. On anonne, parce
qu’on n’eft pas aflez familier avec la leéhire des
pièces ou avec fon infiniment. On bégaie parce
qu’on n’a pas les doigts affezfouples ou parce que les
touches de l’infirument ne parlent pas ; ce qui arrive
fouvent fur un clavecin mal entretenu ou fur un
orgue dont les touches font trop dures. On bredouille
, parce qu’on s’eft habitué à jouer feul, trop
vite ou trop long-tems.
Mais de tous les vices d’exécution , le plus révôl -
tant c’eft celui deces muficiens étrangers qui viennent
A N T
i i i s la capitale faire parade Se tors tours de force,
nnur lefquels il n’y a point de difficulté dans la mu-
Ltte la plus difficile; mais qui ne favent jouer que
k note, iahs faifir le goû; des pièces, fans mettre
•ni vie, ni femiment ni chaleur dans leur jeu. v oyez |
I ^Torfqn’on eft fujet à bredouiller , il faut, i° . ré-
| _éter de tems à autre fes gammes; d’abord,fylla-
fcquement, c’eft-à-dire en faifant rigoureusement
I toutes les notes d’égale valeur; puis egales de
I deux en deux; enfuite de trois en trois, & c .,& I confervant, autant qu’il eft pofiîble , le même I mouvement, qui ne doit être ni trop lent ni trop
j p r é c ip i t é ; car il efi également difficile de con-
1 ferver la mefure en prenant l’un ou l’autre,
f 2,0. Il faut fur-tout éviter, lorfqu’on énidie, de I rallentir le mouvement dans les pnrafes difficiles ;
r mais il faut s’aftreindre à jouer en entier tout le
f morceau , d’abord aflez lentement, pour pouvoir
! pexécuter d’un mouvement uniforme ; on l’accélère
1 infenfiblemenî à chaque fois qu’on recommence,
. uifqu’à ce qu’on puiflè exécuter le tout leftement 8c
[ dans le mouvement, convenable. Sans cepe attention
on n’acquerra jamais l’habitude de jouercor-
refiement& en mefure, (M : l’abbé Feytou.)
ANTICIPATION , f. f. (Mußqi) Comme en
rhétorique, on appelle anticipation lorfqu’un orateur
réfute d’avance les objeâions qu’on pourrait
lui faire ; de même en mufique on appelle anticipation
lorfque le compofiteur fait entendre une note
ou un accord avant le tems.
L’anticipation eft de plufîeurs fortes.
i° . U anticipation de la note, lorfqu’on fait entendre
une note plutôt qu’on ne le devroit fuivant
l ’harmonie ,c è qui dépend uniquement du.compo-
fitcur | bien entendu pour tant que l'anticip ition fe
Faffe diatoniquement & non par faut : lorfque la
note anticipée fait confonnancè , on p eut, à mon
avis, faire x anticipation diatoniquement ou par faut
à volonté. L'anticipation de la note fe pratique dans
ledeffus & dans la baffe. Voyez planches de mufique
,fig. 2.2 & 23 9fuppl.
2® L’anticipation de Taccord, lorfque dans l’ac-
compagnement on frappe un accord fur la paufe oti
fur la note qui précède celle qui porte l’accord, au
lieu de le frapper fur la note même. U anticipation
de l'accord fur une note a lieu lorfque la baffe-continue
eft figurée ou lorfqu’ellea des nqtes fyncopées.
Voyez planches de mufique , f.giiWs 2.4 & 2<j.
Les anticipations fur la paufe, figure 24 > f ° nt troP
vifibles pour être indiquées. Quant à celles fur
la note, l’accord de fa eft anticipé fur le mi de la
fig. 25, lettre a ; celui de fo l, l’eft fur fa en b ; celui
de re, l’eft fur mi en c, &c.
3°. Quelques muficiens appellent anticipation de
tranfition, ce que nous rangeons parmi les elliples.r
.Voyez Ellipfe.
4°. Enfin ,-U, y a Vanticipation du fauvement des
diffonances, c’eft-à-dire , que le ton fur lequel la
,jfiffonance fe doit fauyer, fe trouve dans une partie
A N T 3s
| en mèmë-tefns qüe kdiffcnanceeft dans une autre,
| & refis pendant que la diffonance defeend pour fe
j fa 11 ver.; i * ^
On ne pratique guère l’ anticipation du fauvement
1 de la diffonance , que fur les accords de neuvième
&. fur leurs dérivés, Si on y obferve les précautions
fuivantss. ; ' , ', . ■
i ° . La note ou ton même fur lequel doit fe fauver
la diflonance , doit toujours refter vuide, Si L anticipation
doit être dans une autre partie inftrumén-
talé , ou dans une autre o&âve : par exemple dans
l'anticipation cîii fauvement de la neuvième, figure
26 , planches de mufique, Vut du deffüs, fur lequel
fe fauve la diffonance re, 11e fe frappe qu’a-
près le fe , 8c c’eft l'ut à' l’ôâave ati-deffous qui
a fait Xanticipation. Lorfque l’ôn pratique \'anticipation
dans deux parties irtftrumentales différentes,
ou dans deux parties de chant, on peut à toute force
donner à une des parties la note même fur laquelle
fe fauve la diffonance, parce que la partie diffoa
liante peut toujours defeendre fur la note qui forme
le fauvement, mais jamais cela ne peut avoir lieu
fur le clavecin ou l’orgue.
2°. Les meilleures anticipations fe font fur les dif*
fo.nances qui fe fauvent en defeendant d’un ton ;
celles qui defeendent d’un femi - ton majeur font
moins fupportables, parce que dans ce cas la dil-
fonance Si la noteanticipée font entr’elles une neuv
ièm e mineure qui, par fa nature, diffonneplüS que
la majeure. Enfin fi la diffonance fe fauve fur un
dièze ou béquarre accidentel, Vanticipation du fau-
vement eft impraticable , non-feulement a caufe de
' la neuvième mineure qui a lieu, comme dans lê cas
précédent, mais encore parce qu’il eft défendu de
doubler les 'dièzes ou béquarres accidentels. Une
raiîon encore plus forte Si qui renferme en quelque
façon les deux autres, c’éft qu’on donneroit une
imprefiion trop profonde d’un mode relatif, 8t qu’il
faut toujours que le mode principal règne; on pourrait
donc fe fervir de cette dernière anticipation
pour une exprèffion dure, Si pour paffer en même-
tems dans un antre mode, fans revenir enfuite dans
celui qu’on a quitté.
30. Enfin toutes anticipations du fauvement de
la diffonance dérivant des accords de neuvième,
il faut y obferver les mêmes précautions que dans
les accords de neuvième : par exemple la baffe-con-
’ tinue doit toujours arriver err montant à la note qui
porte la neuvième. Voyez Neuvième, Sic. de même
on doit arriver en montant à toute note de baffe-
continue fur laquelle on Veut pratiquer une anticl-
potion. Sic. 4 ” ',v •
Les’accords.de'neuvième fur lefquels onfe fertde
Y anticipation, /ont ordinairement,; i ° . l’accord de
neuvième, quinte Si tierce, 20. celui de neuvième,
fixte 8c tierce; 30. .celui du neuvième 8i petite'
fixte majeure; 46. i’accord de neuvième , feptième
& tierce.
De Y anticipation du fauvementfle la neuvième ,
dans l’accord du neuvième, quinte 8i tierce, on