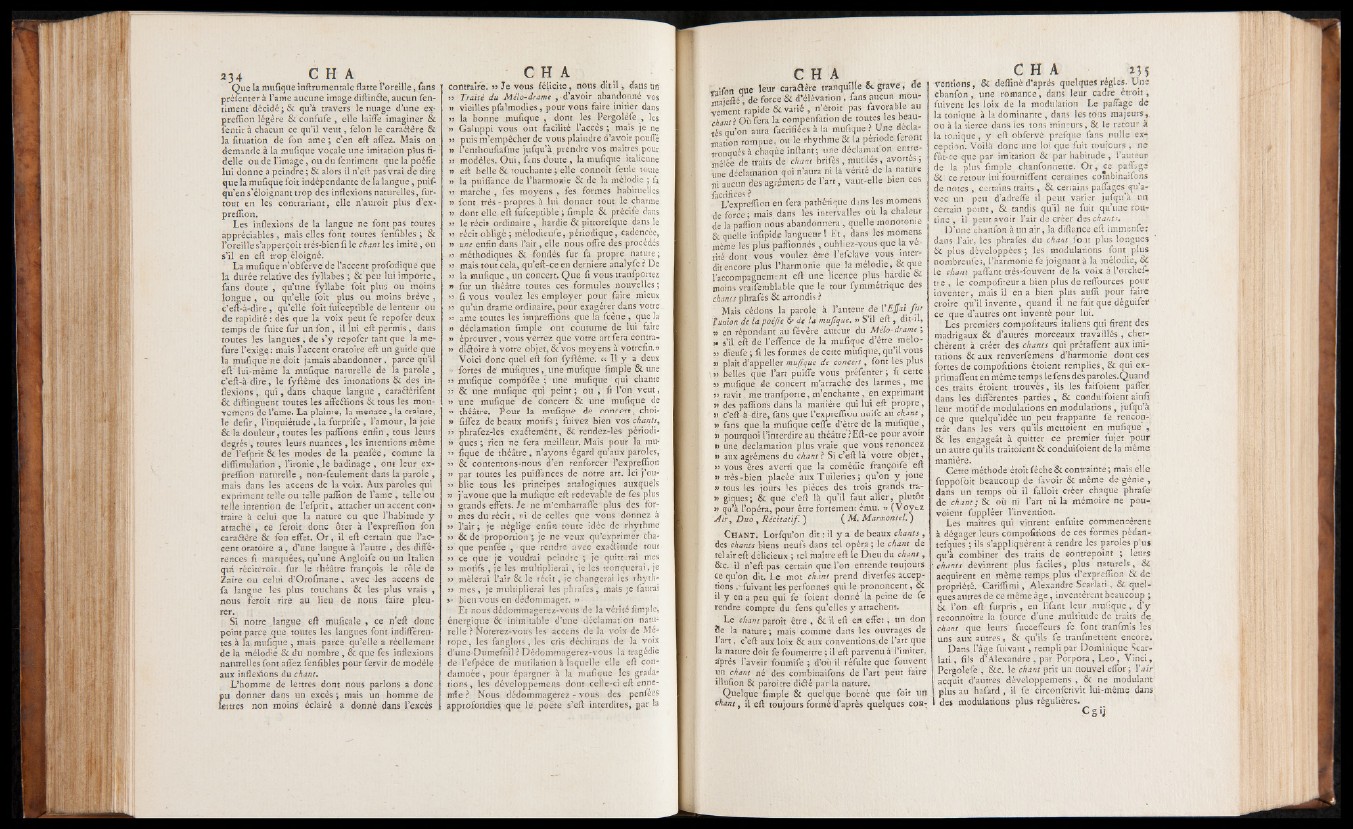
234 C H A
Que la mufiqïie inftrumentale flatte l'oreille, fans
présenter à l'âme aucune image difiinâe, aucun fen-
timent décidé; & qu’à travers le nuage d’une ex-
preffion légère & confufe, elle laiffe . imaginer &
fentir à chacun ce qu’il v e u t, félon le caraéfère &
la fituation de fon ame ; c’en eft affez. Mais on
demande.à la mufique vocale une imitation plus fi-
delle ou de l'image, ou du fentiment que la poéfie
lui donne à peindre ; & alors il n’eft pas vrai de dire
que la mufique foit indépendante de la langue, pui£
qu’en s'éloignant trop des inflexions naturelles, fur-
tout en les contrariant, elle n’auroit plus d’ex-
prefîion.
Les inflexions de la langue ne font pas toutes
appréciables, mais elles font toutes fenfibles ; &
l’oreille s’apperçoit très-bien fi le chant les imite, ou
s’il en eft trop éloigné.
La mufique n’obferve de l’accent profodique que
la durée relative des fyllàbes ; & peu lui importe,
fans doute , qu’une fyllabe foit plus ou moins
longue, ou qu’elle foit plus ou moins brève ,
c’eft-à-dire , qu’elle foit fufceptible de lenteur ou
de rapidité : dès que la voix peut fe repofer deux
temps de fuite fur un io n , il lui eft permis, dans
toutes les langues , de s’y repofer tant que la me-
fure l’exige, : mais l’accent oratoire eft un guide que
la mufique ne doit jamais abandonner , parce qu’il
èft lui-même la mufique naturelle de la parole,
c’eft-à-dire, le fyftême des intonations & des inflexions
, q u i, dans chaque langue , caraélérifent
& diftinguent toutes les affeâions 8c tous les mou-
vemens de l’ame. La plainte, la menace, la crainte,
le defir, l’inquiétude , la furprife , l’amour, la joie
& la douleur, toutes les pallions enfin-, tous leurs
degrés, toutes leurs nuances, les intentions même
de l’efprit 8c les modes de la penfé'e, comme la
diftimulation , l’ironie ,.le badinage , ont leur ex-
preffion naturelle , non-feulement dans la parole ,
mais dans les accens de la voix. Aux paroles qui
expriment telle ou telle paffion de l’ame , telle ou
telle intention de:.l’efprit, attacher un accent contraire
à celui que la nature ou que l’habitude y
attache , ce feroit donc oter à l’expreflion fon
caraélère & fon effet. O r , il eft certain que Tac-
cent oratoire a , d’une langue à l’autre , des différences
fi marquées, qu’une Angloife ou un Italien
qui réciteroit. fur le théâtre françois le rôle de
Zaïre ou celui d’Orofmane, avec les accens de
fa langue les plus touchans & les plus vrais ,
nous fer.oit rire au lieu de nous faire pleurer.
Si notre langue eft muficale , ce n’eft donc
point parce que toutes les langues font indifférentes
à la mufique , mais parce qu’elle a réellement
de la mélodie 8c du nombre, & que fes inflexions
naturelles font affez fenfibles pour fervir de modèle
aux inflexions du chant.
L’homme de lettres dont nous parlons a donc
pu donner dans un excès ; mais un homme de
lettres non moins éclairé a donné dans l’excès
C H A
contraire! Je vous félicite, nous dît i l , dans un
« Traité du Mclo-drame , d’avoir abandonné vos
» vieilles pfalmodies, pour vous faire initier dans
» la bonne jnufique , dont les Pergolèfe , les
» Galuppi vous ont facilité l’accès ; mais je ne
>3 puis m’empêcher de vous plaindre d’avoir pouffé
» l’enthoufiafme jufqu’à prendre vos maîtres pour
33 modèles. Oui, fans doute , la mufique italienne
» eft belle 8c touchante ; elle connoît feule toute
j> la puiffance de l'harmonie & de la mélodie ; fa
33 marche , fes moyens , fes formes habituelles
jj font très - propres à lui donner tout le charme
jj dont elle eft fufceptible ; fimple & précife dans
33 le récit ordinaire, hardie & pittorefque dans le
33 récit obligé ; mélodieufe, périodique, cadencée,
jj une enfin dans l’air , elle nous offre des procédés
33 méthodiques & fondés fur fa propre nature ;
jj mais tout cela, qu’eft-ce en derniere analyfe ? De
>5 la mufique, un concert. Que fi vous tranfportez
j» fur un théâtre toutes ces formules nouvelles ;
>j fi vous voulez les employer pour faire mieux
jj qu’un drame ordinaire, pour exagérer dans votre
j j ame toutes les impireflions que la fcène , que la
» déclamation fimple ont coutume de lui faire
jj éprouver, vous yerrez que votre art fera contra»
» diâoire à votre objet, & vos moyens à votréfin.u
Voici donc quel eft fon fyftême. ce II y a deux
p fortes de mufiqües, une mufique fimple & une
» mufique compdfée ; une mufique qui chante
» & une mufique quj peint; ou , fi l’on.veut,
» une mufique de doncert & une mufique de
jj théâtre. Pour la mufique de concert, choi-
jj fiffez de beaux motifs ; luivez bien vos chants^
jj phrafez-les exaftemént, & rendez-les périodi-
>» ques ; rien ne fera meilleur. Mais pour la mu*
j j fique de théâtre, n’ayons égard qu’aux paroles,
j j & contentons-nous d’en renforcer Texpreflion
>» par toutes les puiffances de notre art. Ici j’ou-
j j blie tous les principes analogiques auxquels
jj j’avoue que la mufique eft redevable de fes plus
j j grands effets. Je ne m’embarraffe plus des for-
jj mes du1 récit, ni de celles que vous donnez à
j j l’air ; je néglige enfin toute idée de rhÿthme
j j & de proportion'; je ne veux qu’exprimer tha-
33 que penfée , que rendre avec exaditude tout
j j ce que je voudrai peindre ; je quitterai mes
j j motifs , je les multiplierai, je les tronquerai, je
jj mêlerai l’air & le récit, je changerai ies-rhyth-
j j mes , je multiplierai les phrafes, mais je faurai
y bien vous en dédommager, jj
Et nous dédommagerez-vous de la vérité fimple,
énergique & inimitable d’une déclamation naturelle
? Noterêz-vous les accens de la voix de Mé-
rope, les fanglots, les cris déchirans de la voix
d’une^Dumefnil ? Dédommagerez-vous la tragédie
de Tefpèce de mutilation à laquelle elle eft condamnée
, pour épargner à la mufique les gradations,
les développemens dont celle-ci eft ennemie
? Nous dédommagerez - vous des penfees
approfondies que le poète s’eft interdites, par la
c H A
m\fon aue leur caraftère tranquille &. grave, de
rnaléûe de force & d’élévation, fans aucun mouvement
rapide & varié , n’ètoit pas favorable au
chunti Où fera la compenfation de toutes les beautés
qu’on aura faerifiées à la mufique ? One déclamation
rompue, ou le rhythme & la période feront
tronqués à chaque inftant; une déclamât on entremêlée
de traits de chant brifés , mutilés, avortes;
une déclamation qui n’aura ni là vérité de la nature
ni aucun des agrémens de l’a rt, vaut-elle bien ces
facrifices ? ,
L’expreflion en fera pathétique dans les momens
de force ; mais dans les intervalles où la chaleur
de la paflion nous abandonnera, quelle monotonie
& quelle infipide langueur ! E t , dans les momens
même les plus paflionnés , oubliez-vous que la v é rité
dont vous voulez être l ’efclave vous interdit
encore plus l’harmonie que la mélodie, & que
l’accompagnement eft une licence plus hardie &
moins vraifemblable que le tour fymmétrique des
chants phrafés & arrondis ?
Mais cédons la parole à l’auteur de YEjfai fur
tunion de lapoéfie & de la mufique. jj S’il eft , dit-il,
v en répondant au févère auteur du Mélo-drame ;
j* s’il eft de l’eftence de la mufique d’être .mélo-
jj dieufe ; fi les formes de cette mufique, qu’il vous
jj plaît d’appeller mufique de concert, font les plus
\>j belles que l’art puifle vous préfenter ; fi cette !
jj mufique de concert m’arrache des larmes, me
jj ravit, me tranfporte, m’enchante , en exprimant
jj des pallions dans la manièt e qui lui eft propre,
ï> c’eft à dire, fans que l’exprèflion nuife au chant,
jj fans que la mufique ccffe d’être de la mufique ,
jj pourquoi l’interdire au théâtre ? Eft-ce pour avoir
•j une. déclamation plus vraie que vous renoncez
w aux agrémens du chant ? Si c’eft là votre objet,
jj vous êtes averti que la comédie françoife eft
jj très-bien placée aux Tuileries ; qu’on y joue
» tous les jours les pièces des trois grands tra-
jj giques ; & que c’eft là qu’il faut aller, plutôt
jj qu’à l’opéra, pour être fortement ému. jj (Vo y e z
Air, Duo , Récitatif. ) (M . Marmontel. )
Chant. Lorfqu’on dit : il y a de beaux chants ,
des chants biens neufs dans tel opéra; le chant de
tel air eft délicieux ; tel maître eft le Dieu du chant,
&c. il n’eft pas certain que l’on entende toujours
ce qu’on dit. Le mot chant prend diverfes acceptions
,'fuivant les perfonnes qui le prononcent, &
il y en a peu qui fe foient donné la peine de fe
rendre compte du fens qu’elles y attachent.
Le chant paroît être , & il eft en effe t, un don
3 e la nature; mais comme dans les ouvrages de
l’art, c’eft aux loix & aux conventions.de l’art que
la nature doit fe foumettre ; il eft parvenu à l’imiter,
àprès l’avoir foumife ; d’où il réfulte que fouvent
un chant né des combinaifons de l’art peut faire
illufion & paroître diéfé par la nature.
Quelque fimple & quelque borné que foit un
chant y il eft toujours forme d’après quelques con-
C H A 235
1 vendons, 8c deffiné d’après quelques règles. Dns
cbanfon ,, une romance, dans leur cadre étroit,
fuivent les loix de la modulation Le partage de
la tonique à la dominante , dans lestons majeurs,,
ou à la tierce dans les tons mineurs, & le retour à
la tonique, y eft obfervé prefque fans mille ex;-
ception. Voilà donc une loi que fuit toujours , ne
fut-ce que par imitation 8c par habitude, l’auteur
de la plus fimple chanfonnette. O r , ce partage
& ce retour lui fourniffent certaines combinaifons
de notes , certains traits , & certains pafîages qu’avec
un peu d’adreffe il peut varier jufqu’à un
certain point, 8c tandis qu'il ne fuit qu’une routine
, il peut avoir l’air de créer des chants.
D’une cbanfon à un air , la diftance eft immenfeî
dans l’air, les phrafes du chant font plus longues
& plus développées ; les modulations font plus
nombreufes, l’harmonie fe joignant à la mélodie, &
le chant partant très-fouvent de la voix à l’orchefi»
tre , le compôfiteur a bien plus de reffources pour
inventer, mais il en a bien plus aufli pour faire
croire qu’il invente, quand il ne fait que déguifer
! ce que d’autres ont inventé pour lui.
Les premiers compofiteurs italiens qui firent des
madrigaux & d’autres morceaux travaillés , cherchèrent
à créer des chants qui prêtaflent aux imitations
& aux renverfemens d’harmonie dont ces
fortes de compofitions étoient remplies, & qui ex-
primaffent en même temps le fens desparoles.Quand
ces.traits étoient trouvés, ils les taifoient pafler
dans les différentes parties , & conduîfoient ainfi
leur motif de modulations en modulations, jufqu’à
ce que quelqu’idée un peu frappante fe rencontrât
dans les vers qu’ils mettoient en mufique ,
& les engageât à quitter ce premier fujet pour
un autre qu’ils traitaient & conduîfoient de la même
manière. - . < # • '
Cette méthode étoitféche& contrainte; mais elle
fuppofoit beaucoup de favoir 8c même de génie ,
dans un temps où il falloit créer chaque phrafe
de chant; 8c où ni l’art ni la mémoire ne pou-
voient fuppléer l’invention.
Les maîtres qui vinrent enfuite commencèrent
à dégager leurs compofitions de ces formes pédan-
tefques ; ils s’appliquèrent à rendre les paroles p'us
qu’à combiner des traits de contrepoint ; leurs
chants devinrent plus faciles, plus naturels, &
acquirent en même temps, plus d’expreflion & de
propriété. Cariflimi, Alexandre Scarlati, & quelques
autres de ce même âge, inventèrent beaucoup ;
8c l’on efL furpris , en lifant leur mulique, d’y
reconnoître la fource d’une multitude de traits de
chant que leurs fuccefleurs fe font tranfmis les
uns aux autres, & qu’ils fe tranfinettent encore.
Dans l’âge fuivant, rempli par Dominique Scarlati
, fils d’Alexandre , par Porpora , Léo , Vinci,
Pergolefe , &c. le chant prit un nouvel efior ; Y air.
acquit d’autres développemens , & ne modulant
plus au ha fard , il fe circonfcrivit lui-même dans
I des modulations plus régulières.