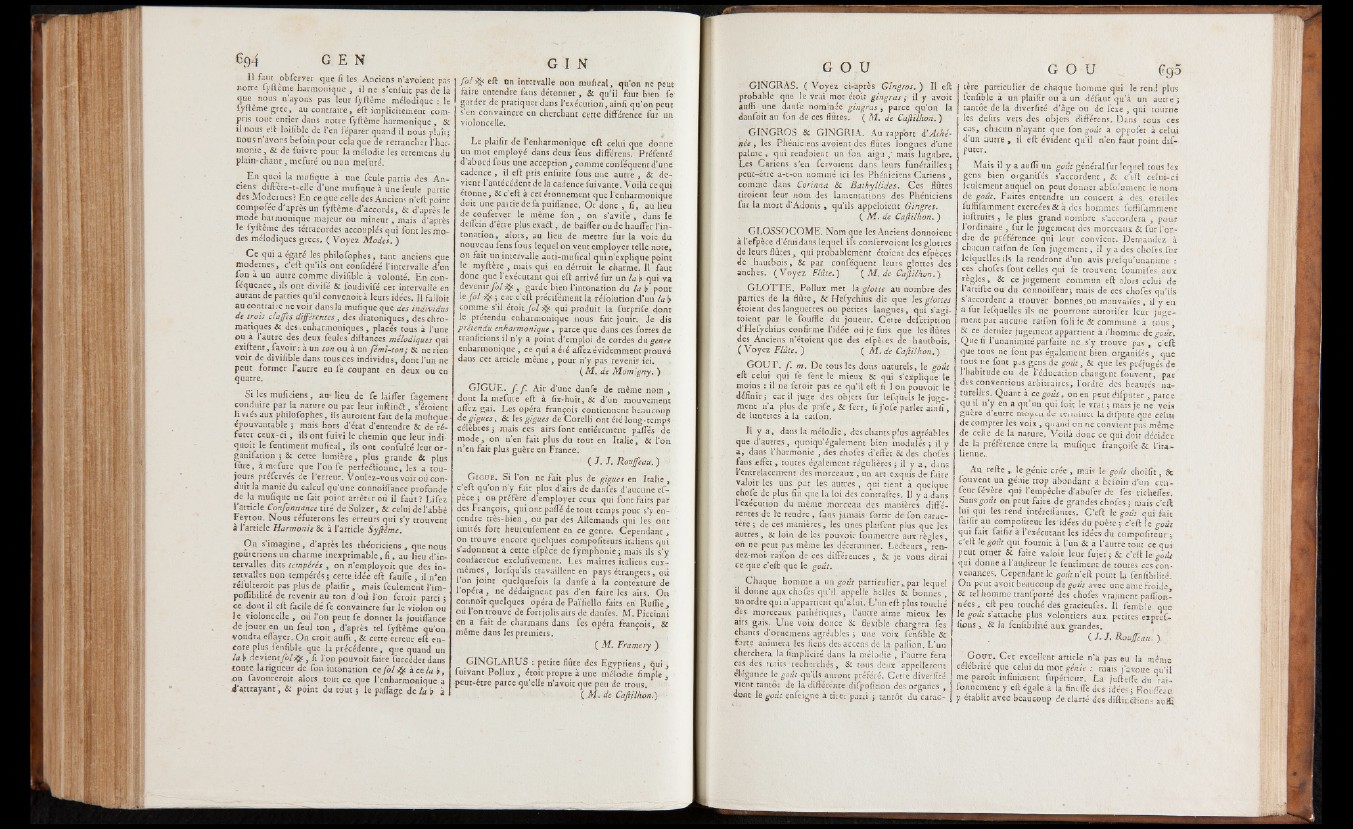
694 G E N
11 faut ob fer ver que fi les Anciens n’a voient pas
notre fyfleme harmonique , il ne s'enfuit pas de là
que^ nous n ayons pas leur fyftême mélodique : le
fyfteme grec, au contraire, eft implicitement compris
tout entier dans notre fyftême harmonique , &
il nous eft loifible de l’en (épater quand il nous plaît;
nous n avons befoin pour cela que de retrancher l'harmonie
, 8c de fuivre pour la mélodie les erremens du
plain-chant , mefuré ou non mefuré.
En quoi la mufique à une feule partie des A n ciens
diffère-t-elle d’une mufique à une feule partie
des Modernes? En ce que celle des Anciens n’eft point
compofée d'après un fyftême-d’accords, & d’après le
mode harmonique majeur ou mineur, mais d ’après
le fyftême des tétracordes accouplés qui font les modes
mélodiques grecs. ( V o y e z Modes. )
C e qui a égaré les philofophes, tant anciens que
modernes , c’eft qu’ils ont confidéré l'intervalle d’un
fon à un autre comme divifible à volonté. En con-
fequence, ils ont divife & foudivifé cet intervalle en
autant de parties qu’il convenoità leurs idées. Il fa/loit
au contraire ne voir dans la mufique que des individus
de trois claffes différentes, des diatoniques, deschro- 1
manques & des . enharmoniques , placés tous à l’une
ou à l’autre des deux feules diftances mélodiques qui
exiftent, favoir : a un ton ou à un fémi-tonj & ne rien
voir de divifible dans tous ces individus, dont l’un ne
peut former l'autre en fe coupant en deux ou en
quatre.
Si les muficiens , au* lieu de fe laifler fagement
conduire par la nature ou par leur in f t in d , s’étoient
livrés aux philofophes, ils auroiene fait delà mufique
épouvantable ; mais hors d’état d’entendre & de réfuter
ce u x -c i, ils ont fuivi le chemin que leur indiquait
le fentiment mufical, ils ont confulté leur o r-
ganifation ; & cette lumière, plus grande & plus
fure, à mefure que l'on fe perfectionne, les a toujours
préfervés de l ’erreur. Voulez-vous voir oü conduit
la manié du calcul qu une connoifiànce profonde
de la mufique ne fait point arrêter où il faut? Life z
l ’article Confdnnance tiré deS u lze r , & celui de l’abbé
Feytou. Nous réfuterons les erreurs qui s’y trouvent
à l’article Harmonie 8c à l’article Syftême.
O n s’imagine, d’après les théoriciens, que nous
gourerions un charme inexprimable, f i , au lieu d’intervalles
dits tem p é r é son n’employoit que des intervalles
non tempérés ; cette idée eft fauffe , il n’en
réfulteroit pas plus de plaifir , mais feulement l’im-
po/fibilité de revenir au ton d ’où l'on feroit parti ;
ce dont il eft facile dé fe convaincre fur le violon ou
le violoncelle , ou l’on peut fe donner la jouilTance
de jouer en un feul ton , d’après tel fyftême qu’on,
voudra eflayer. On croit au fti, 8c cette erreur eft encore
plu? fenfible que la précédente, que quand un
la'v devient fo l ffe , fi l’on pouvoir faire fucçéderdans
tou te langueur de fon intonation ce fo l à ce/a b,
on favoureroit alors tout ce que l’enharmonique a
d’attrayant, & point du tout ; le pa/fagç de la b à
G I N
fifW t ton intervalle non mufical, qu'on ne peut
faire entendre fans détonner , & qu’ il faut bien fe
garder de pratiquer dans l’exécution, ainfi qu’on peut
s en convaincre en cherchant cette différence fur un
violoncelle.
Le plaifir de l’enharmonique eft celui que donne
un mot employé dans deux fens différais. Préfenté
d abord fous une acception , comme conféquent d’une
cadence , il eft pris enfuite fous une autre , & de-
vient-1 antécédent de la cadence fuivante. V o ilà ce qui
étonné, & c eft a cet etonnement que l ’enharmonique
doit une partie de fa puiffance. Or donc , f i, au lieu
de conferver le même fon , on s’a v ife , dans le
deffein d’être plus e x a f t , de baiffer ou de hauffer l’intonation,
aiors, au lieu de mettre fur la voie du
nouveau fens fous lequel on veut employer telle note,
on fait un intervalle anti-mufical qui n’explique point
le myftèrc , mais qui en détruit le charme. 11 faut
donc que 1 exécutant qui eft arrivé fur un la b qui va
devenir fo l , garde bien l’intonation du la b pour
le fo l ; car c’eft précifément la réfoiution d’un la b
comme s’il étoit fo l >$< qui produit la furprife dont
le prétendu enharmonique nous fait jouir. Je dis
prétendu enharmonique, parce que dans ces fortes de
tranfitions il n’y a point d’emploi de cordes du genre
enharmonique , ce qui a été affez évidemment prouvé
dans cet article même , pour n’y pas revenir ici.
( M. de Mdmigny. )
G IG U E , f f Air d’une danfe de même nom ,
dont la mefure eft a fix-huit, & d’un mouvement
affez gai. Les opéra françois contiennent beaucoup
gigues * & les gigues de Corelli ont été long-temps
célèbres ; mais ces airs font entièrement paffés de
mode, on n’en fait plus du tout en Ita lie, & l’on
n’en fait plus guère en France.
( J. J. Rouffeau. )
G ig u e . Si 1 on ne fait plus de gigues en I ta lie ,
c eft quon n y fait plus d’airs de danfes d’aucune ef-
pèce ; ob préfère d’employer ceux qui font faits par
des François, qui ont pafTé de tout temps pour s’y entendre
très-bien, ou par des Allemands qui les ont
imités fort heureufement en ce genre. Cependant >
on trouve encore quelques compofiteurs italiens qui
s’adonnent à cette efpèce de fymphonie; mais iis s’y
confacrent exclufivement. Les maîtres italiens eux-
memes, lorfqu ils travaillent en pays étrangers, où
l’on joint quelquefois la danfe à la contexture de
l’opéra , ne dédaignent pas d’en faire les airs. On
connoît quelques opéra de Païfiello faits en Ruffie,
où l ’on trouve de fort jolis airs de danfes. M . Piccinni
en a fait de charmans dans fes opéra françois, 8c
même dans les premiers.
( M. Framery )
G IN G L A R U S : petite flûte des Egyptiens, àui ;
fuivant P o llu x , étoit propre à une mélodie fimple ,
peut-être parce qu’elle n’avoit que peu de trous.
. ( A / , de Cafiilhon.)- ■
g o u
G IN G R A S . ( V o y e z ci-après Gingros. ) Il eft
probable que le vrai mot étoit gingras ; il y avoit
auffi une danfe nommée gingras, parce qu’on la
danfoit au fon dé ces flûtes. ( M. de Cafiilhon. )
G IN G R O S & G IN G R IA . Au rapport 61 Athénée
, les Phéniciens avoient des flûtes longues d’une
palme , qui rendoient un fon aigu / mais lugubre.
Les Cariens s ’en fervoient dans leurs funérailles j
peut-être a-t-on nommé ici les Phéniciens Cariens ,
comme dans Corinna 8c Bathyllides. Ces flûtes
tiroient leur nom des lamentations des Phéniciens
fur la mort d’A d on is, qu’ils appeloient Gingres.
( M. de Caftilhon. )
G LO S SO C OM E . Nom que les Anciens donnoient
à l ’efpèce d’étuidans lequel ils confervoient les glottes
de leurs f lû t e s q u i probablement étoient des efpèces
de hautbois, & par conféquent leurs glottes des
anches. (V o y e z Flûte.) ( M. de Cafiilhon.)
G L O T T E . Pollux met la glotte au nombre des
parties de la flûte, & Hefychius dit que les glottes
étoient des languettes ou petites langues, qui s’apitoient
par le fouffle du joueur. Ce tte deieription
d ’Hefychius confirme l’idée où je fuis que les flûtes
des Anciens n’étoient que des efpèces de hautbois.
(V o y e z Flûte. ) ( M.de Cafiilhon.)
G O U T , f m. De tous les dons naturels, le goût
eft celui qui le fent le mieux & qui s'explique le
moins : il ne feroit pas ce qu’il eft fi 1 on pouvoit le
définir ; car il juge des objets fur lefquels le jugement
n’a plus de pr-ife , & fe r t, lî j ’olè parler ainfi ,
de lunettes à la raifon.
Il y a , dans la mélodie , des chants plus agréables
que d’autres, quoiqu’également bien modulés; il y
a , dans l’harmonie , des choies d’effet & des choies
fans e f fe t , toutes également régulières; il y a , dans
l’entrelacement des morceaux , un art exquis de faire
valoir les uns. par les autres , qui tient à quelque
chofe de plus |n que la loi des contraftes. Il y a dans
l'exécution du même morceau des manières différentes
de le rendre , fans jamais-fortir de fon caractère
j de ces manières, les unes plaifcnt plus que les
autres, & loin de les pouvoir foumettre aux iègle s,
on ne peut pas même les déterminer. Le&eurs, ren-
dez-moi raifon de ces différences , 8c. je vous dirai
ce que c’eft que le goût. .
Chaque, homme a un goût particulier,,par lequel
il donne aux. chofes qu’ il appelle belles & bonnes ,
un ordre qui n’appartient qu’àlui. L ’uneltpliis touché
des morceaux pathétiques, l’ autre aime mieux les
airs gais. Une voix douce & flexible chargera fes
chants d’ or ne me ns agréables ; une voix fenfible 8c
forte animera les fiens desaccens de la paillon. L ’un
cherchera, la fimplicité dans la mélodie , l’autre fera
cas dès traits recherchés,. & tous deux appelleront
élégauce le goût qu’ils auront préféré. Cettè diverfité
vient tantoc de la differente difpoficion des organes ,
dont le goût enfeigne à tirer parti ; tantôt du caracl-
G O U .
tère particulier de chaque homme qui le rend plus
fenfible à un plaifir ou à un défaut qu’à un autre j
tantôt de la diverfité d’âge ou de fexe , qui tourne
les defirs vers des objets différens.. Dans tous ces
cas, chacun n’ayant que fon goût à oppofer à celui
d un autre , il eft évident qu’il n’en faut point disputer.
Mais il y a aulïi un goût général fur lequel tous les
gens bien organites s’accordent, & c eft celui-ci
feulement auquel on peut donner abfolument le non»
de goût. Faites entendre un concert à des. oreilles
fuffifamment exercées & à des hommes fuffifamment
inftruits , le plus grand nombre s’accordera , pour
l’ordinaire , fur le jugement des morceaux & fur l’ordre
de préférence qui leur convient. Demandez à
chacun raifon de fon jugement, il y a des chofes fin:
lefquelles ils la rendront d’un avis prefqu’ unanime :
ces chofes font celles qui fe trouvent foumifes aux
règles, & ce jugement commun eft aiors celui de
l ’artifte ou du connoiffeur; mais de ces chofes qu’ils
s accordent à trouver bonnes.ou mauvailès , il y en
a fur lefquelles ils ne pourront aurorifer leur jugement
par aucune raifon foli le & commune à cous ,
8c ce dernier jugement appartient à i’homme de goût.
Que fi l’unanimité parfaite ne s.'y trouve p a s , c’eft
que tous ne font pas également bien organifés, que
tous lie font pas gens de goût, & que les préjugés de
l’habitude ou de l’éducation changent fouvent, par
des conventions arbitraires, l'ordre des beautés naturelles.
Quâut à. ce goût, on en peut difputer , parce
qu il n’y en a qu’ un qui. loir le vrai mais je ne vois
guère d autre moyen.de terminer la dilpute que celui
de compter les voix , quand on ne convient pas même
de celle de la nature. Voilà donc ce qui doit décider
de la préférence entre la mufique françoife & l ita-
lienne..
A u refte r le génie.crée , mais le-goût ch oifit, 8c
fouvent un génie trop abondant a belbin d’iin cen-
(èur févète q ui l’empêche-d'abufer de fes richelfes.
Saus^owr on peut fair-e de grandes chofes; mais c’eft
lui qui les rend întéreflàntes. C'eft: le goût qui fait
faifir au compofiteur lës'idees du poète ; e’eft le goût
qui fait faifir à l’exécutant les idées du compofiteur-;
c’eft le goût qui fournit à l’un & à l’autre tout ce qu»
peut orner & faire valoir leur fujet ; Sc. c’eft le goût
qui donne à l’auditeur le fentimarc de toutes ccs convenances.
Cependant k goûtried point la fenfibilité.
On peut avoir beaucoup de goût avec une aine froide.
& tel homme tranfporté des chofes vraiment pafiîoiv-
néés eft peu touché des gracieufcs. Il femble que
le goût s’attache plus volontiers aux. petites exprcf-
ûons & la fenfibilitél au x grandes.
(,ƒ. ƒ. Rouffeau. y,
Goût. Cet excellent article n a pas eu la même
célébrité que celui du mor génie .*• mais j’avoue qu’il
me paroîr infiniment fupéricur. La ju ftdfe du rar-
fonnement y eft égale à la findTe des idées; RoiilTeau
y établit avec beaucoup de.clarté des diftir.&ions aufli