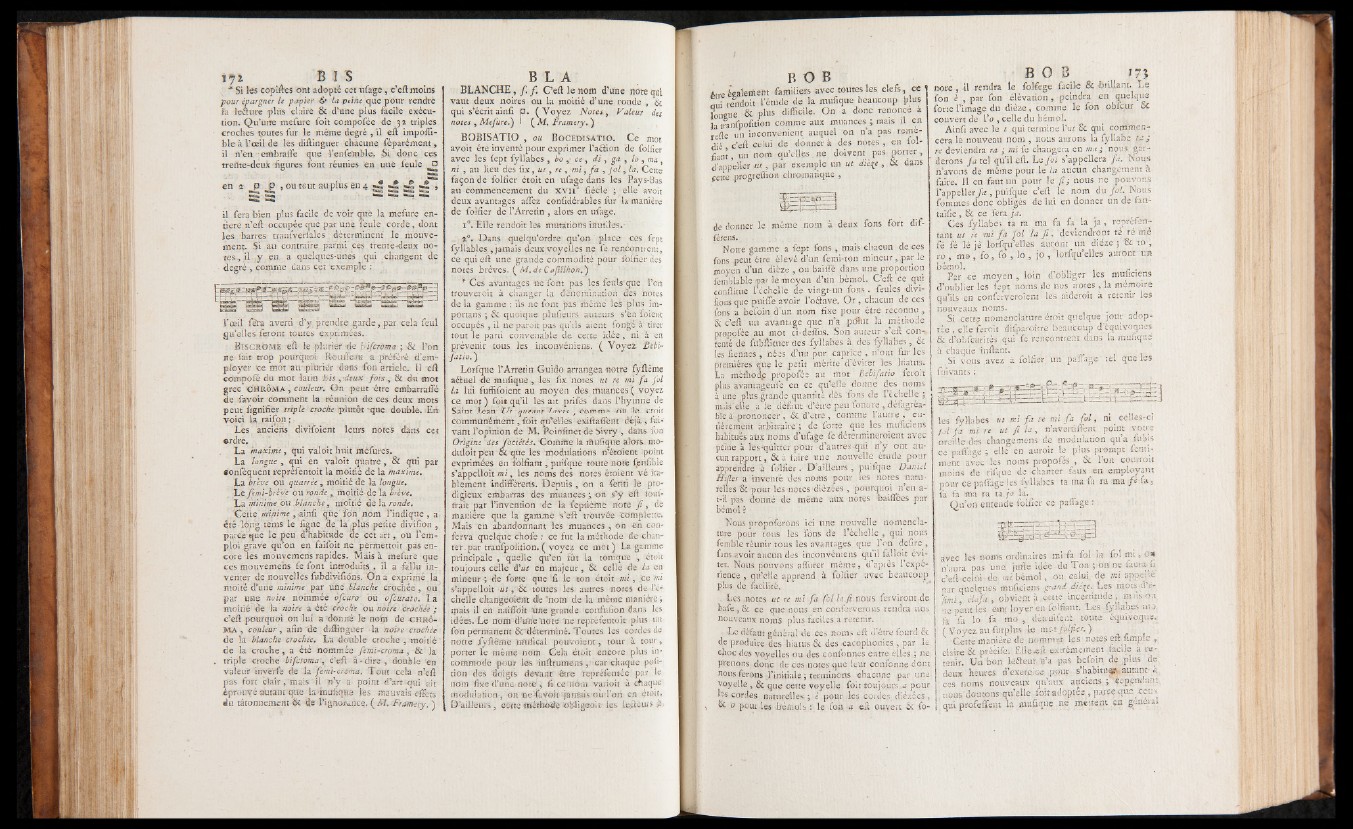
Y’j t B I 3
* Si les copiées ont adopté cet ufage, c’eft moins
pour épargner le papier 6* la peine que pour rendre
l'a leâure plus claire & d’une plus facile exécution.
Q u’une mefure foit compofée de 32 triples
croches toutes fur le même degré , il eft imposable
à l’oeil de lés diftinguer chacune féparément,
il n’en • emhraffe que l ’enfe:mble> S i donc ces
treilte-deuk -figures font réunies en une feule . □
en 2 P P , ou tout au plus en 4 »5 «ê *■ £ ,
« .-j •«-JB «aasa 1 S**?*»» *"*» *«*B*«»
il fera bien plus facile de voir què la mefure entière
n’eft occupée que par une feule corde, dont
les barres tramverfales déterminent le mouvement.
Si au contraire parmi ces tVente-rdeux note
s , il ;y en a quelques-unes qui .changent de
degré , comme dans cét 'exemple :
is sÄ
tetfes&a faÈrasal b b ï »«'
l’oeil fêta averti d’y prendre garde, par cela feiil
qu’elles feront toutes exprimées.. •
Bisgromè eft le plurier «de bifcroma ; •& l ’on
ne fait trop pourquoi Rotule3ii a .préféré .d’employer
ce mot au .pliiriér dans -fon article.. 11 eft
compofé du mot latin pis , -deux fois,, & du mot
grec 'CHROMA, couleur. On peut 'être embarraffé
de -favoir comment la réunion de ces deux mots
peut fignifier triple croche iplutôt que double. En
voici la raifon :
Les anciens divrfoient leurs notes dans cet
©rdre.
La 'maxime, qui valoit hiiit méfures.
La longue , qui en val oit quatre , & qui par
«onféquent repréfentoit la moitié dé la maxime.
La brève ou quarrée , moitié de la longue,
mi-brèVe ou ronde,moitié-de la brève.
La minime pli blanche , moule dé là ronde.
'Cette mipime , -ainfi que fon nom l’indique, a-
été -16ng:fems le ligne de là plus petite divifion ,
parce que le peu d’habitude 3e cet a r t , ou remploi
grave qu’on en faifoit ne pérmettoit pas encore
le s mouvemebs rapides.. Mais à mefure que
ces mouvemehs fe font introduits, il a fallu in-,
venter de nouvelles fubdîvifidns. On a exprimé la
moite d’une minime par une Manche croçhee, ou
par une noire nommèè ôfcuro du ofcûra'to. l a
moitié de la noire 'à été -çrocke ou noire drochée ;
c’eft pourquoi on lui a donné le nom de ch r o m
a , couleur, afin “de diftinguer la noire crachée
de la blanche crochée. La double croche , moitié'
de la croche, a été nommée femi-croma, & la
triple croche biferorna, c’eft a-dire , double 'en
Valeur invêrfë de lafem-crOtna. Tout cela n’-efl
pas fort clair, mais il n’y a point d’artqui î|||
éprouvé autant que ladmïhqüe l'es mauvais effets
du tâtonnement & de l’ignorance, ( M. Framsty. )
B L A
B LAN CH E , ƒ. ƒ. C ’eft le nom d’une note qui
vaut deux noires ou la moitié d’une ronde , &
qui s’écrit ainfi p. (V o y e z Notes, Valeur des
notes , Mefure.) I ( M, Frarnery. )
BOBISATIO , ou Bo c ed ïsa t io . C e mot
avoit été inventé pour exprimer l’a&ion de folfier
avec les fept fyllabes, bo ^ ce-, d i , gà , lo , ma,
ni y au lieu des fix , u t , re , mi ; fa , f o l , la. Cette
façon de folfier éto,it en ufage dans les Pays-Bas
au commencement du X v iT fi-êtie ; elle avoit
deux avantages aflez confidérables fur la manière
de folfier de l’Arretin , alors en ufage.
i°. Elle rendoit les mutations inutiles.-
2°. Dans quelqu’ordre qu’on place ces fept
fyllàbles , jamais deux voyelles ne fe rencontrent,
ce qui eft une grande commodité pour iolfier des
notes brèves. ( M. de Cafiïlkonj)
* Ces avantages ne font pas les fecfts'qïiê l’on
trouveroit à changer la dê'Uomination dés hôtes
de là gamme : ils ne font pas ‘même 'les plus im-
portans ; & quoique plufieurs auteurs s’ëft foiént
occupés , iL ne paroit pas qu'ils aient fongé à tirer
tout le parti convenable de cette idé e, ni à en
prévenir tous les inconvéniens. ( Voyez. Febi-
fa iio .) " V 1' ' ;; " & '. a
Lorfque l’Arretin Guide arrangea notre fyftême
aétuel de mufique, le-s fix notes ut re mi fa fol
la lui fuffifoient au moyen des muances ( voyez
ce mot ) foit qu’il les ait prifés dans l’hymne de
Sâïnt Jean î/t queant^laxis , cofilme on -lë croit
communément ,fo it qu’elles exiftaftènt déjà, lui*
Vant l’opinion de M. Poifffinet de Sivry , dans fon
Origine des fociéîés. 'Comme la ifiufique alors, mo-
duloit peu & que les modulations n’étôient point
exprimées en rolfiant, puifque toute note fenfible
s’appelloi't mi, les noms des notes étoiènt vé ita-
blement indifféreris. Depuis , on a fenti le prodigieux
embarras des muances > on s-ÿ eft loui-
frait par j’ihvehtion de là feptièlne note f i , dè
manière que la gammé s’éft trouvée 'complétée.
Mais en abandonnant les muances -, on en con-
férVa quelquè chofe : ce fut la méthode de chanter
. par trànfpofition. ( voye^ ce mot ) La gamme
principale , quelle qu’en fût la tonique , étoir.
toujours celle drut en majeur, & celle de la en
mineur de forte que fi le »ton étoit m i, .te toi
s’appelloit àt , toutes les autres notes de l ’échelle
changeoiéiït db ‘nom de la même manière ;
mais il en hàïffdit fine grande 'confufiôn dans les
idées. Le nom d’Urie'note ‘ne repréfentoit plus un
fon permanent &^déterminé. Toutes les cordes de
notre fyftême nflfficai pouVoient, tour à tour,
porter le même nom Cela étoit encore plus incommode
pour les inftruméns , 'car chaque portion
des doigts devant être 'repréfentée par le
nom fixe d’une- noté , fi ce'HÔm varioit à chaque
modulation-, on 'ue^voit jamais'oiid’on en étoit*
D’ailleurs, cc-tte méthode o'bligeoit- les leftêurs 2
B O B
Atre kaleriient femiliws avec toutes les c le fs , ce '
oui tendoit 1 etude de la mufique beaucoup f lu s
longue & plus difficile. On a donc renoncé a
la trànfpofition comme aux muances ; mais il en
refte un inconvénient auquel on n’a pas remédié
, c’efi celu i de -donner à des notes , en io l-
fiant, un nom qu’e lle s . ne doivent pas porter -,
d’appeiier u t , par exemple un ut diè^e , & dans
cette progreflion chromatique ,
I P i i
de donner le même nom à deux fons fort dif-
férens.
Notre gamme a fept fons , mais chacun de ces
fons peut être élev é d’un femi-ton mineur, .par le
moyen d’un dièze , ou baifle dans une proportion
femblable jpar le moyen d’un bémol. C ’eft ce qui
conftitue l’cchel-le de vingt-un fons , feules divisons
que puifie avoir l’o â a v e . O r , chacun de ces
fons a befoin d’un nom fixe pour être reconnu ,
& c’eft un avantage que n’a .pdhit la méthode
prqpofée au mot ci-deflus. Son auteur s’eft con-*
tenté de fiibftitiier des fyllabes à des fy lla b e s , &
les fiennes , nées .d’un pur caprice , n’ont fur les
premières que le petit mérite d’éviter "les hiatus.
La méthode propofee au mot Bebifatio ferort
plus àvantageufe en ce q ifé lle donne des noms
à une plus grande quantité dés fons de l’échelle '9
mais'elle a le défaut 'd’être peu fonore , .défagréa-
bïe.à' .prononcer , Si d’ê t re , comme l’autre ^ entièrement
arbitraire ; de forte que les muficiens
habitués aux noms d’ufage fe détermineroient avec
pëiiie à les-quitter p'our d’autres qui n’y ont aucun
rapport, & à faire une nouvelle étude pour
apprendre à folfier . D ’ailleurs , puifqne Daniel
Hifler a inventé des noms pour les notes naturelles
& pour les notes dièzées , pourquoi n’en a-
t-il pas donné de même aiix notes baiffées par
bémol ?
Nous propefferens ici une nouvelle nomenclature
pour tous les fons de l’échelle , qui nous
femble réunir tous les avantages que l’on defire ,
fans avoir aucun des inconvéniens qu’il falloir éviter.
Nous pouvons aflurer même, d’après l’expérience
, qu’elle apprend à folfier avec beaucoup
plus de facilité.
Les .notes ut re mi fa fol la.fi nous ferviront.de
bafe, & ce que nous en conferverons rendra nos
nouveaux noms pins faciles à retenir.
L e défaut général de ces noms eft d’être fourd &
de produire des hiatus 8c des cacophonies , par le
choc des voyelles ou des confonnes entre elles ; ne
prenons donc de ces notes que leur confonne dont
nous ferons l’initiale ; terminons chacune par une
voyelle , & que cette v o y e lle foit toujo^rs^ pour
les cordes naturelles-^Àe pour les. cordes d iè zé e s ,
& o pour le-s bémol s : le fo n a eft ouvert 8c fo-
B O B 1 7 }
nore , il rendra te folfege facile & brillant. Le
fon è , par fon élévation, peindra en quelque
forte l’image du dièze, comme le fon obfçiir &
couvert de l’o , celle du bémol.
Ainfi avec le t .qui termine l'ut & qui commencera
le nouveau nom , nous aurons la fyllabe ta ;
re deviendra ra ; mi fe changera en ma; nous garderons
fa tel qu’il oft. L q fo l s’appellera fa. Nous
n avons de même pour le la aucun changement à
faire. 11 en faut un pour rfy® nous ne pouvons
l’appeller Ja , puifque c’eft le nom du Jol. Nous
fommes donc obligés de lui en donner un de fan-
taifie , & ce fera ja. .
Ces fyllabe» tâ ra ma fa fa la ja , re^prefen-
tant ut re mi fa fo l la f i , deviendront tè ré trié
; fé fè îè je lorfquelles auront un dièze ; to,
ré , mo , f o , fo , lo , jo -, lorfqu elles auront un
bémol.
Par. cè moy en, loin d obliger les rritniciens
d’oublier les fept noms de nos notes , la mémoire
qu’ils en confcrveroient les aideroit à retenir les
nouveaux noms.
Si cette -nomenclature étoit quelque jour adoptée
, elle feroit difparoître beaucoup d équivoques
& d’obfcurités qui fe rencontrent dans la mufique
a chaque tnftâhr. __ . ..
Si vous .avez à folfier; un palfage tel que les
fuivants :
f e z j r p
les fyllabes ut mi fa re mi fa f o l , ni celles-ci
( 4 fa mi re ut f i la , n’avertiftent point votre
oreille des change mens de modulation qua fubis
ce pafiage ; elle en auroit le plus prompt fenti-
ntent avec les noms propofés , & l’on courroie
moins de rifque de chanter faux en employant
pour ce pafiage jes fyllalje.s ta ma fa ra ma fè f a ,
fa fa ma ra tàjo la. ^
Q u’on entende folfier ce pafiage :
avec les noms ordinaires mi rfe fol la fol m i, on
n’aura pas une jufie idée du Ton pon ne faura.fi
: c’eft .celui tle; mi bémol, ou celui, de mi aneeiié
nar quelques muficiens grand diérre. Les mots al e.
fv n i ,éU f ,i , obvient à,cette incertitude, mais on
n-. peut les employer en folfiant. Les fyllabes mo.
& fa lo fa mo , détriment toute équivoque.
( Voyez anfurplus le mot folfier.') . . . . ■
Cette manière de nommer les notes eft fimple ,
claire & précifev Elle .eft extrêmement facile à retenir.
Un bon lefteur n’a pas befoin de .plus de
deux heures d’exereiee .pour s’habitua-autant«
'ce s noms nouveaux qu’aux anciens ; cependant,
nous doutons qu’elle foit adoptée , parce que ceux
qui profeffent La mufique ne mettent eu général