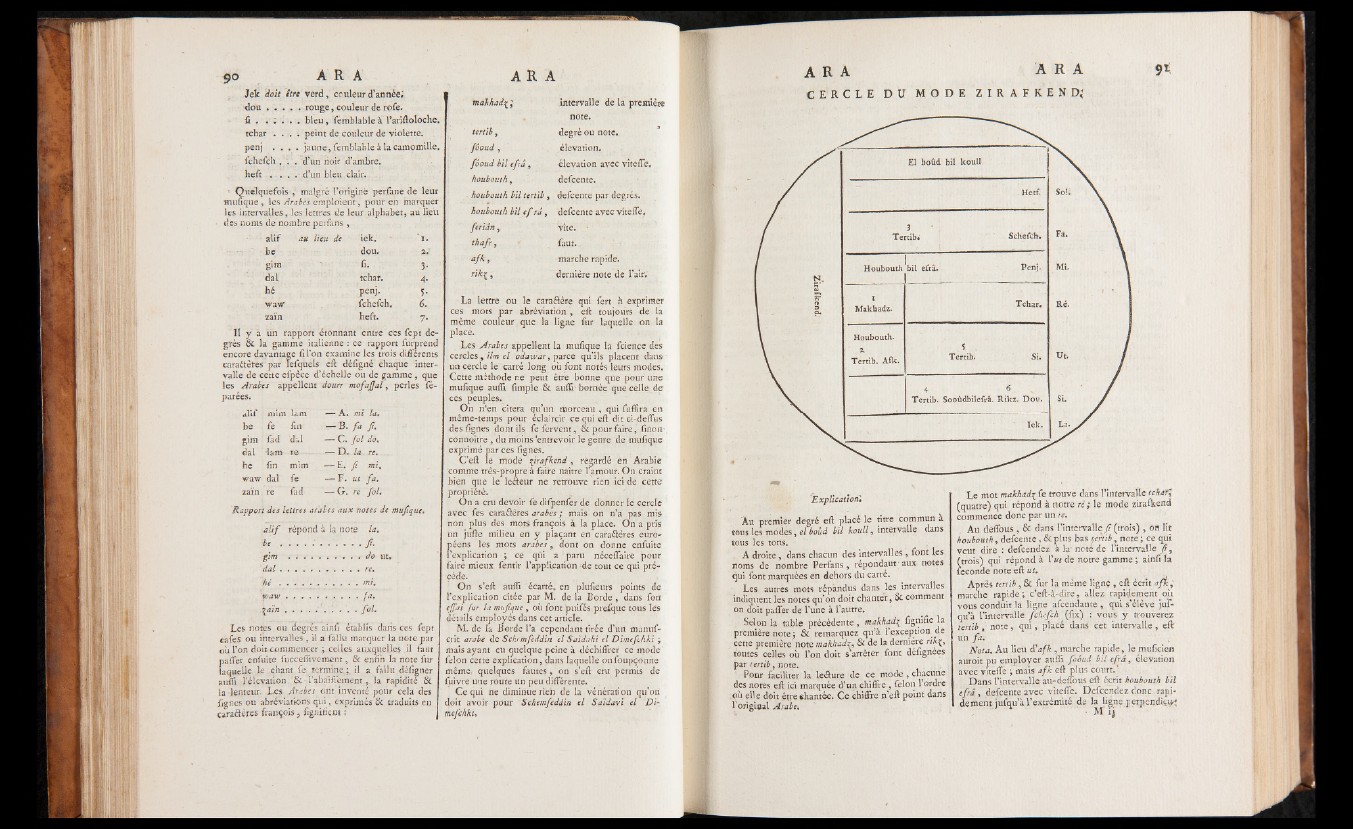
90 À R A
Jek doit itrt verd, couleur d’année;
dou . . . . . rouge, couleur de rofe.
ù . . ; . . . b leu, fémblable à l’ariftoloche.
tehar . . . . peint de couleur de violette;
penj . . . . jaune , femblable à la camomille,
fchefch . '. . d’un noir d’ambre,
heft . . . . d’un bleu clair.
■ Quelquefois , malgré l’origine perfane de leur
mufique , les Arabes emploient, pour en marquer
les intervalle s, les: lettres de leur alphabet, au lieu
des noms de nombre perfans ,
alif au lieu de iek. "i
be dou. 2
gim fi. 3
dal tchar.
hé penj.
waw fchefch. 6
zaïn heft. j 7
11 y à un rapport étonnant éhtre ces fept degrés
& la gamme italienne : ce rapport furprend
encore davantage fi Ton examine les trois différents
caraétèfes par lefquels eff défigné chaque intervalle
de cette efpèce d’échelle ou de gamme, que
les Arabes appellent dourr mofajjal, perles réparées.
alif mim lam — A. mi la.
be fe fin — B. fa figim
fad dal — c . fo l dà.
dal -1 am re — D . la. te.
he fin mim — E. fi mi.
waw dal fe — F. ut fdzaïn
re fad — G. re fol.
Rapport des lettres arabes aux notes de mufique.
a lif répond â la note la,
be . . . . 1 . . . . . . Ji.
gim . . . . . . . . . t do ut.
, dal .................................. re.
hé . . . . . . . . . . , mi.
'waw . . . . . . . . . . fa.
\aïn . . . . . . 1 « . . fol.
Les notes ou degrés ai nfi établis dans ce-s fept
cafés ou intervalles, il a fallu marquer la note par
où l’on doit-commencer celles auxquelles il faut
paffer enfuite fuccefiivemcnt, & enfin la note fur
laquelle le chant fe termine il a fallu défigner
aufli i’élevation & l’abaifiement, la rapidité &
la lenteur. Les Arabes ont inventé pour cela des
lignes ou abréviations qui, exprimés & traduits en
çaraâères françois, fignifient :
A R A
makhad^ intervalle de la premis
note.
tertib, degré ou note.
fôoud, élévation.
fôoud bil efrâ , élévation avec vîteffe.
houbouth, defeente.
houbouth bil tertib, defeente par degrés.
houbouth bil e f râ, defeente avec vîteffe.
ferïân, vite. •
thafr, faut.
af k 9 marche rapide.
r ik [ , dernière note de l’air.
La lettre ou le cara&ère qui fert à exprimer
ces mots par abréviation , eff toujours de la
même couleur que la ligne fur laquelle on la
placé.
Les Arabes appellent la mufique la fcience des
cercles, ilm el odawar, parce qu’ils placent dans
un cercle le carré long où font notés leurs modes.
Cette méthode ne peut être bonne que pour une
mufique aufli fimple & aufli' bornée que celle de
ces peuples.
On n’en citera qu’un morceau, qui fuffira en
même-temps pour éclaircir ce qui eff dit ei-deffus
des lignes dont ils fe fervent, oc pour faire, finon-
connoître , du moins 'entrevoir le genre de mufique
exprimé par ces fignes.
C ’eff le mode firafkend , regardé en Arabie
comme très-propre à faire naître l*amour. On craint
bien que le leéfeur ne retrouve rien ici de cette
propriété.
On a cru devoir fe difpenfer de donner le cercle
avec fes caraélères arabes ; mais on n’a pas mis
non plus des mots françois à la place. On a pris
un juffe milieu en y plaçant en caraéléres européens
les mots arabes, dont on donne enfuite
l’explication ce qui a paru néceffaire pour
faire mieux fentir l’application de tout ce qui précède.
On s’eft aufli écarté, en plufieurs points de
l’explication citée par M. de la Bordé, dans fon
effai fur la mufique , où font puifés prefque tous lés
détails employés dans cet article.
M. de la Borde l’a cependant tirée d’un manuf-
crit arabe de Schrmfeddin el Saidahi el Dirncfihki ;
mais ayant eu quelque peine à déchiffrer ce mode
félon cette explication, dans laquelle onfoupçonne
même, quelques fautes, on s’eft cru permis de
fuivre une route un peu différente.
Ce qui ne diminue rieh de la vénération qu’on
doit avoir pour Schemféddin el Sa'idavi el D i-
mefchki,
A R A AA RR AA
C E R C L E DU MO D E Z I R A F K E N DJ
9*
Explication•
Au premier degré eff placé le titre commun à
tous les modes, el boud bil koull, intervalle dans
tous les tons.
A droite, dans chacun des intervalles , font les
noms de nombre Perfans, répondaut aux notes
qui font marquées en dehors du carre.
Les autres mots répandus dans les intervalles
indiquent les notes qu’on doit chanter, & comment
on doit paffer de l’une à l’autre.
Selon la table précédente, makhad^ fignifie la
première note ; & remarqiiez qu'à l’exception de
cette première note m a k h a d& de la dernière rik{,
toutes celles où l’on doit s’arrêter font défignées
par tertib, npte.
Pour faciliter la lefture de ce mode, chacune
des notes eff ici marquée d’un chiffre , félon l’ordre
.çù elle doit être «hantée. Ce chiffre n’eft point dans
l’original Arabe,
Le mot makhad% fe trouve dans l’intervalle tchafl
(quatre) qui répond à notre ré ; le mode zirafkend
commence donc par un re.
Au deffous , & dans l ’intervalle /? (trois) , on lit
houbouth, defeente, & plus bas yertib, note ; ce qui
veut dire : defeendez à la* note de l’intervalle f i ,
(trois) qui répond à l’ ut de notre gamme ; ainfi fa
leconde note eff ut.
Après tertib, & fur la même lignç , eff écrit afk
marche rapide ; c’ eft-à-dire, allez rapidement où
vous conduit la ligne afeendante , qui s’élève jui-
qu’à l ’intervalle fchefch (fix) : vous y trouverez
tertib , note, qui, placé dans cet intervalle, eff:
un fa.
Nota. Au lieu à'afk , marche rapide, le muficien
auroit pu employer aufli foôud bil efrâ, élévation
avec vîteffe ; mais afk eff plus court.’
Dans l’intervalle au-deffous eff écrit houbouth bil
efrâ , defeente avec vîteffe. Defeendez donc rapidement
jufqu’à l ’extrémité de la ligne perpendici^
• M* ij