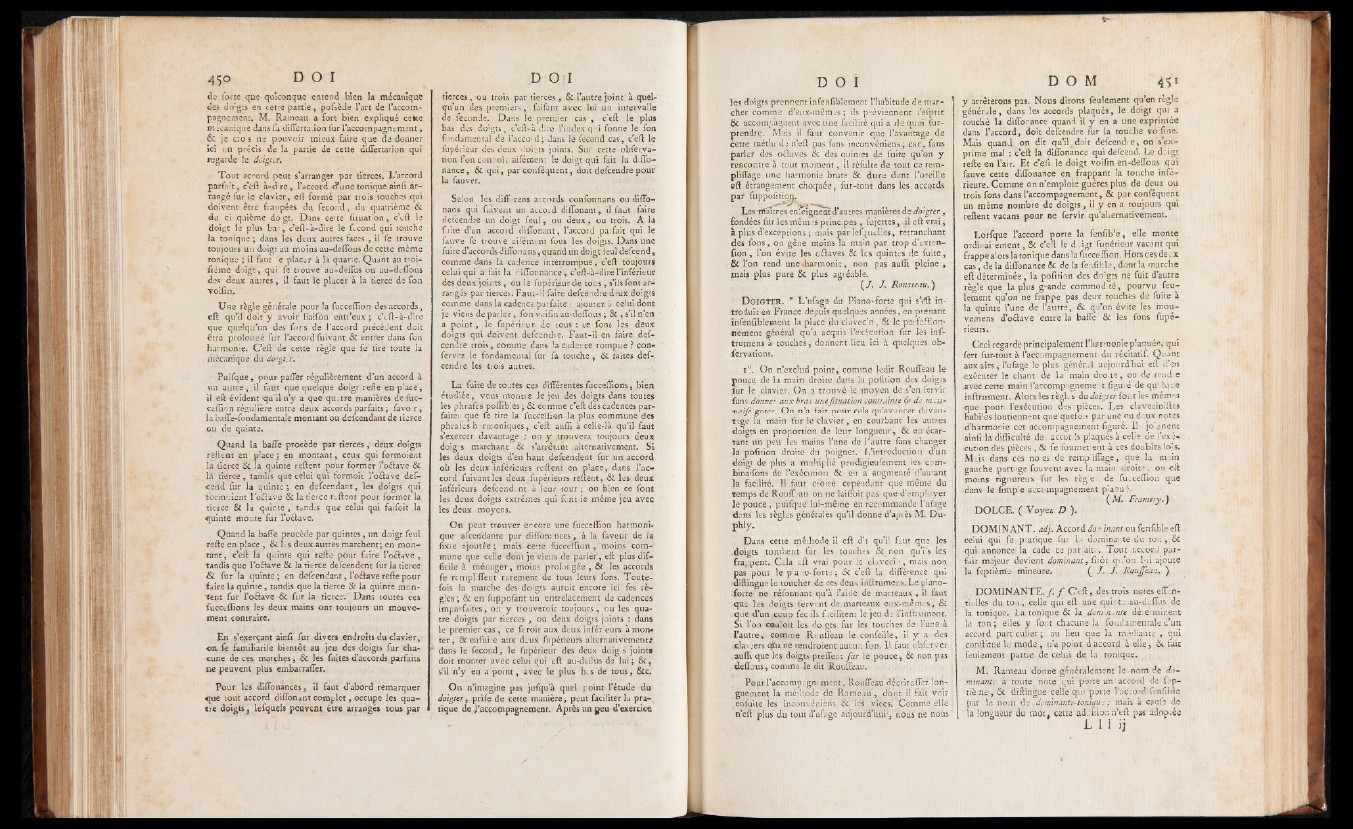
450 D O I
de forte qpe quiconque entend bien la mécanique
des do'gts en cette partie, pofsède l’art de l’accom-
pagnemenr. M. Rameau a fort bien expliqué cette
mécanique dans fa diflertaiion fur l’accompagnement,
& je crois ne pouvoir mieux faire que de donner
ici un précis de la partie de cette differtation qui'
regarde le doigter.
Tout accord peut s’arranger par tierces. L’accord
parfait, c’eft à-dre, l’accord d’une tonique ainfi arrangé
fur le clavier, eft formé par trois touches qui
doivent être frappées du fécond, du quatrième 6c
du cinquième dogt. Dans cette fituation, c’eft le
doigt le plus ba-:, c’eft-à-dire le fécond qui touche
la tonique ; dans les deux autres faces , il fe trouve
toujours un doigt au moins au-deffous de cette même
tonique ; il faut e placer à la quarte. Quant au troi-
fieme doigt, qui fe'trouve au-dëffus ou au-deflous
des deux autres, il faut lé placer à la tierce de fon
voifin.
Une règle générale pour la fucceffion-des accords,
eft qu’il doit y avoir liaifon entr'eux ; c’tft-à-dire
que quelqu’un des fors de l’accord précédent doit
être prolongé fur l’accord fùivant & entfer dans fon
harmonie. C’eft de cette règle que fe tire toute la
mécanique du doigter. ]
Puifque, pour-pâffer régulièrement d’un accorda
un autre, il faut que quelque doigt refte en place ,
il eft évident qu’il n’y a que qmtre manières de fuc-
cefticn régulière entre deux accords parfaits ; favo r,
la baffe-fondamentale montant ou defeendant de tierce
ou de quinte.
Quand la baffe procède par tierces, deux doigts
relient en place ; en montant, ceux qui formoient
là tierce la quinte reftent pour former l’oéfave &
M tierce , tandis que celui qui formoit l’o&ave defeend
fur la quinte ; en defeendant, les doigts qui
formoient l ’oéfave & la tierce reftent pour former la
tierce & la quinte , ' tandis que celui qui faifoit .la
‘quinte monte fur l’o&ave.
. Quand la baffe procède par quintes, un doigt feul
refte en:place , & les deux autres marchent; en montant
, c’eft la quinte qui refte- pour faire l’oétàve ,
tandis que l’oéiave & la tierce defeendent fur la tierce
& fur la quinte ; en defeendant, l’oâave refte pour
faire la quinte, tandis que la tierce & la q,uinte montent
fur l’o&ave & fur la tierce^ Dans toutes ces
fucceflions les deux mains ont toujours un mouvement
contraire.
En s’exerçant ainfi fur divers endroits du clavier,
on fe familiarife bientôt au jeu des doigts fur chacune
de ces marches, & les fuites d’accords parfaits
xte peuvent plus embarraffer.
Pour les diffonânees, il faut d’abord remarquer
que tout accord diffonant complet, occupe les quatre
doigts j lefquels peuvent être arrangés tous par
D 0 1
tierces , ou trois par tierces , & l’autre joint à quelqu’un
des premiers , faifant avec lai un intervalle
de fécondé. Dans le premier cas , c’eft le plus
bas des doigts, c’eft'-à-dire l’index q-,:i fonne le fon
fondamental de l’accoid; dans le fécohd cas, c’eft le
fupérieur des deux doigts joints. Sur cette obferva-
tion l’on connoît aifémeni le doigt qui fait la d.ffo-
nance, 8t qui, par conféquent, doit defeendre pour
la fauver.
Selon les diff.rens accords confonnans on diffo-
nans qui fui. vent un accord diffonant, il faut faire
defeendre un doigt feul, ou deux, ou trois. A la
fuite d’un accoid diffonant, l’accord parfait qui le
fauve fe trouve aifément fous les doigts. Dans une
fuite d’accords diffonans, quand un doigt feul defeend,
comme dans la cadence interrompue , c’eft toujours
celui qui a fait la ciffonnànce , c’eft-à-dire l’inférieur
des deux joints, ou lé fupérieur de tocs, s’ils font arrangés
par tierces. Faut-il faire defcendre dîux doigts
comme dans la cadence parfaite > ajoutez à celui dont
je viens de parler, fon voifin au-deffous ; & , s’il n’en
a point, le fupérieur de tous : ce font les deux
doigts qui doivent defeendre. Faut-il en faire defeendre
trois j comme dans la cadence rompue ? con-
fervez le fondamental fur fa touche , & faites defeendre
les trois autres. -
La fuite de toutes ces différentes fucceflions, bien
étudiée, vous montre .le jeu des doigts dans toutes
les phrafes poflibles ; & comme e’ëft des cadences parfaites
que fe tire la fuccefficm la-plus commune des
phrafes h~ rmoniques, c’eft aufli à celle-là qu’il faut
s’exercer davantage : on y trouvera toujours deux
doig s marchant & s’arrêtait alternativement. Si
les deux doigts d’en haut defeendent fur un accord
où les deux inférieurs reftent en place, dans l’ac-*
cord fuivantles deux fupérieurs reftent, & les deux
inférieurs defeend.nt à leur tour; ou bien ce font
les deux doigts extrêmes .qui font le même jeu avec
les deux moyens.
On peut trouver encore une fucceflion harmonique
afceri’dante par diffonânees, à la faveur de la
fixie ajoutée ; mais certe fuccemon , moins com-|
mune que celle dont je viens de parler , eft plus difficile
à ménager, moins prolongée les accords
fe rempliffent rarement de tous leurs fons. Toutefois
la marche des doigts auroit encore ici fes règles
; & en fuppofànt un entrelacement de cadences
imparfaites, on y trouveroit toujours, ou les quatre
doigts par tierces , ou deux doigts joints : dans
le premier cas, ce feroit aux deux infér eurs à mon*
ter, & enfuhe aux deux fupérieurs alternativement;
dans le fécond, le fupérieur des deux doig s joints
doit monter avec celui qui eft au-deflus de lui; & ,
s’il n’y en a point, avec le plus b; s de tous, &c.
On n’imagine pas jufqua quel point l’étude du
doigtery prife de cette manière, peut faciliter la pratique
de l’accompagnement. Après un peu d’exercice
d o i
les doigts prennent infenfifelement l’habitude de marcher
comme d’eux-mêmos ; ils préviennent l’efprit
& accompagnent avec une facilité qui a de quoi fur-
prendre. Mais il faut convenir que l’avantage de
cette méthedî n’eft pas fans inconvéniens ; car, fans
parler des oélaves 6c des quintes de fuite qu’on y
rencontre à tout moment, il réfulte de tout ce rem-
pliffage une harmonie brute 8c dure dont l’oreille
eft étrangement choquée, fur-tout dans lès accords
par fuppofitipjk^
Lesifiaîtres en.eigneat d’autres manières de doigter ,
fondées fur les mêmis principes , fujettes, jl eft vrai,
à plus d'exceptions ; mais pair lefquelles, retranchant
des fons, on gêne moins la main par trop d’exten-
fion, l’on évite les célaves 6c les quintes de fuite,
& l’on rend une »harmonie, non pas aufli pleine ,
mais plus pure 6c plus agréable.
(/. J. Rousseau. )
D oigter. * L’ufage du Piano-forte qui s’éft introduit
en France depuis quelques annéesen prenant
infenfiblement la place du clavecri , êç le perfectionnement
général qu’a acquis l’exécution fur les inf-
trumens à touches, donnent lieu ici à quelques ob-
feryations. •= ■ 1 '
i°. On n’exclud point, comme ledit Rouffeau le
pouce de la main droite dans la pofitîon des doigts
fur le clavier. On a trouvé le moyen de s’en fervir
fans donner aux bras uneJituation contrainte & de m ;u-
vaife grâce.. On n’a fait pour cela qu’avancer davantage
la main fur le clavier, en courbant les autres
doigts en proportion de leur longueur, 6c en écartant.
un peu les mains l’une de l’autre fans changer
la pofition droite du poignet. L’introduction d’un
doigt de plus a multiplié prodigieufement les ccm-
binaifons de l’exécution 6c en a augmenté d’autant
la facilité. Il faut croire cependant que même du
temps de RouflVau on ne laiffoit pas que d'employer
le pouce , puifque lui-même en recommande i’ufage
dans les règles générales qu’il donne d’après M. Du-
phly.
Dans cette méthode il eft d‘t qu’il faut que les
.doigts tombent fur les touches 6c non qu’i's les
frappent. Cela eft vrai pour le clavecin, mais non
pas pour le p’ano-forte ; ôc c’eft la différence qui
diftingue le:toucher deces deux inftrumens. Le piano-
forte ne réfonnant qu’à l’aide de marteaux ,■ il faut
que les doigts fervent de; marteaux eux-mêmes, 6c
que d’un .coup fec ils facilitent le jeu de l’inftrum&nt.
Si l’on couloit les doigts fur les touches de l’une à
l’autre^ comme Rouffeau le confeille, il y a des
daviers qlÉu.'ne rendraient aucun fon. Il faut cbferver
aufli que les doigts preffent fur le pouce, 6c non pas
deffous, comme le dit Rouffeau,.
Pour raccompagne ment, Rouffeau décrit affez Ion-,
guement la méthode de Rameau, dont il fait voir
enfyite les inconvénieds 6c "les' vices! Çomlue elle
n’eft plus'du tout d’ufage aujourd’hui^, nous ne nôùs
D O M 4 5 1
y arrêterons pas. Nous dirons feulement qu’en réglé
générale, dans les accords plaqués, le doigt qui a
touché la diffonance quand il y en a une exprimée
dans l’accord, doit defeendre fur la touche voifine.
Mais quand on dit qu’il4doit defeendre, on s’exprime
mal : c’eft la diffonance qui defeend. Le dfigt
refte en l’air. Et c’eft le doigt voifin en-deffous qui
fauve cette diffonance en frappant la touche inférieure.
Comme on n’emploie guères plus de deux ou
trois fons dans l’accompagnement, ÔC par conféquent
un même nombre de doigts , il y en a toujours qui
reftent vacans pour ne fervir qu’aUernativement.
Lorfque l’accord porte la fenfib’e , elle monte
ordirai-ement, 6c c’eft le doigt fupérieur vacant qui
frappe alors la tonique dans la fucceffion. Hors ces deù*.
cas, de la diffonance 6c de la fenfifcte, dont la marche
eft déterminée, la pofition des doigts ne fuit d’autre
règle que lapins grande commodité, pourvu feulement
qu’on ne frappe pas deux touches de fuite à
la quinte l’une de l’autre, 6c qu’on évite les mou-
vemens d’o&ave entre la baffe 6c les fons fupérieurs.
.
Ceci'regarde principalement l’harmonie plaquée, qui
fert fur-tout à l’accompagnement du récitatif. Quant
aux a i r s l’ufage le plus général aujourdhui eft d’en
-exécuter le chant de la main droite, ou de rend:®-
avec cette main l’accompagnement figuïé de quelque
inftrument. Alors les régi, s du doigter fout les mêmes
que pour l’exécution des pièces. Les claveciniftes
habiles foutiennent que'qnefois par une ou d;:ux rotes
d’harmonie cet accompagnement figuré. Il joynent
ainfi la difficulté de> accords plaqués à celle de l’exécution
des pièces , & fe foumetrent à ces doubles lois.
Mais dans ces no es de remp iflage, que la main
gauche partage fouvent avec la main droite . on eft
moins rigoureux fur les règ es de fucceflion que
dans le fimp'e accompagrtement plaguè.
(M. Framery.)
DOLCE. ( Voyez Z) ).
DOMINANT, adj. Accord do rmant ou fenfible.eft
celui qui fe pratique fur h dominante du ton , &
qui annonce la cade ce parfaitr. Tout accord parfait
majeur devient dominant, fifôt qu’on lui ajoute
la feptièm'e mineure. ( J. J. Rmffeau. )
DOMINANTE, ƒ. ƒ C’eft, des trois notes eff;n-
tielles du ton, celle qui eft une quinte au-dtffus . de
la tonique. La, tonique & la dom n-nte dé:e; minent
le ton; elles y font chacune la fondamentale ù’un
accord particulier; au lieu que la màdiante , qui
conftitue le mode , n’a point d accord à elle, & fait
feulement partie de celui de la tonique.
M. Rameau donne généralement le.nom de dominante
à toute note.qui pot'te un accord de f.'p-
tième, & diftingue celle porte l'accord ftnfible
par le nom de. dominante-tonique ; mais à caufs de
la longueur du mott cette adjition n’eft pas adoptée
JL 11 ij