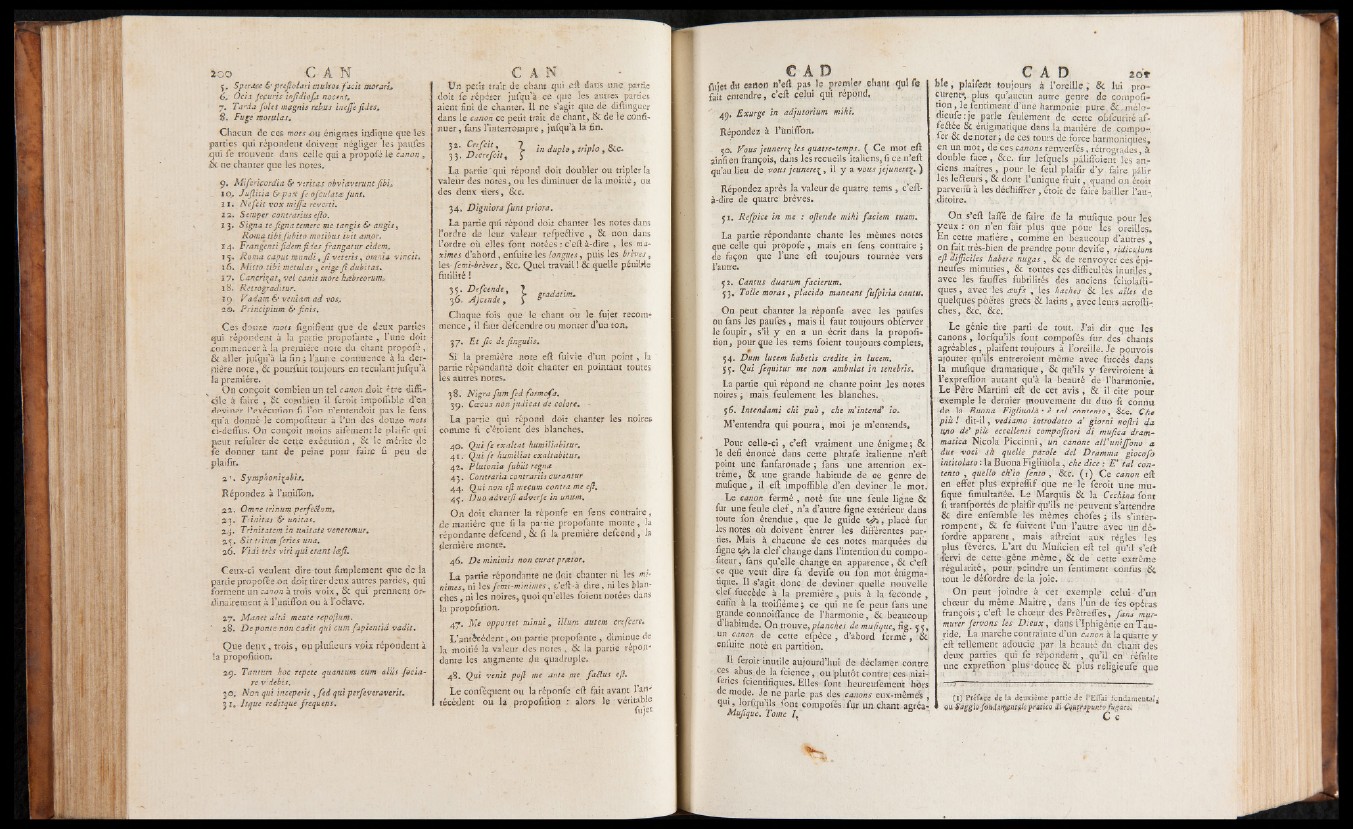
200 C A N
<$. Sptr&rc & prefiolari multos Jack morari,
6. Ocia Jepuris infidiofii noctnt,
7. Tarda fo l et magnis rebus ineffe fides,
S. Fuge morulas.
Chacun dç ces mats ou énigmes indique que les,
parties qui répondent doivent négliger les paufes
ipii fe trouvent dans celle qui a propofé le canon,
48c ne chanter que les notes.
ç . Miferiçordia 6* veritas dbviaverunt fibi,
_ 1Q. Jufiitia & p j .'k fe ofculat# /uni,
11 . N e f cil vox rnijfa revertu
12. Seràper contrarias eflo.
S 3* S lSna te figna temere me tandis & angis,
Roma tibifubito motibus ibit am.or.
14. Frangenti fidem fides frangatur eidem.
1 5-. Roma çapui mundi f f i veteris, àmnia vinpit.
i-6. Mitto tibï metulas , érigé f i dubitas.
j 7. Canpriçat, vel canit more habreorum,
18. Retrograditur.
19 Vddam & veniam ad vosï
20. Principium & finis.
Ces douze mots lignifient que de deux parties
qui répondent à la partie propofante , l’une doit
commencer à la première note dit chant prppôfé ,
& aller jyfqy’à la fin ; l ’autre.commence à la derrière
note, & poursuit toujours en reculant jufqu’à
la première.
On conçoit combien un tel canon doit être difficile
à faire , combien il feroit impofliblp d'en
deviner l’exécution fi l’on n’pntendoit pas le fens
qu*a donné lé compofiteur à l’un des douze mots
ci-deffus. On conçoit moins aifémentle plaifir qui
peut refulter de cette exécution , & le mérite de
fe donner tant de peine pour faim fi peu de
plaifir.
2 ', Symphoni\abis,
Répondez à runiflbn,
2.2. Omne trinum perfettum,
2 j . Triait as & unit as.
24. Trinitatem in unïiate veneremur.
2,5.. Sit trium fériés una,
26. Vidï très viri qui erant lafi.
Ceux-ci veulent dire tout fimplement que de la
partie propoféeen doit tirer deux autres parties, qui
forment un canon à trois v o ix , & qui prennent ordinairement
à l’iinifibn ou à Toâave.
2,7. Manet altd mente repofium.
I 28. De ponte non cadit qui ciifn fapientid vadit.
Que d e y x , trois, ou plufieurs voix répondent à
la proportion.
29. Tantum hoc répété quantum cum alits feciare
videbis.
30. Non qui inceperit ,fed qui perfeveraverit,
1 1, Itque redit que freqtiens.
C A N
Un petit trait de chant qui eft dans une partie
doit fe répéter jufqu’à ce que les autres parties
aient fini de chanter. 11 ne s’agit que de diftinguer
dans le canon ce petit trait de chant , & de le continuer
, fans l’interrompre, jufqu’à la fin.
3 2. Crefcit, ? duplo, triplo, &C.
33. Deerefcit, Ç r » r »
La partie qui répond doit doubler ou tripler la
valeur des notes , 011 les diminuer de la moitié, ou
des deux tiers, Scç,
34. Digniora funt priora.
La partie qui répond doit chanter les notes dans
Tordre de leur valeur refpeéfive , & non dans
l’ordre où elles font notées : c’eft à-dire , les maximes
d’abord, enfuite les longues, puis les brève s ,
les ' fe mi-brève s , &c. Quel travail ! & quelle pénible
futilité !
35. Defcende,
36. Ajcende 9 1>
gradatim,
Chaque fois que le chant ou le fujet recommence
, il faut defeendre ou monter d’un ton.
37. Et fie de fingutis.
Si la première note eft fuivie d’un point, la
partie répondante doit chanter en pointant toutes
les autres notes.
38. Nigra fum fed formofa,
39. Ccecus nûn judicat de colore, -
La partie qui répond doit chanter les noires
comme fi ç’étoient des blanches.
40. Qui fe exaltat humiliabitur.
41. Qui fe humiliât exaltabitur,
42. PLutonia fubüt régna
43. Contraria contrariis curantur
44. Qui non efi meçum contra me efl, .
4^. Duo adverfiadverje inunum,
On doit chanter la réponfe en fens contraire,
de manière que fila partie propofante monte, la
répondante defeend, ql fi la première defeend, la
dernière morne.
46. De minimis non curât prator,
La partie répondante ne doit chanter ni les M-
aimes, ni les femi-minimes, p’e.ft-à dire, ni les blanches
, ni les noires, quoi qu’elles foient notées dans
l;a propofifion.
47. Me opporfet mi nui, ilium autem erefeere.
L ’antécédent, ou partie propofante , diminue de
la moitié la valeur des notes , & la partie répondante
les augmente du quadruple.
48. Qui venit pofi me ante me faflus efi.
Le conféqyent ou la réponfe efi fait ayant l’an'
técédent ou la propofifion ; alors le véritable
. fujet
C A D Z O t
fujet dtf canon n’eft pas Je premier chant qui fs
fait entendre, c’eft celui qui répond,
’ 49. Exurge in adjutorium mih'u
Répondez à l’ùnifibn.
50. Vous jeunere^ les quatre-temps. ( C e mot efl:
ainfien françois, dans les recueils italiens, fi ce n’eft
qu’au lieu de vous jeunere^, il y a vous jejunere^, )
Répondez après la valeur de quatre tems, c’éfl-
à-dire de quatre brèves.
, C A D
b le , plaîfem toujours à l’oreille ; & lui procurent*,,
plus qu’aucun autre genre de compofi-
tion, le Sentiment d’une harmonie- pure, & ,mélo-
dieufe : je parle feulement de cette obfcuriré af-
feélee & énigmatique dans la manière de compo-,
fer & de noter j de ces tours de force harmoniques,
en un mot, de ces canons renverfés, rétrogrades, à
double fa c e , &c. fur lefquels pâliflbient les anr
ciens maîtres, pour le feul plaifir d’y faire pâlir
les leéïeurs, & dont l ’unique fruit, .quand on étoit
parvenu à les déchiffrer , étoit de faire bailler l’auditoire.
c i. Refipice in me : ofiende mihi faciem tuatn,
La partie répondante chante les mêmes notes
que celle qui propofe, mais en fens contraire ;
de façon que l’une efl toujours tournée vers
l’autre.
52, Cantus duarum facierum,
33. Toile moras, placïdo maneant fufpiria cantu.
On peut chanter la réponfe avec les paufes
ou fans les paufes , mais il faut toujours obferver
le foupir, s’il y en a un -écrit dans la propofi-
tion, pour que les tems foient toujours complets,
54. Dum lucem habetïs c r éd itin lucem,
53. Qui fequitur me non ambulat in tenebris,
La partie qui répond ne chante point les notes
noires ; mais feulement les blanches.
56. Intendami chi pub , che mintend* io.
M’entendra qui pourra, moi je m’entends.
Pour celle-c i, c’eft vraiment une énigme ; &
le défi énoncé dans cette phr?fe italienne n’eft
point une fanfaronade ; fans une attention extrême,
& une grande habitude de oe genre de
mufique, il efl impoflible d’en deviner le mot.
Le canon fermé , noté fur une feule ligne &
fur une feule c le f, n’a d’autre figrte extérieur dans
toute fon étendue, que le guide Wî , placé fur
les notes où doivent entrer les différentes ■ parties.
Mais à chacune de ces notes marquées dû
: ligne la c le f change dans l’intention du compofiteur
, fans qu’elle change en apparence, & c’eft
ce que veut dire fa devife ou ion mot énigmatique.
Il «’agit donc de deviner quelle nouvelle
clef fuccède à la première , puis à la fécondé ,
erîfîn à la troifième ; ce qüi ne fe peut fans une
grande connoiffance de l’harmonie, & beaucoup
d habitude. On trouve,planches de mufique, fig. 55,
,unr c.anon de cette efpèce , d’abord fermé, &j
.enfuite noté en partition.
Il feroit inutile aujourd’hui de déclamer contre
ces abus de, la fcience, ou plutôt contre: ces- niai-1
ienes feientifiques. Elles- font heureufement hors
de mode. Je ne parle pas des canons eux-mêméè ,
qui lorsqu'ils font compofés.ffijr. un. chant aeréa-
Mfifique, Tome I f
On s’eft laffé de faire de la mufique pour les
yeux : on n’en fait plus que pour les .oreilles.
En cette matière, comme en beaucoup d’autres",
on fait trèsdfien de prendre pour devife , ridiculunt
efl difficiles habere nugas , & de renvoyer ces épi—
neules minuties, & toutes ces difficultés inutiles,
avec les fauffes fubtilités des anciens fçhplafti-
ques, avec les a t u f s les haches & les ailes de
quelques poètes grecs & latins, avec leurs acrpfti-
ches, &c. &c.
Le génie tire parti de tout. J’ai dit que les
canons, lodqu’ils font compofés fur des chants
agréables , plaifent toujours à l ’oreille. Je pouvois
ajouter qu’ils entreroient même avec fuccès dans
là. mufique dramatique, & qu’ils y ferviroient à
Texpfeflîon autant qü’à la beauté de Tharmonie.
Le Père Martini eft de cet avis , & il cite pour
exemple le dernier mouvement du duo fi connu
de la Buona Figliuolà : è tal contenta, & c . Che
piit ! dit-il, vediamo introdotto a* giorni nofiri da
vjio de' piu eccellenti compofitori di mufiica dram-
maticâ Nicola Piccinni, un canone alTuniffono a
due voci sà quelle parole del Dramma giocofo
intitolato : la Buona Figliùola, che dïce : E ’ tal con-
lento , quelle cKio fento , &c. ( i ) Ce canon eft
en effet plus expreflif que ne le feroit une mufique
fimultaàée. Le Marquis & la Céchina font
fi tranfportés ,de plaifir qu’ils ne peuvent s’attendre
& dire enfemble les mêmes chofes ; ils s’interrompent,
& fe fûivent l’im l’autre avec un dé-
fordre apparent, mais aftreint aux régies les
plus févéres. L’art du Muficien. eft tel qu’il s’eft
lèrvi de cette gêne même, & de' cette extrême
| .régularité, pour peindre un fentiment confus 8c
tout le défordre de la joie. ..
On peut joindre à cet exemple celui d’un
choeur du même Maître, dans l ’un de fes opéras
françois ; c’eft le choeur des Prêtreffes, fans murmurer
fervons les Dieux y dans l’Iphigénie en Tau-
ride. La marche contrainte d’un canon à la quarte y
eft tellement adoucie par la beauté du chant fies
deux parties qui fe répondent, qu'il en réfuîte
une expreffion plus dpucç & plus religieufe que
(l) Ptéfaçe de la deuxième partie de l’Eflai fondamental^
ou Saggio fond.vantaii pratico di Çqnifapunto fugato,
C c