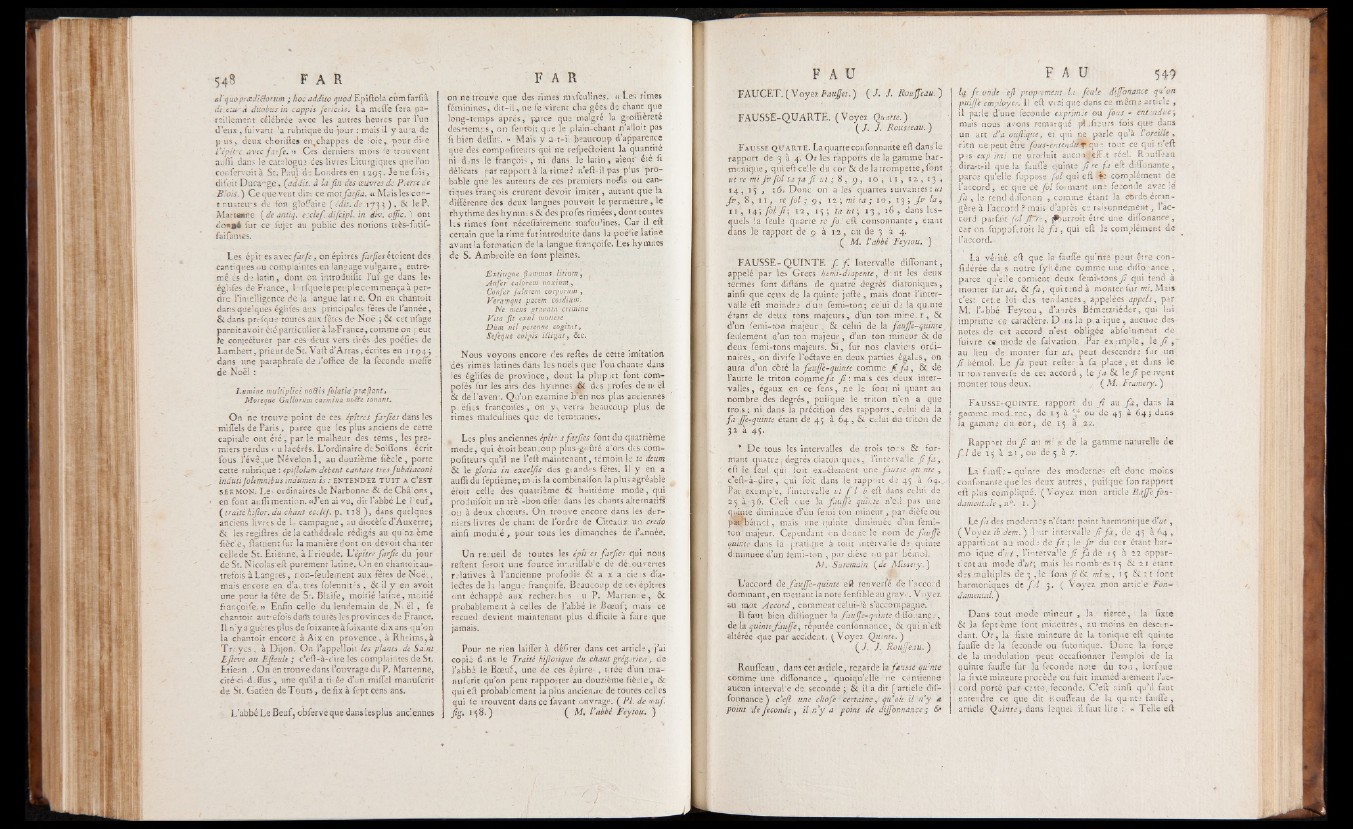
ai quopr&di florum ; hoc addito quod Epiftola cum farfiâ
dlseru.-«t duobus in cappis fcricàs. La méfié fera pareillement
célébrée avec les autres heures par l’un
d ’eux , fuivant la rubrique du jour : mais i-1 y aura de
p u s , deux choriftes en^chappes de foie,. pour dire
i yépitrc avec fa r fe .» Ces derniers mots <e trouvent
aufii dans le cataloguj* des livres Liturgiques que l’on
cor.fervoit à St. Paul de Londres en 1295. Je ne fais,
difoit Duca*l g e , (addit. à la fin des oeuvres de Pierre de
B 'ois. ) C e que veut dire ce mot farfia. « Mais lès con-
t nuateurs de fon gloffaire (cdit.de 1733 ) , & le P,
Marteaue ( de anùq. ecclef difcj.pl. in âïv. ojfic. ) ont
donné fur ce fujet au public des notions très-iatif-
faifanies.
Les é pires avec farfe, on épîtres farfies éteient d e s .
cantiques ou complaintes en langage v ulg a ire, entre-
m e t s de latin, dont on introduint Puf ge dans les
églifes de France, 1 nrfque le peuple commença à perdre
l’inielligence de la langue lârr.e. On en chântoit
dans quelques églifes aux principales fêtes de l’année,
& dans prdque toutes aux fçtes d e N o e ; & cet ufage
pa rc îtavoir été particulier à la-France , comme on peut
Je conjeâurer par ces deux vers tirés des poéfies de
Lambert, prieur de St. Vaft d’A r ra s , écrites en 1194;
dans une paraphrafe de l’office de la fécondé méfié
de Noël :
Lamine multiplici noStis folatia'preeflant,
Moreque Gnllomm carmina no&'e tonant.
On ne trouve point de ces épîtres farfies dans les
miffels de Paris, parce que les plus anciens de cette
capitale ont é té , par le malheur des tems, les premiers
perdus < u lacérés. L ’ordinaire de Solfions . écrit
fous l’évêque N é v e lo n I , au douzième f iè c ie , porte
cette rubrique : epïfiolam debent cantate trèsJubdiaconi
ïnduti Jolemnibus ïndumemis : ENTENDEZ tu it a c’est
SERMON. Le-> ordinaires de Narbonne & de C hâ on s 9
en font aufii mention. «J’en ai vu, dit l’abbé Le F euf ,
( traité hiflor. du chant ecclèj. p. 1 1 8 ) , dans quelques
anciens livres de L campagne , au diocèfe d’Auxerre;
& les regiftres de la cathédrale rédigés au quinzième
fîèc’.è, fiatuentfur la manière dont on devoit chanter
cellede St. Etienne, à Erioüde. L ’épître farfie du jour
de St. Nicolas'êfi purement latine. On en chântoit autrefois
àLangrês, non-feulement aux fêtes'de Noë< .
mais encore en d’autres folennités , & il y en avoit
une pour la fête de Sr. Blaife, moitié latine, moitié
françoife.» Enfin celle du lendemain de, N.. ël , fe
chântoit autrefois datîs toutès les provinces de France.
Il r fy a guèresplus de foixante àfoixante dix ans qu’on
la chântoit encore à A ix en provence , à Rheims, à
Trr y e s , à Dijon. On l’appelloit les plants de Saint
Efleve ou Efieule ; c’ ëfr-à-cüre les complaintes de St.
Etienn.. O n en trouve dans l’ouvrage du P. Martenne,
c ité e i-d .f fu s , une qu’il a ti> ée d’un mifiel manûfcrit-
de St. Gatien de T o u r s , de fix à fept cens an$.
L ’abbé L e B euf, obferve que dans lesplus anciennes
on ne trouve que des rimes nmfculines. « L e s rimes
féminines, dit-il j ne fe virent, cha gées de chant que
long-temps ap rè s, parce que malgré la grofiièreté
des »temps, on fentbit. que le plain-chant ri’alloit pas
fi bien deffus. » Mais y a-t-i! beaucoup d’apparence
que des compofiteurs qui ne relpeéloient la quantité
ni dms le françois, ni dans le la t in , aient' été fi
délièats par rapport à la rime? n’eft-il pas plus probable
que les auteurs de ces premiers noifis ou cantiques
françois crurent devoir imite r, autant que la
différence des deux langues pouvoit le permettre, le
rhy thme des hymne s & des profes rimées, dont toutes
k s rimes font néceflâirement niafeu’ines. Car il eft
certain que la rime futintroduite dans la poë’ielatine
avant la formation de la langue françoife. Les hymnes
de S. Ambroife en font pleines.
Extingue flammes lititim,
si u fer calorem itoxium,
Confer falutem corporum ,
Veramque pacém cbrdüun.
Ne mens gravata crimine
Vita fît exul inunere
Dùm nil perenne cogitât,
Sefeque 'culpis illigqt, &c.
Nous voyons encore des refies de cette imitation
‘des rimes latines dans les noëls que l’on chante dans
les églifes de p rovince , dont la plupirt font com-
pofés fur les airs des hymnes , & des proies de ne ël
& de l ’aven:. Q u ’on examine b en nos plus anciennes
p.ëfie s françoifes , on yy verra beaucoup plus de
rimes mafculines que de féminines.
Les plus anciennes èpîtr. s farfies font du quat rième
mode, qui étoitbeaucoup plus-goûté a’ors des com-
pofiteurs qu’il ne l’eft maintenant, témoin le te deurn
& le gloria in excelfis des grandes fêtes. 11 y en a
aufii du feptième; mais la combinaifon la plus agréable
étoit celle des quatrième & huitième mode, qui
produifoit un trè,-bon effet dans les chants alternatif
-ou à deux choeurs. O n trouve encore dans les derniers
livres de chant de l’ordre de Cîteaux un credo
ainfi m o d u lé , pour tous les dimanches de Tannée.
Un recueil dé toutes les épîtes farfies qui nous
relient fcroit une fource intarifiâb'e dé dé .ouvertes
relatives à l’ancienne profodie & â x apcié.îs dia-
leéfes de la langue françoife. Beaucoup de ces épîtres
ont échappé aux recherches . u P. Martenne, &
probablement à celles de l ’abbé le Boeuf; mais ce
recueil devient maintenant plus difficile à faire que
jamais.
Pour ne rien laiffer à défirer dans cet article, j ’ai
copié d ms le Traité hifiorique du chant grégorien, de
i’abbé le Boe u f, une de ces é pitre- , tirée d’un manu
fer it qu’on peut rapporter au douzième fiè c ie , &
q uiefi probablement la plus ancienne de toutes celles
qui le trouvent dans ce favant ouvrage. (P/ , de muf
fig. 1 5 8 .) ( M. l ’abbé Feytou. )
F A U
F A U C E T . ( V o y e z Faufjet. ) ( /. J. Rouffeau. )
F A U S S E -Q U A R T E . (V o y e z Quarte.')
(J . J. Rousseau.)
Fausse qu a r te . La quarte cpnfonnante efi dans le
rapport de 3 à 4. O r les rapports de la gamme harmonique,
qui' eft-celle du cor & de la trompette, font
ut re mi fv fol ta ja f i ut ; 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 -*
14, 15 , 16, Donc on a les quartes suivantes : ut
f v , 8 , 1 1 , re fol ; 9 , 12 ; mi ta ; 10 , 1 3 ; f v la ,
1 1 , 14 ; fol fi-, 1 2 , 1 5 ; ta ut ; 1 3 , 1 6 , dans lesquels
la feule quarte re fo l eft consonnante, étant
dans le rapport de 9 à 1 2 , ou de 3 3 4.
( M. l'abbé Feytou. ) .
F A U S S E -Q U IN T E f f i Intervalle diffonant,
appelé par les Grecs htmi-diapentedent les deux
termes font difiâns de quatre degrés diatoniques,
ainfi que. ceux de la quinte ju fte , mais dont l’intervalle
efi moindre d'un femi-ton; celui de la qu.nte
étant de deux tons majeurs, d’un ton min e ..r , &
d’un femi-ton majeur , & celui de la fanffe-quinte
feulement d’un ton majeu r, d’un ton mineur & de
deux femi-tons majeurs. S i , fur nos clavieis ordinaires,
on divife l’o â a v e en deux parties égales, on
aura d’un côté la fauffe-quinte comme f i f a , & de
l’autre le triton commefa f i : mais ces deux intervalles
, égaux en ce fens, ne le font ni quant ail
nombre des degrés, puifque le triton n’en a que
trois; ni dans la précifion des rapports, celui de la
fa Jfe-quinte étant de 45 à 64 , Si. celui du triton de
32 à 45.
* D e tous les intervalles de trois tors & formant
quatre/degrés diatoniques,, l’in tervalle f i f a 9
éft le feuî qui lpit exoéfement une fausse qu nte ,
c’eft-à-dire, qui foit dans le rapport de 45 à 64.^
Par exrmp'e, l’intervalle ut f L b eft dans celui de
25 à ■ 36. C ’eft c.ue la fauffe quinte n’efi pas une
quinte diminuée d’un femi ton mineur, par dièfe ou
pâ^berne 1 , mais une quinte, diminuée d’un femi-
ton majeur. Cependant on donne le nom de fauffe
quinte dans la pratique à tout mterva'le de quinte
diminuée d’un lemi-ton , par dièse c-u par bémol. *
AJ. Suremain {de Missey.'j
L’accord de fauffe-quinte efi renverfé de l’accord
dominant, en mettant la note fenfible au grave. V o y e z
au rapt Accord, comment celui-là s’accompagne.
Il faut bien difiinguer la fauffe-quinte, d fiïbranç.',
de la quinte fauffe, réputée confonnance, & qui n’ eft
altérée que par accident. (V o y e z Quinte.')
f j . J. Rouffeau. )
Rauffeau , dans cet article, regarde la fausse qu’nte
comme une diffonance, quoiqu’elle ne contienne-
aucun interval e de seconde ; & il a dit ( article dif-
fonnance ) de fi une chofe : certaine qu oh il n y a
point de fécondé , U n y a point de diffonnan.ee j &
l<i fe tonde efi proprement la feule diffonance qu on
puiffe employer. Il eft v ra i que d ans ce m em ; a r tic le ,
il parle d ’une fécondé exprimée o u fous - entendue;
mais nous a v o n s remarqué p i j fleu r s fo is q u e dans
un art d’a oufiique, et' qui ne p a r le qu ’ à l'oreille,
rien ne peut être fo u s -e n te n d u ^ q u j. to u t ce qui n’eft
pis exprimé ne produ it aucuniqeff.t réel. R o u f fe a u
dira-t-il qu e la fauffe q u in te f i re f u eft d iffo n a n te ,
parce qu ’e lle fuppose fol qui e f i *e com p lém en t de
l’a c c o rd , e t qu e ce fol formant une fé con d é av e c le
f a , le. rend dvffonan , com m e é tan t la cPrde é trang
è re à l ’a c co rd ? mais d’après ce ra iso n n em e n t, l’accord
parfait fol f iT r e , {Pburroit ê tre une d iffo n a n c e ,
c a r on fu p p o fe ro it lé f a , qui e ft le c om plém en t de
l’a cco rd . »
La v é r it é , eft que la fauffe eu nte p eu t ê tre con -
fid é rée da- s n o tre fy liêm e c om m e une dilTo-ance ,
parce qu ’e lle con tient d eu x femi-to n s f i qui tend à
mo n te r fur ut, El fa , q u i tend à monter fu r mi. M a is
c’est cet'.e lo i des te n d a n c e s , ap pe lé es appels, par
M . l’dbbq F e y t o u , d’après B ém e t z r ié d e r , qui lu i
im p r im e c e caraélère. D ms la p . a d q u e , aucune des
notes de cet accord n’est o b lig é e a b fo 'um en t de
fu iv re ce mode de fa lv a tion . P a r e x em p le , le f i
au lieu de m onrer fu r ut, peu t descendre fu r un
f i bémo l. L e fa p eu t refter à fa p la c e , e t d in s le
tr ton ren ve rfé de c e : a cco rd , le fa & \efi p eu v en t
j m o n te r tous d eu x. (M . Framery.)
Fausse- quinte, rap p o rt du f i au f a , dans la
g amm e m o d e rn e , de 15 à -y- o u de 45 à 6 4 ; d ans
la gamme du e o r , d e 15 à 22.
R a p p o r t du f i au m': de la g am m e na turelle de
ƒ . / de 15 à 21 , ou de 5 à 7 .
L a f a i f f : - quin te d e s modernës e ft d on c moins
- con fon ante qu e les deux a u t r e s , pu ifqu e fo n r ap p o r t
e ft plus com p liq u é . ( V o y e z mon a rticle Baffe fondamentale
, n°. . 1 . )
L efa des m ode rne s n’étant po int ha rmon iqu e à ’ u t ,
( V o y e z ibdem. ) 1 :i;r in terv a lle f i fa , -de 43 à 64 ,
appartient au mo de A q fa ; le f v du c o r étant h a r -
mo iq ue d’ u t , l’iu te rv a ’ le f i f a de 1 5 à 22 ap p a r tient
au mo de à ’u t\ mais l e s n om b e s 13 & 2 1 étant
des multiples de 3 , le Tons f i & m i t s , 13 & 21 ^ORt
ha rmoniques de f o l 3 . ( V o y e z m o n article Fondamental.
)
D a n s to u t mode m in eu r , -la t ie r c e , la fixte
& ,1a feptième font m in eu r e s , s u mo ins en descendant.
O r , la fix te mineure de la to n iq u e eft quinte
fauffe de la fé con d é ou fu toniq ue . D o n ç la fo r c e
de la mo du la tion peut o cca fio n n e r l’em p lo i de la
quinte fauffe fur la fé cond é n o te du to n , lo r lq u e
la fix te mineure pro c èd e o u fu it imméd aievnent l’ac-
. co rd p o r té p a r - c e t te , fé c o n d é . C ’éft r.infi qu ’ il faut
entendre ce que d it Rouffeau de la quinte fa u f fe ,
a rticle Quinte, dans lequel il faut lire : « T e l le éft