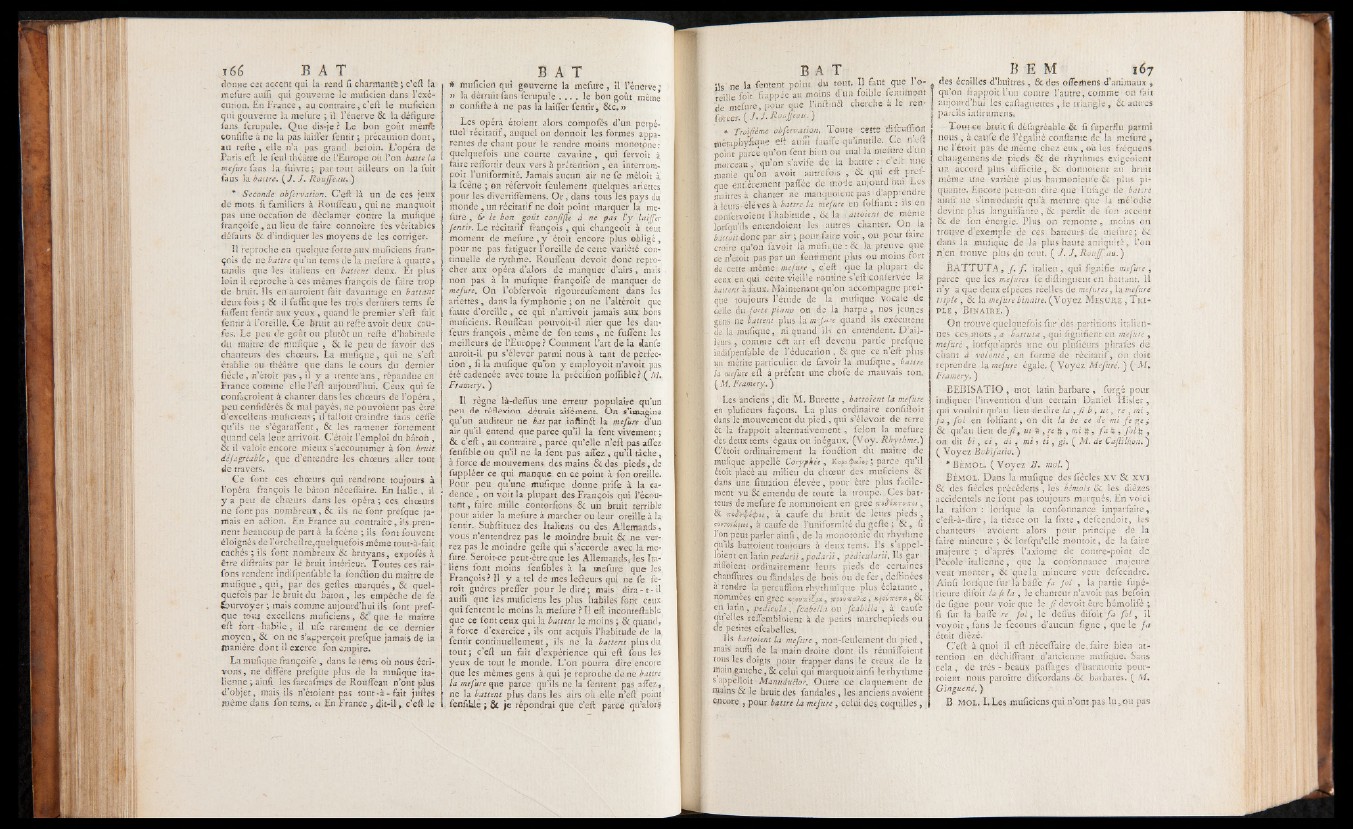
i 6 6 B A T
donne cet accent qui la rend fi charmants; c’eft la
mefure auffi qui gouverne le muficien dans l’exécution.
En France, au contraire, c’eft le muficien
qui gouverne la mefure ; il l ’énerve & la défigure
fans 1 crapule. Que dis-je ? Le bon goût mênrfè
confifie à ne la pas laifl'er fentir ; précaution dont,
au refie , elle n’a pas grand beîoin. L’opéra de
Paris efi le feul théâtre de l’Europe où l’on batte la
mefure fans la fui-vre; partout ailleurs on la fuit
tans la battre. ( 7. J. Rouffeau. )
* Seconde obfervation. C ’eft là un de ces jeux
de mots fi familiers à Rouffeau, qui ne manquoit
pas une occafion de déclamer contre la mufique
françoife, au lieu de faire connoître fes véritables
défauts & d’indiquer les moyens de les corriger.
Il reproche en quelque forte aux muficiens fran-
çois de ne battre qu’un tems dè la mefure à quatre,
tandis que les italiens en battent deux. Et plus
loin il reproche à ces mêmes françois de faire trop
de bruit. Ils en auraient fait davantage .en battant
deux fois ; & il fuffit que les trois derniers tems fe
fa fient fentir aux yeux , quand le premier s’efi fait
fentir à l’oreille. Ce bruit au refie avoit deux cau-
fes. Le peu de goût ou plutôt un refie d’habitude
du maître de mufique , & le peu de favoir des
chanteurs des choeurs. La mufique, qui ne. s’efi
établie au théâtre que dans le cours du dernier
fiècle , n’étoit pas , il y a trente ans , répandue en
France comme elle l’eft aujourd’hui. Ceux qui fe
confieraient à chanter, dans les choeurs de l’opéra,
peu confidérés & mal payés, ne pouvoient pas être
d’excellens -muficiens ; il falloir craindre fans cefle
qu’ils ne s’égaraffent, & les ramener fortement
quand cela leur arrivoit C ’étoit l’emploi du bâton ,
8c il valoit encore mieux s’accoutumer à fon bruit
défagréable, que d’entendre les choeurs aller tout
de travers.
Ce font ces choeurs qui rendront toujours à
l’opéra françois le bâton néceflaire. En Italie., il
y a peu de choeurs dans les opéra; ces. choeurs
ne font pas nombreux, & ils ne font prefque jamais
en acïion. En France au contraire, ils prennent
beaucoup de part à la fcène ; ils font fou vent
éloignés de l’orchefire,quelquefois même tout-à-fait
cachés ; ils font nombreux & bruyans, expofés à
être difiraits par le bruit intérieur. Toutes ces rai-
fons rendent indifpenfable la fonction du maître de
mufique, qui, par des gefies marqués, & quelquefois
par le bruit du bâton, les empêche de fe
É>urvoyer ; mais comme aujourd’hui ils font prefque
tous excellens muficiens, 8c1 que 4e maître
efi fort -'habile., il ufe rarement de ce dernier
moyen, & on ne s’apperçoit prefque jamais de la
manière dont il exerce fon empire.
La mufique françoife , dans le tems où nous écrivons,
ne diffère prefque plus de la mufique italienne
; ainfi les farcafmes de Rouffeau n’ont plus
d’objet, mais ils n’étoient pas tout-à-fait juftes
même dans fon tems. « En France , d i t - i l c ’eft le
B A T
# muficien qui gouverne la mefure, il l’énerve i
” la détruit fans fcrupule . . . . le bon goût même
» confifie à ne pas la lai fier fentir, & c .»
Les opéra étoient alors compofés d’un perpétuel
récitatif, auquel on donnoit les formes apparentes
de chant pour le rendre moins monotpne:
quelquefois une courte cavæine, qui fervoit à
faire reffortir deux vers à prétention , en interrom-
poit l ’uniformité. Jamais aucun air ne fe mêloit à
la fcène ; on réfervoit feulement quelques ariettes
pour les divertiffemens. O r , dans tous les pays du
monde , un récitatif ne doit point marquer la mefure
, 6» le bon goût confijle à ne pas l'y lai [fer
fentir. Le récitatif françois , qui changeoit à tout
moment de mefure, y étoit encore plus obligé,
pour ne pas fatiguer l ’oreille de cette variété continuelle
de rythme. Rouffeau devoit donc reprocher
aux opéra d’alors de manquer d’airs, mais
non pas à la mufique françoife de manquer de
mefure. On l’obfervoit rigourëufement dans les
ariettes , dans la fymphonie ; on ne l’altéroit que
faute d’oreille, ce qui n’arrivoit jamais aux bons
muficiens. Rouffeau pouvoit-il nier que les dan-
feurs françois , même de fon tems , ne fuffent les
meilleurs de l’Europe? Comment l’art de la danfe
auroit-il pu s’élever parmi nous à tant de perfection
, fi la mufique qu’on y employoit .n’avoitpas
été cadencée avec toute la précifion poflible ? ( M,,
Framery. )
Il règne là-deffus une erreur populaire qu’un
peu de réflexion détruit aifément. On s’imagine
qu’un auditeur ne bat par inftiné! la mefure d’un
air qu’il entend que parce qu’il la fent vivement ;
& c’eft , au contraire , parce qu’elle n’eft pas affez
fenfible. ou qu’il ne la fent pas affez , qu’il tâche,
à force de mouvemens des mains & des pieds, de
fuppléer ce qui manque en. ce point à fon oreille.
Pour peu qu’une mufique donne prife à la cadence
, on voit la plupart des François qui l’écoutent
, faire mille eontorfions & un bruit terrible
pour aider la mefure à marcher ou leur oreille à la
fentir. Subfiituez des Italiens ou des Allemands,
vous n’entendrez pas le moindre brait 8c ne verrez
pas le moindre gefte qui s’accorde avec la mefure.
Seroit-ce peut-être que les Allemands*fes Italiens
font moins fenfibles à la mefuné que les.
François ? Il y a tel de mes le&eurs qu( ne fe ferait
guères preffer pour le dire ; mais dira - 1 -il.
aufli que les muficiens les plus habiles font ceux
qui fentent le moins la mefure ? Il efi inconteftable
que ce font ceux qui la battent le moins ; & quanti,
à force d’exercice , ils ont acquis l’habitude de la,
fentir continuellement, ils ne la battent plus du
tout ; c’eft: un fait d’expérience qui efi fous les
yeux de tout le monde. L ’on pourra dire encore
que les mêmes gens à qui je reproche de ne battre
la mefure que parce qu’ils ne la fentent pas affez,
ne la battent plus dans les airs où elle n’efi point
fenfiUê ; & je répondrai que c’eft parc« qu’alorç
B A T
ils ne la fentent point du tout. Il faut que 1 o-
reilîe foit frappée au moins d un foible fentünent
"de mefure, pour que l’infitnéf cherche à le
forcer\{JJ.R ouJjeau.\
* Troi/ième obfervation, Toute CSîtC dîfcufllon
tnétaphyfique efi aum fiusic qu’inutile. Ce n’efi
point parcë qu’on fent bien ou mal la mefure d un
morceau, qu’on s’avife de la battre : c eu une
manie qu’on avoit autrefois , & qui efi pr.ef-
que entièrement paffée de mode aujourd hui, Les
maîtres à chanter ne manquoient pas d’apprendre
à leurs ■ élèves à battre la mefure en foifiant : ils en
eonfervoient l'habitude , & la iattoient de même
lorfqu’ils entendoient les autres chanter. On la
hauoitdonc par air ; pour faire v o ir , ou pour faire
croire qu’on favoit là mufique : & la preuve que
ce n’étoit pas par un fentimeiit plus ou moins fort
de cette même mefure , c eft . que la plupart de
ceux en qui cette vieille routine s’efi confervée la
battent à faux. Maintenant qu’on accompagne prei-
que toujours l’étude de la mufique vocale de
celle du forte piano ou de la harpe, nos jeunes
gens ne battent plus la mffi-e quand ils exécutent
de la mufique, ni quand'ils en entendent. D ’ailleurs,
comme cét art efi devenu partie prefque
indifpenfable de l’éducation , & que ce n’eft plus
un mérite particulier de favoir la mufique, battre
ia mfure eft à préfent une chofe de mauvais ton.
( M. Framery. )
Les anciens ; dit M. Burette, battoient la mefure
en plufieurs façons. La plus ordinaire confifioit
dans le mouvement du pied , qui s’élevoit de terre
& la frappoit alternativement , félon la mefure
des deux tems égaux ou inégaux. (V oy. Rhythme.)
C’ètoit ordinairement la fonction du maître de
mufique appellé Coryphée, Kopucpaïo?; parce qu’il
étoit placé au milieu du choeur des muficiens 8c
dans une. fituation élevée, pour être plus facilement
vu & entendu de toute la troupe. Ces batteurs
de mefure fe nommoient en grec fdJ'sOTs-oi,
8c 7rot^b'ij/o(pot, à caufe du ferait de leurs pieds,
çyyroÿâjitûi, à caufe de l’uniformité du gefte ; & , fi
l’on peut parler ainfi , de la monotonie’du rhythme
qu’ils battoient toujours à deux tems. Ils s’appel-
loient en latin pedarii, podarii, psdieularii. Ils gar-
nifloient ordinairement leurs pieds de certaines
chauffures ou iandales de bois ou de fe r , deftinées
à' rendre la pereuffion rhythmique plus éclatante ,
nommées en grec x-cwTréÇix, , KfovTnrot, 8c
en, latin, pedicifla, fcabella ou fcabdla , à caufe
qu’elles reflembîoient à de petits marchepieds ou
de petites efcabelles.
Ils battoient la mefure , non-feulement du pied ,
mats aufli de la main droite dont ils réuniffoient
tous les doigts pour frapper dans le creux de la
niaingauche, & celui qui marquoit ainfi le rhythme
sappelloit Mànuduttor. Outre "ce claquement de
trains ;&:1e bruit des fandales , les anciens avoient
encore , pour battre la mefure, celui des coquilles,
B E M 167
è fies écailles d’huîtres , & des offemens d’animaux ,
qu’on frappoit l’un contre l’autre, comme 011 fait
' aujourd’hui les caftagnettes , le triangle , 8c autres
pareils infirumens,
Tout es bruit fi défagréable & fi fuperflu parmi
nous , à caufe de l ’égalité confiante de la mefure ,
ne fétoit pas de même chez eux, où les fréquens
changeniens de pieds & de rhythmes exigeoient
un accord plus difficile, 8c donnoient au bruit
même Une variété plus hannonieufe & plus piquante.
Encore peut-on dite, que l iifage de . battre
ainfi" ne s’introduifit qu’à melure que la mélodie
devint plus languiffante, & perdit de -fon accent
& de fon énergie. Plus on remonte, moins on
trouve d’exemple de cés batteurs de mefure; 8c
dans la mufique de la plus haute antiquité, l’on
n’en trouve plus du tout. ( /. /„ Rquff.au.)
B A T T U T A , ƒ. f italien , qui fignifie mefure ,
parce que les rnefures fe difiinguent en battant, il
n’y a que deux efpèces. réelles de mefure s , la mefure
triple , 8c la mefure binaire. (Voyez Mesure , T riple
, Binaire. )
On trouve quelquefois fur des partitions italiennes
ces.mots , a baituta , qui lignifient en mefure,
mefure , lorfqu’après une ou plufieurs phrafes de
chant à volonté, en forme de récitatif, on doit
reprendre la mefure égale. ( Voyez Mefure. ) ( A/.
Framery, )
BEBISATIO , mot latin barbare , forgé pour
indiquer l’invention d'un certain Daniel Hisler,
qui vouloit qu’au lieu de dire la 5if i b , u t , re , m i,
fa , fo l en 1 biffant, on dit la be ce de mi fe ge ;
& qu’au lieu de ƒ , ut # , pe # , mi # , fa # , fol# ,
on dît b i , c i , di , mi y ti , gi. ( M. de Caflilhon. )
( Voyez Bobifatio. )
* Bémol. ( Voyez B. mol. )
Bémol. Dans la mufique des fiècles x v & x v i
& des fiècïes précédens , les bémols 8c les dièzes
accidentels ne font pas toujours marqués. En voici
la raïfon : lorfque la confonnance imparfaite,
c’efi-à-dire, la tierce ou la ffxte , defeendoit, les
chanteurs avoient alors pour principe de la
faire mineure ; & lorfqu’elle montoit, de la faire.
majeure ; d’après l’axiome de contre-point de
l’école italienne, que la confonnance majeure
veut monter , & 'que la mineure Veut defeendre.
Ainfi lorfque fur'1 a baffe fa fo l , la partie fupé-
rieure difoit U fa la , le chanteur n’avoit pas befoin
de ligne pour voir que le f i devoit être bémolifé ;
fi fur la baffe re f o l , le deffus difoit fa f o l , il
v o y o it, fans le fecours d’aucun figne , que le fa
étoit dièzé.
C ’eft à quoi il efi néceflaire de. faire bien attention
en déchiffrant d’ancienne mufique. Sans
cela, de très - beaux paffages d’harmonie pourraient
nous paraître difeordans •& barbares. ( M.
Ginguené. )
B mol. I. Les muficiens qui n’ont pas lu 5 ou pas