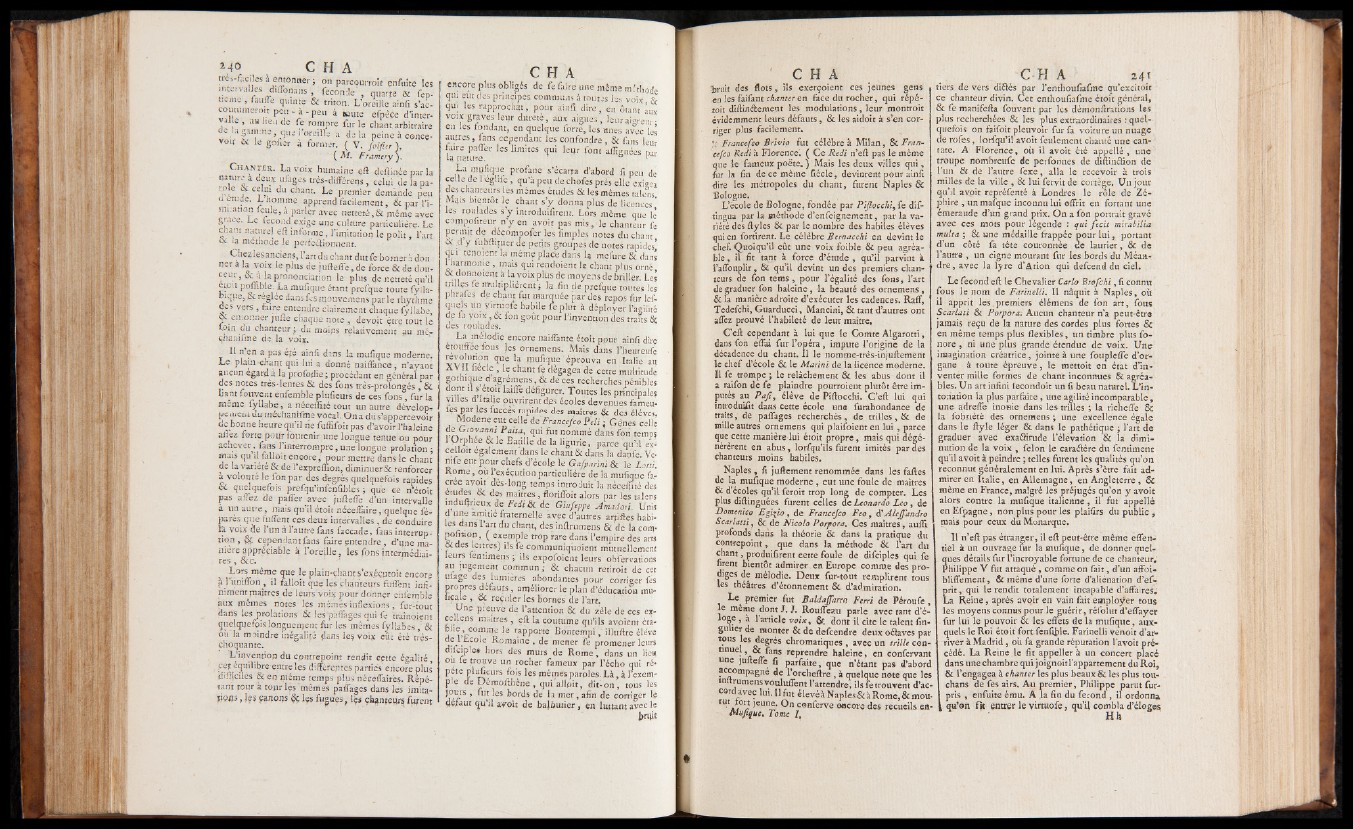
MO C H A
tres-fsciles à entonner ; on parcourrait enfuite les
intervalles diflonans , feco.nrlè';, quarte P j M
ti-me , faillie quinte & triton. L’oreille ainfi s’ac-
coutumeroit peu - à - peu à »ute efpèce d'inter-
a e , au lieu de fe rompre fur le chant, arbitraire
ae la gamme que l’oreille a d elà peine à concevoir
U le gofier à former. ( V. Joljù, ),
( M. Framery j.
C hanter. La voix humaine eft deftinée par la
nature a deux ufages trds-différens , celui de la pa-
role & celui du chant. Le premier demande peu
cletudç. L homme apprend facilement, & par l’i-
«n:atiop feule,à parier avec netteté,& piêmç avec
grâce. Le fécond exige une culture particulière. Le
chant naturel eft informe, l’imitation le polit, l’art
« 1? méthode le perfeaionnent. " ' ;
Chez ies anciens, l’art du chant dut fe borner à don
uer a la voix le plus de juftefle, de force & de douceur,
la prononciation le plus 4® netteté qu’il
etou poliible. La mufique étant prefque toute fyila-
biqiie, & réglée dans fcs mouvemens par le rhythme
des vers , faire entendre clairement chaque fyllabe,
Jr entonner jufte chaque note , devoir être tout le
foin du chanteur j-du moins relativement au méi-
çhanifme de. la voix.
II n en a pas été ainft dans la mufique moderne.
Le plain-chant qui lui a donné naiflance, n’ayant
aucun égard à la profodie; procédant en général par
des notes tres-lentes & des fons très-prolongés , &
liant fouvent enfemble plufieurs de ces fons, fur la
meme fyllabe, a néceflité tout un autre dévelop?
pement du mechsnifme vocal. On a dûs’appercevoir
de bonne heure qu’il ne fuffifoitpas d’avoirl’haleine
allez forte poiïr foutenir une longue tenue ou pour
achever, fans l’interrompre, une longue prolation ;
mais qu’il falloit encore, pour mettre dans le chant
de la variété & de l’expreffion, diminuer & renforcer
à volonté le fon par des degrés quelquefois rapides
& quelquefois prefqu’mfenfibles ; que ee n’étoit
pas aflez de paffer avec juftefle d’un intervalle
à un autre ? mais qu’il étoit héeeflaire, quelque fé-
parés que fuflent ces deux intervalles , de conduire
La voix de l’un à l’autre fans faccade, fans interrup-
tio.n , $ç cependant fans faire entendre , d’qne manière
appréciable à l’o reille, les fons intermédiaires
, & c . ‘ ‘ 1 ’
Lors même que le plain-chant s’exéçjitoit encore
À iuniflon ,, il falloit que les chanteurs fuflbnt infiniment
jnaîtres de leurs voix pour donner enfemble
aux mêmes notes les mèmès inflexions, fur-tout
dans les prolations & les paflages qui fe ïraînoient
quelquefois longuement fur les mêmes fyllabes, &
ou la moindre inégalité dans le$ voix eût été très-
choquante.
L’invention du contrepoint rendit cette égalité
équilibre entre les différentes parties encore plus
d'fficîlès & en même temps plus néceflairès. Répétant
tour à tour lès mêmes pafîages dans les imitations
, s çanoqsgc lçs fugues, Içs çhanteiy§ firent
c H A
encore plus obligés de fe faire une même méthode
qui eut des principes communs à toutes les voix &
qu; les rapprochât, pour ainft dire, en Ôtant aux
voix graves lepr dureté, attx aigues, leur aigreur-
en les fondant, en quelque forte, les unes avec les
autres, fans cependant les confondre , & fans leur
faire paffer les limites qui lepr font affignées ua-
la nature. ° 1
La mufique profane s’écarta d’abord fi peu de
celle de Legale, qu’à peu de chofes près elle exigea
des chanteurs ies mêmes études & les mêmes talens
Mpts bientôt le chant s’y donna plus de licences ’
les roulades s’y introduifirent. Lors même que le
compofiteur n’ÿ en avoit pas mis, le chanteur fe
perirpt de déçompofer les fimples notes du chant
of ,d y fubfttfucr de petits groupes de notes rapides’
qrt tenotent la même place dans lq mefure & dans
1 harmonie , mais qui rendoient le chant plus orné
cc donnoient à lavoixplus de moyens de briller. Les’
trilles fe multiplièrent ; la .fin de prefque tontes les
pnrales de chant fut marquée par des repos fur lef-
quels, un yirtuofe habile feplut à déployer l’agilité
dp fa y oix , & fon goût pour l’invention des traits &
des rQulades.
, 1 * fé jo d iç eqcpre naiffante étoit pou, ainft dire
etouftee fous les ornemens. Mais dans Tlieureufç
v v Vt’L ' Î qUe la mufique 'éprouva en Italie au
AV 11 liecle , le chant fe dégagea de cette multitude
gothique d agremens, & de ces recherches pénibles
u?' jiE l- lS i défigurer. Toutes les principales
villes d Italie puvrirçntdes écoles devenues fameu-
‘ Sx5ar qS ^*ucces raP’ dcs des maîtres & des élèves,
Modene eut celle d e Francejco Peli ; Gènes Celle
î% F ‘?yan^ ‘ , l ‘aua’ qmfi« nommé dans fon temps
1 Orphee & le Batille de la ligurie, parce qü’ii’ex-
cellott egalement dans le chant&dans la danfe. Venue
eut pour chefs d’ecole le Gafparini & le Lotti.
Rome ,.ou l’exéçutlon particulière de la mufique far
créé avoit dès-long temps introtiuifla nèceifité des
eiudes ix des maîtres , floriffoit alors par les talers
înduljrieux de F edi & de Giufeppe Am.uiori. Unis
d une amitié fraternelle avec d’autres articles habi-
les dans l’art du chant, des infini mens & de la cotq-
pontion, ( exemple trop rare dans'l’etnpire des arts
oc des lettres) ils fe CQmnjuniqîibient mutuellement
leurs fentimens ; ils expofoient leurs obfervations
au jugement commun ; & chacun retirait de çet
ufage des lumières abondantes pour corriger fes
propres defauts, améliorer le plan d’éducation mu-
îiCcfle , oc reçnler les bornes de l’art.
Une preuve de l’attention & du zèle de ces excelle
ns maîtres, eft la coutume qu’ils avpient étâ-
_,comiî?e le rapporte Bontempi , illuftre élève
ÿ / LcoIe Romaine , de mener fe promener leurs
difciples hors des murs de Rome, dans un lieu
ou fe trouve un rocher fameux par l’écho qui ré* |
pète plufieurs fois les mêmes parples. L à , à iexem-
P,e r e pômofthène , qui allpit, dit-on , tous les
jours , fut les bords de la mer, afin de corriger 1?
défaut qu’il avoit de balbutier, en luttant avec le
Jîruit
C H A
Bruit des flots , ils exerçoient ces jeunes sens
en les faifant chanter en face du rocher, qui repé-
toit dtftinélemejit les modulations, leur montroit
évidemment leurs défauts, & les aidoit à s’en cor-
riger plus facilement.
L' Francefco Brivio fut célèbre à Milan, & Fran-
cefeo Redi à Florence. ( C e Redi n’eft pas le même
que le fameux poète. ) Mais les deux villes q u i,
jur la fin de ce même fiécle, devinrent pour ainfi
dire les métropoles du chant, furent Naples &
Bologne.
L’école de Bologne, fondée par Piflocchi, fe distingua
par la méthode d’enfeignement, par la variété
des ftyles & par le nombre des habiles élèves
qui en fortirent. Le célèbre Bernacchi en devint le
chef Quoiqu’il eût une voix foibie & peu agréable
, il fit tant à force d’étude , qu’il parvint à
l’aflouplir, & qu’il devint un des premiers chanteurs
de fon teins, pour l’égalité des fons, l’art
de graduer fon haleine, la beauté des ornemens,
& la manière adroite d’exécuter les cadences. Raff,
Tedefchi, Guarducci, Maneini, &: tant d’autres ont
aflez prouvé l’habileté de leur maître,
C ’eft cependant à lui que te Comte Algarotti,
dans fon eflài fur l’opéra, impute l’origine de la
décadence du chant. Il le nomme-très-injuftement
le chef d’école & le Marini de la licence moderne.
Il fe trompe ; le relâchement & les abus dont il
a raifon de fe plaindre pourroient plutôt être imputés
au Paji, élève de Piftocchi. C ’eft lui qui
introduisit dans cette école une furabondance de
traits, de paflages recherchés, de trilles, & de
mille autres ornemens qui plaifoient en lu i , parce
que cette manière lui étoit propre, mais qui dégénérèrent
en abus, lorfqu’ils furent imités par des
chanteurs moins habiles.
Naples, fi juftement renommée dans les faftes
de la mufique moderne , eut une foule de maîtres
& d’écoles qu’il ferpit trop long de compter; Les
plus diftinguées furent celles de Leonardo Léo , de
Domcnico Egi^io, de Francejco Feo, d’Alejfandro
Scarlatti9 & de Nicolo Porpora. Ces maîtres, aufli
profonds dans la théorie & dans la pratique du
contrepoint, que dans la méthode & l’art du
chant, produifirent cette foule de difciples qui fe
firent bientôt admirer en Europe comme des prodiges'
de mélodie. Deux fur-tout remplirent tous
les théâtres d’étonnement & d’admiration.
Lek premier fut Baldafarrc Ferri de Péroufe ,
le meme dont J. J. Roufleau parle avec tant d’é-
l°ge , à 1 article voix9 & dont il cite le talent fin-
gu îer de monter & de defeendre deux oélaves par
tous les degrés chromatiques , avec un trille con-
tmuel, & fanS reprendre haleine, en confervant
une juitefle fi parfaite, que n’étant pas d’abord
accompagne de l’orcheftre , à quelque note que les
*n trumens vouluflent l’attendre, ils fe trouvent d’ac-
cordavec lui. Ufut élevé à Naples & à Rome,&mou-
' ,euni* ° n c®nlerve encore des recueils en-
Mvfyuc, Tome /,
C H A 241
tiers de vers diQés par l’enthoufiafme qu’excitoit
ce chanteur divin. Cet enthoufiafme étoit général,
& fe manifefta fouvent par les démonftraîions les
plus recherchées & les plus extraordinaires : quelquefois
on faifoit pleuvoir fur fa voiture un nuage
de rofes, lorfqu’i! avoit feulement chanté une cantate.
A Florence, où il avoit été appellé, une
troupe nombreufe de petfonnes de djftinélion de
l’un & de l’autre fex e , alla le recevoir à trois
milles de la ville , & lui fervit de cortège. Un jour
qu’il avpit repréfenté à Londres le rôle de Zé-
phire , un mafque inconnu lui offrit en fortant une
émeraude d’un grand prix. On a fon portrait gravé
avec ces mots pour légende : qui fecit mirabilia
multa ; & une médaille frappée pour lui A portant
d’un côté fa tête couronnée de laurier, & de
l’autre , un cigne mourant fur les bords du Méandre,
avec la lyre d’Arion qui defeend du ciel.
Le fécond eft le Chevalier Carlo Brofchi, fi connu
fous le nom de Farinelli. Il naquit à Naples, où
il apprit les.premiers élémens de fon art, fous
Scarlati & Porpora: Aucun chanteur n’a peut-être
jamais reçu de la nature des cordes plus fortes 8c
en même temps plus flexibles, un timbre plus fo-
nore , ni une plus grande étendue de voix. Une
imagination créatrice, jointe à une fouplefle d’organe
à toute épreuve, le mettoit en état d’inventer
mille formes de chant inconnues & agréables.
Un art infini lecondoit un fi beau naturel. L’intonation
la plus parfaite, une agilité incomparable ,
une adrefle inonie dans les trilles ; la richeffe 8c
la fobriété des ornemens ; une excellence égale
dans le ftyle léger 8c dans le pathétique ; l’art de
graduer avec exaâirude l’élévation 8c la diminution
de la voix , félon le caraélère du fentiment
qu’il avoit à peindre ; telles furent les qualités qu’on
reconnut généralement en lui. Après s’être fait admirer
en Italie, en Allemagne, en Angleterre , 8c
même en France, malgré les préjugés qu’on y avoit
alors contre la mufique italienne, il fut appellé
en Efpagne, non plus pour les plaiûrs du public ,
mais pour ceux du Monarque.
Il n’eft pas étranger, il eft peut-être même effen-
tièl à un ouvrage lur la mufique, de donner quelques
détails fur l’incroyable fortune de ce chanteur.
Philippe V fut attaqué , comme on fait, d’un affoi-
bliffement, & même d’une forte d’aliénation d’ef-:
prit, qui le rendit totalement incapable d’affaires.
La Reine, après avoir en vain fait employer tous
les moyens connus pour le guérir, réfoîut d’effayer
fur lui le pouvoir & les effets de la mufique, auxquels
le Roi étoit fort fenfible. Farinelli venoit d’arriver
à Madrid, où fa grande réputation l’avoit précédé.
La Reine le fit appeller à un concert placé
dans une chambre qui joignoitl'appartement du Roi,
& l’engagea à c k a n te r les plus beaux & les plus tou-
chans de fes airs. Au premier, Philippe parut fur-
pris , enfuite ému. A ,1a fin du fécond , il ordonna
l qu’en fit entrer le virtuofe, qu’il combla d’éloges