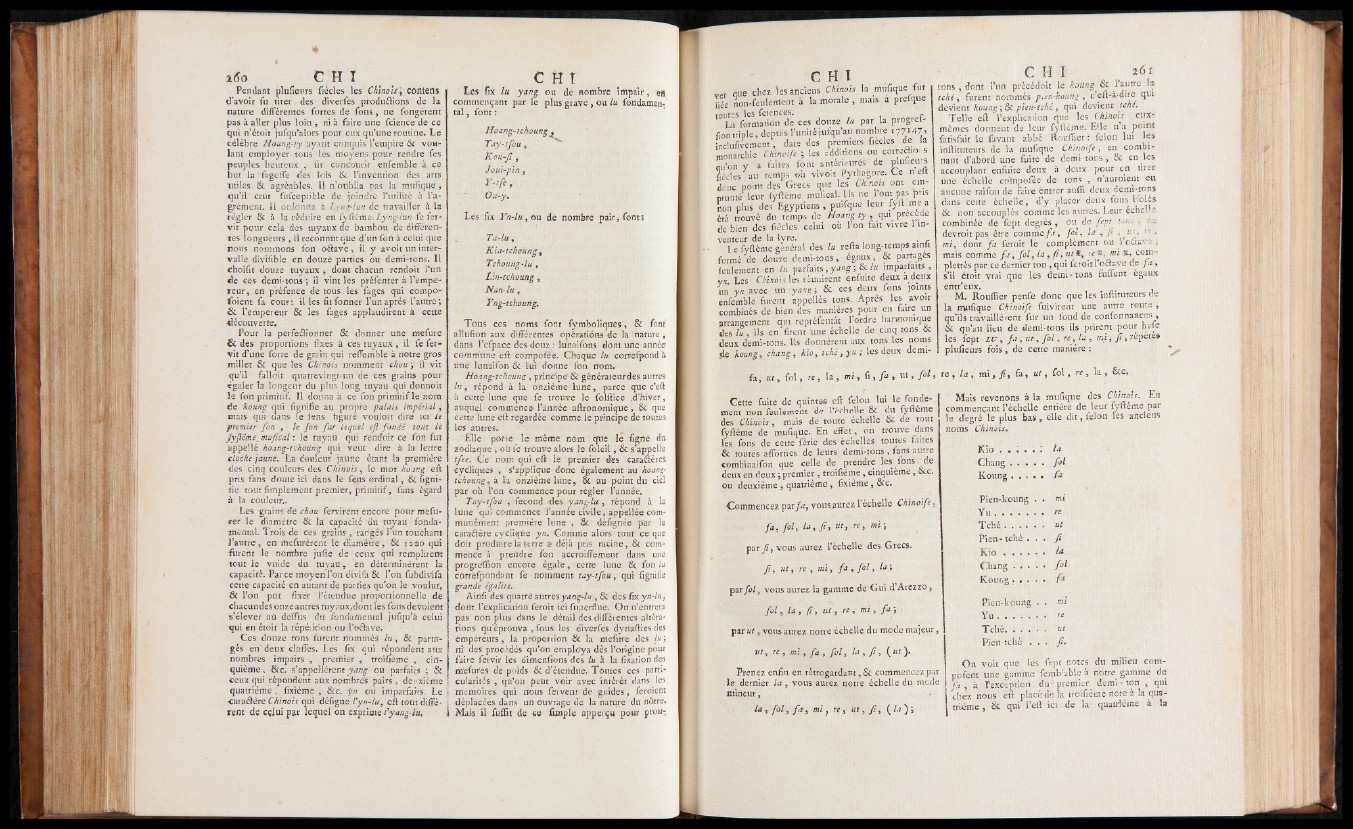
Pendant plufieurs fiècles les Chinois \ contens
d’avoir fu tirer des diverses produélions de la
nature différentes fortes de fons , ne fongèrent
pas à aller plus loin , ni à faire une fcience de ce
qui n’étoit jufqu’alors pour eux qu’une routine. Le
célèbre Hoang-ty ayant conquis l’empire 6c voulant
employer tous les moyens pour rendre fes
peuples heureux , fit concourir efifemble à ce
but la fagefie des' lois & l'invention des arts
utiles &. agréables. 11 n’oublia pas la- mufique
qu’il crut fufcepiible de ■ joindre l’utilité à l’agrément.
Il ordonna à Lyng-lun de travailler à la
régler & à la réduire en fyftême. Lyng-lun fe fer-
vit pour cela des tuyaux de bambou de différentes
longueurs , fl reconnut que d’un fort à celui que
nous nommons fort o â a v e , il y avoit un intervalle
divifible en doûzè parties ou demi-tons. Il
choifit douze tuyaux , dont chacun rendoit l’un
de ces demi-tons ; il vint les préfenter à l’empereur,
en préfence de tous les fages qui compo-
foient fa cour : il les fit fonner l’un après l’autre ;
& l’empereur & les fages applaudirent à cette
^découverte.
Pour la perfeéKonner & donner une mefure
& des proportions fixes à ces tuyaux , il fe fer-
vit d’une forte de grain qui reflemble à notre gros
millet & que les Chinois nomment chou il vit
qu’il falloit quatrevingt-un de ces grains pour
égaler la longenr du plus long tuyau qui donnoit
le fon primitif. Il donna à ce fou primitif le nom
de houng qui lignifie au propre palais impérial,
mais qui dans le fens figuré vouloit dire ici le
premier fon , le fon fur lequel efl fondé tout lè
/yfiême_ mufiCal : le tuyau qui rendoit ce fon fut
appelle hoang-tchoung qui veut dire à la lettre
cloche jaune. La douleur jaune étant la première
des cinq Couleurs des Chinois, le mot hoang eft
pris fans doute ici dans le feus ordinal, & figni-
fie tout firtiplemént premier, primitif, fans égard
à la couleur.«
Les grains de chou fefvirent encore pour mefu-
rer le diamètre & la capacité du tuyau fondamental.
Trois de Ces grains , rangés l’un touchant
l ’autre, en rtiefurèrent le diamètre', & 1200 qui
furent le nombre jufte de ceux qui remplirent
tout le vuide du. tuyau , 'en déterminèrent la
capacité. Parce moyen l’on divifa & l’on fubdivlfâ
cette capacité en autant de parties qu’on le voulut,
6c l’on put fixer l’étendue proportionnelle de
chacundes onze autres tuyaux,dont les fons dévoient
s’élever aû deflus du fondamental jüfqu’à celui
qui en étoit la répéûtion ou l’oétave.
Ces douze fons fùterît nommés lu , & partagés
en’ deux claffes. Les fix qui répondent aux
nombres impairs , premier , troifième' , cinquième
, &c. s’appelèrent yang oti parfaits ; &
ceux qui répondent aùx nombré’s pairs, deuxième \
quatrième, fixième , &c, Ë | ou imparfans. Le j
caraâère Chinois qui défigne l'yn-lu, eft toutdiffé- 1
rent de celui par lequel on exprime Cyang-lu< \
Les fix lu yang ©u de nombre impair,'
commençant par le plus grave, ou lu fondamen*
ta l, font :
Hoang-tchoung ,
Tay-tfou
K où-f i ,
J oui-pin j WM Ou-y.
Les fix Y n -lu ,o u de nombre pair, fontï
Ta-lu,
Kia-tchoüng 9
Tchoung-lu,
Lin-tchoung ,
N an-lu ,
Yng-tchoung.
Tous ces noms font fymboliqires, 8c font
allufion aux différentes opérations de là nature ,
dans l’efpace desdouz* lunaifons dont une année
commune eft eompofée. C liq u e lu correfpond à
une lunaifon & lui donne fon nom.
Hoang-tchoung, principe' & générateur des autres
lu , répond à la onzième lune, parce que c’eft
-.à cette lune que fe trouve le folftice .d’hiver,
auquel commence* l’année aftronomique, & que
cette lune eft regardée comme le principe de toutes
les'antres.
Elle porte le meme nom que le ligne du
zodiaque j où fe trouve alors le fo le il, & s’appelle
tfee. C e nom qui eft le premier des caraûèreS
cycliques , s’applique donc également au hoang-
tchoung à la onzième lune, St au point du ciel
par oo l’on commence pour régler l’année.
Tay-tfou , fécond ides yang-lu , répond à la
lune qui commence l’année civile , appellée communément
première lune , ât défignée par le
cara&ère cyclique yn. Comme alors tout ce que
doit produire la terre a déjà pris racine, & commence
à prendre fon accroiffement dans une
progrCflion encore égale, cette lune St fon lu
correfpondant fe nomment tay-tfou, qui lignifie
grande égalité.
Airîfi des quatre autresyang-lu , & des fix yn-lu,
dont l’explication feroit ici fuperftue. On n’entrera
■ pâs non plus dans le détail des différentes altérations
qu’éprouva', fous les diverfes dynafties des
empereurs, la proportion & la mefure des lui
nî des procédés qu’on employa dès l’origine pour
faire fervir les dimenfioils des lu à la fixation des
mefutes de poids & d’éteildue. Toutes ces parti-
|cularités , qû’on peut voir avec intérêt dans les
| mémoires qui nous fervent de guides, feroient
j déplacées dans un ouvrage de la nature du notre.
I Mais il fuffit de gg fioeple apperçu pour prou:
c H i
vet miê chez tes anciens Chinois la mufique fut
liée non-feulement à la morale , mais a prefque
toutes les fciences. ,
La formation de ces douze lu par la progrel-
fiontriple, depuis l’unité jufqu’au nombre >77>47.
inclufivement, date des premiers fiecles de la
monarchie Chinoife ; les additions ou cot-reélioi s
qu’on y a faites font anterieures de plufietus
fiècles au temps où vivolt Pythagore. Ce n ett
donc point dçs Grecs que les Chinois ont emprunté
leur fyftême mttfical. Ils ne l’ont pas }>ns
non plus des Egyptiens , puifque leur M M
été trouvé du temps de Houng ty , qui précède
de bien des fiècles celui où l’on fait vivre 1 inventeur
de la lyre. . .
Le fyftême général des lu refta long-temps atnfi
formé de douze demi-tons, égaux, & partages
leulement en lu parfaits, yang ; &-lu imparfaits ,
va. Les Chinois les réunirent enfuite deux a deux
un yn avec un -yang ; & ces deux fons joints
enfemble furent appellés tons. Après les _ avoir
combinés de bien des manières pour en faire un
arrangement qui repréfentât l’ordre harmonique
des lu , ils en firent une échelle de cinq tons oc
deux demi-tons, lis donnèrent aux tons les noms
de koung 7 change kio, tch é .y u ; les deux demifa,
u t , f o l , re, la , mi, f i , fu , u t , f o l ,
Cette fuite de quintes eft félon lui le fonde-, j
ment non- feulement de l’échelle & du fyftême
des Chinois, mais de toute échelle & de tout
fyftême de mufique. En effet, on trouve dans
les fons de cette férié des échelles toutes faites ;
& toutes afforties de leurs demi-tons , farts autre
combinaifon que celle de prendre les fons de
deux en deux ; premier, troifième, cinquième , &c.
ou deuxième, quatrième, fixieme, &c.
-^Commencez par fa 9 vous_aurez l’echelle Chtnoife,
f a , fol, la , f i , ut, re, mi ;
par f i , vous aurez l’échelle des Grecs.
f i , ut, re , mi, f a , f o l , la',
par fo l, vous aurez la gamme de'Gui d’Arezzo,
fol,, la , f i , u t , re, mi, fa',
par u t, vous aurez notre échelle du mode majeur,
ut, re, ml, fa , fo l , la , f i , ( ut ).
Prenez enfin en rêtrogardant, & commencez par
le dernier la , vous aurez notre échelle du mode
mineur,
la , fo l, f a , mi ? re , u t , f i , ( la )
C H I 261
tons , dont l’un précédoit le houng• & l’autre le
tchè, furent nommés p>en-koung, c’eft-à-dire qui
devient houng ; & pien-tché, qui devient tche.
Telle eft l’explication que les Chinois eux-
mêmes donnent de leur fyftême. Elle n’a point
fatisfait le favant abbé Roudier : félon lui les
inftituteurs de la mufique Chinoife , en combi-
, nam d’abord une fuite de demi-tons , & en les
I accouplant enfuite deux à deux pour en tirer
une échelle coïnpofée de tons , n auroient eu
aucune raifon de faire 'entrer aufli deux demi-tons
dans cette échelle, d’y placer deux fons idoles
& non accouplés comme les autres. Leur échel.e
combinée de fept degrés, on de fept tons
devroit pas être comme f a , fol, la , f i , ut, re ,
mi, dont fa. feroit le complément ou 1 cûave ;
mais comme fa , fo l, la , f i , ut#, reï , mi 2, corn»
plettés par ce dernier ton , qui feroit l’o&ave de f a ,
s’il étoit vrai que les demi-tons fulfent égaux
entr’eux.
M. Rouflier penfe donc que les inftituteurs de
la mufique Chinoife fuivirent une autre route ,
qu’ils travaillèrent fur un fond de confonnances ,
& qu’au lieu de demi-tons ils prirent pour bafe
i les fept l u , f a u t -, f o l , re, la , tni, f i , repetes
plufieurs fo is , de cette manière :
re , la , m ï, f i , fa , u t , f o l , re , la , &c.
I Mais revenons à la mufique des Chinois. En
commençant l’échelle entière de leur fyftême par
le degré le plus b a s , elle dit, félon les anciens
noms Chinois.
Kio . . : . . : la
C h an g .................. fo l
Koung . . . • • fa
Pien-koung . . mi
Y u . . . . . . . m
Tché ................... ut
Pien- tché . . . f i
K i o ...................... lu
C h a n g ............. fo l
Koung . . . . . fa
Pien-koung . . mi
Yu , . . . . . . re
Tché................... ut
Pien-tché . . . fi.
On voit que les fept notes du milieu com*
pofent une gamme femb’able à notre gamme de
f i , à l’exception du premier demi - ton , qui
chez nous eft placé de la troifième note à la quatrième
, & qui i’eft ici de la quatrième a la