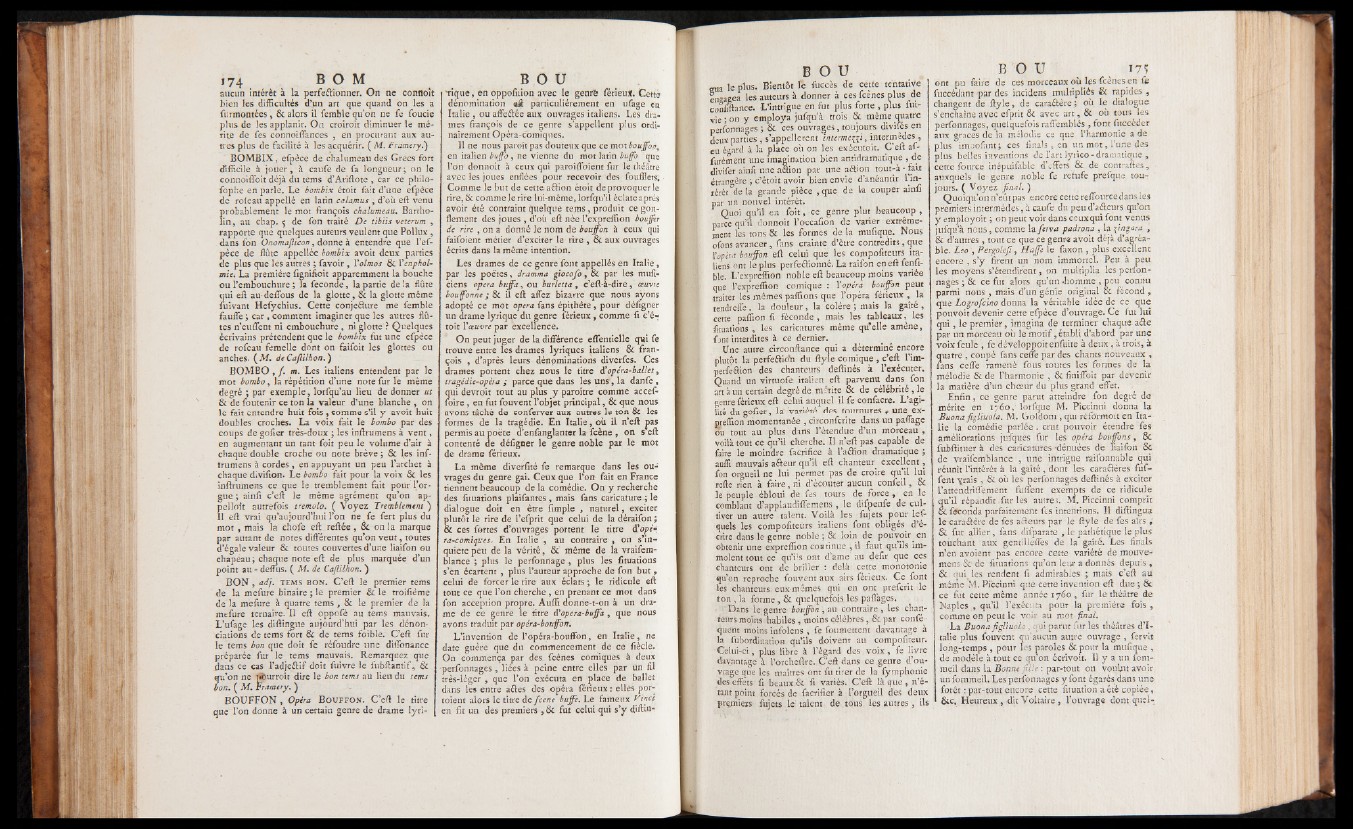
174 B O M
aucun intérêt à la perfectionner. On ne confloît
bien les difficultés d’un art que quand on les a
furmontées , & alors il femble qu’on ne fe foucie
plus de les applanir. On croiroit diminuer le mérite
de fes connoiflances , en procurant aux autres
plus de facilité à les acquérir. ( M. Framery.)
BOMBIX, efpèce de chalumeau des Grecs fort
difficile à joiier, à caufe de fa longueur ; on le
connoiffoit déjà du tems d’Ariftote , car ce philo-
fophe en parle. Le bombix étoit fait d’une efpèce
de roleau appellé en latin calamus , d’où eft venu
probablement le mot françois chalumeau. Bartho-
îin, au chap. 5 de fon traité De tibiis veterum ,
rapporte que quelques auteurs veulent que Pollux ,
dans fon Onomaflicon, donne à entendre que l ’ef-
pèce de flûte appellée bombix avoir deux parties
de plus que les autres ; favoir, Yolmos & Yenphol-
mie. La première fignifioit apparemment la bouche
ou l’embouchure ; la fécondé, la partie delà flûte
qui eft au-deftous de la glotte, 8c la glotte même
fuivant Hefychius. Cette conjeélure me femble
fauffe ; car, comment imaginer que les autres flûtes
n’euffent ni embouchure , ni glotte ? Quelques
écrivains prétendent que le bombix fut une efpèce
de rofeau femelle dont on faifoit les glottes ou
anches. (A f. deCafiilhon.')
B O M B O , /. m. Les italiens entendent par le
mot bombo, la répétition d’une note fur le même
degré ; par exemple, lorfqu’au lieu de donner ut
8c de foutenir ce ton la valeur d’une blanche , on
le fait entendre huit fois , comme s’il y avoit huit
doubles croches. La voix fait le bombo par des
coups de gofier très-doux ; les inflrumens à v en t,
en augmentant un tant foit peu le volume d’air à
chaque double croche ou note brève ; & les inf-
trumens à cordes , en appuyant un peu l’archet à
chaque divifion. Le bombo fait pour la voix 8c les
inflrumens ce que le tremblement fait pour l’orgue
; ainfi c’eft le même agrément qu’on ap-
pelloit autrefois trémolo. ( Voyez Tremblement )
11 eft vrai qu’airjourd’hui l’on ne S fe fert plus du
mot , mais la chofe eft reftée, 8c on la marque
par autant de notes differentes qu’on veut, toutes
d’égale valeur & toutes couvertes d’une liaifon ou
chapeau; chaque note eft de plus marquée d’un j
point au - deflus. ( M. de Cafiilhon. )
B O N , ad], tems bon. C ’eft le premier tems
de la mefure binaire ; le premier 8c le troifième
de la mefure à quatre tems, 8c le premier de la
mefure ternaire. Il eft oppofé au tems mauvais.
L ’ufage les diftingue aujourd’hui par les dénonciations
de tems fort & de tems foible. C ’eft fur
le tems bon que doit fe réfoudre une diflonance
préparée fur le tems mauvais. Remarquez que
dans ce cas l’adje&if doit fuivre le fubftamif, &
qu’on ne râburroit dire le bon tems au lieu du tems
bon. ( M. Framery. )
B O U F FO N , Opéra Bouf fon. C ’eft le titre
que l’on donne à un certain genre de drame lyrib
o u
'rique, en oppofuion avec le genrè férieu*. Cettè
dénomination aff particuliérement en ufage en
Italie , ou afteéiée aux ouvrages italiens. Les drames
françois de ce genre s appellent plus ordinairement
Opéra-comiques.
11 ne nous paroît pas douteux que ce mot b o u ffo n ,
en italien b u f fo , ne vienne du mot latin buffo que
l’on donnoit à ceux qui paroifloient fur le théâtre
avec les joues enflées pour recevoir des foufflets.
Comme le but de cette aftion étoit de provoquer le
rire, & comme .le rire lui-même, lorfqn’il éclate après
avoir été contraint quelque tems, produit ce gonflement
des joues , d’où eft née l’expreffion bouffer
d e rire , on a donné le nom de b o u ffo n à ceux qui
faifoient métier d’exciter le rire , 8c aux ouvrages
écrits dans la même intention.
Les drames de ce genre font appellés en Italie,
par les poètes, d ram m a g io c o fo , & par les mufi-
ciens opéra briffa, ou b u r le tta , c’eft-à-dire, oeuvre
bou ffo n n e ; 8c il eft affez bizarre que nous ayons
adopté ce mot o pé ra fans épithète, pour défigner
un drame lyrique du genre férieux, comme fi e’é*
toit Y oe u v r e par excellence.
On peut juger de la différence effentielle qui fe
trouve entre les drames lyriques italiens 6c françois
, d’après leurs dénominations diverfes. Ces
drames portent chez nous le titre 6! o p é r a - b a lle t,
tra g éd ie -o p é ra ; parce que dans les uns, la danfe ,
qui devroit tout au plus y paroître comme accef-
foire , en fut fouvent l’objet principal, & que nous
avons tâché de conferver aux autres le ton 8c les
formes de la tragédie. En Italie, où il n’eft pas
permis au poète a’enfanglanter la fcène , on s eft
contenté de défigner le genre noble par le mot
de drame férieux.
La même diverfité fe remarque dans les ouvrages
du genre gai. Ceux que l’on fait en France
tiennent beaucoup de la comédie. On y recherche
des fituations plaifantes , mais fans caricature ; le
dialogue doit en être fimple , naturel, exciter
plutôt le rire de l’efprit que celui de la déraifon ;
8c ces fortes d’ouvrages portent le titre dlopé-,
ra - c om iq v e s . En Italie , au contraire , on s’inquiète
peu de la vérité, 8c même de la vraifem-
blance ; plus le perfonnage , plus les fituations
s’en écartent , plus l’auteur approche de fon but ,
celui de forcer le rire aux éclats ; le ridicule eft
tout ce que l’on cherche , en prenant ce mot dans
fon acception propre. Auffi donne-t-on à un drame
de ce genre le titre (Yo p e ra -b u ffa , que nous
avons traduit par o p é ra -b o u ffo n .
L ’invention de l’opéra-bouffon, en Italie, ne
date guère que du commencement de ce fiècle.
On commença par des fcènes comiques à deux
•perfonnages , liées à peine entre elles par un fil
très-léger , que l’on exécuta en place de ballet
dans les entre aftes des .opéra férieux : elles por-
toient alors le titre de f c e n e b u ffe . Le fameux F in c f
en fit un des premiers , 8c fut celui qui s’y diAi*1-
B O U
gua le plus. Bientôt lé fuccès de cette tentative
engagea les auteurs à donner à ces fcènes plus de
confiance. L ’intrigue en fut plus forte , plus fui-
vie ; on y employa jufqu à trois 8c même quatre
perfonnages ; 8c ces ouvrages, toujours divifés en
deux parties , s’appelleront i n t e r n e n t , intermèdes ,
eu é*ard à la place où on les exécutoit. C ’eft af-
furément une imagination bien antidramatique , de
divifer ainfi une aciion par une aéfcion tout-à-fait
étrangère ; c’étoit avoir bien envie d’anéantir 1 in-
rérêt de la grande pièce , que de Va couper ainfi
par un nouvel intérêt.
Quoi qu’il en foit, ce genre plut beaucoup ,
parce qu’il donnoit l’occafion de varier extrêmement
les tons 8c les formes de la mufiqqe. Nous
ofons avancer, fans crainte d’être contredits, que
Yopéra b o u ffo n eft celui que les compofiteurs italiens
ont le plus perfeélionné. La raifon en eft fenfi-
ble. L’expreffion noble eft beaucoup moins variée
que /l’expreffion comique : Y o p é ra b o u ffo n peut
traiter les mêmes paffions que l’opéra férieux , la
tendreffe, la douleur, la colère ; mais la gaîté, j
cette paffion fi féconde, mais les tableaux, les
fituations , les caricatures même qu’elle amène,
f m interdites à ce dernier.
Une autre circonftance qui a déterminé encore
plutôt la perfe&iob du ftyle comique , c’eft l’im-
perfé&ion des chanteurs deftinés à l’exécuter.
Quand un virtuofe italien eft parvenu dans fon
art à un certain degré de mérite 8c de célébrité, le
genre férieux eft celui auquel il fe confacre. L’agilité
du gofier, la Variété des tournures * une ex-
oreffion momentanée , circonfcrite dans un paffage
ou tout au plus dans l’étendue d’un morceau ,
voilà tout ce qu’il cherche. Il n’eft pas capable de
faire le moindre facrifice a l’aâion dramatique ;
auffi mauvais afteur qu’il eft chanteur excellent,
fon orgueil ne lui permet pas de croire qu’il lui
refte rien à faire, ni d’écouter aucun conleil, 8c
le peuple ébloui de fes tours de force , en le
comblant d’applaudiffemens , le difpenfe de cultiver
un autre talent. Voilà les fujets pour lesquels
les compofiteurs italiens font obligés d’e-
crire dans le genre noble ; 8c loin de pouvoir en
obtenir une expreflîon continue , il faut qu’ils immolent
tout ce qui’s ont d’ame au defir que ces
chanteurs ont de briller : delà cette monotonie
qu’on reproche fouvent aux airs férieux. Ce font
les chanteurs eux-mêmes qui en ont prefcrit le
ton , la forme, 8c quelquefois les pafîages.
Dans le; genre b o u ffo n , au contraire , les chanteurs
mo.ins habiles , moins célèbres, 8c par conséquent
moins infolens , fe foumettent davantage à
la fubordination qu’ils doivent au compofiteur.
Celui-ci, plus libre à l ’égard des v o ix , fe livre
davantage à l’orcheftre.,Ç’eft dans ce genre d’ouvrage
que les maîtres ont fu tirer de la Symphonie
des effets fi beaux 8c fi variés; C ’eft là que, n’étant
point forcés de Sacrifier à l’orgueil des deux
premiers fujets le talent de tous, les autres, ils
B O U I 7 *
ont pu faire de ces morceaux où les fcènes en fe
fuccédant par des incidens multipliés & rapides ,
changent de fty le , de cara&ère ; où le dialogue
s’enchaîne avec efprit 8c avec art, 8c où tous les
perfonnages, quelquefois raffemblés , font Succéder
aux grâces de la mélodie ce que l’harmonie a de
plus impofant; ces finals, en un mot, l’une des
plus belles inventions de fart lyrico - dramatique ,
cette Source inépuifable d’effets 8c de contraftes,
auxquels le genre noble fe retufe prefque toujours.
( Voyez f in a l . )
Quoiqu’on n’eût pas encore cette reffource dans les
premiers intermèdes, à caufe du peu d’a&eurs qu’on
y employoit ; on peut voir dans ceux qui font venus
jufqu’à nous, comme la f e r v a p a d r o n a , la \in g a r a ,
8c d’autres , tout ce que ce genre avoit déjà d’agréable.
L é o ', P e rg o le fi , H a j j e le faxon , plus excellent
encore , s’y firent un nom immortel. Peu à peu
les moyens s’étendirent, on multiplia les perfonnages
; 8c ce fut alors qu’un .homme , peu connu
parmi nous , mais d’un génie original 8c fécond ,
que L o g r o fc in o donna la véritable idée de ce que
pouvoit devenir cette efpèce d’ouvrage. Ce fut lui
q u i, le premier, imagina de terminer chaque, aéle
par un morceau où le motif, établi d’abord par une
voix feule , fe développoitenfuite à deux , à trois, à
quatre , coupé fans ceffe par des chants nouveaux ,
•fans ceffe ramené fous toutes les formes de la
mélodie 8c de l’harmonie , 8c finiflbit par devenir
la matière d’un choeiir du plus grand effet.
Enfin, ce genre parut atteindre fon degré de
mérite en 1 7 6 0 lorfque M. Piccinni donna la
B u o n a f ig liu o la . M. Goldoni, qui réfôrmoit en Italie
la comédie parlée, crut pouvoir étendre fes
améliorations jufques fur les o péra b o u f fo n s , 8c
fubftituer à des caricatures -dénuées de liaifon 8c
de vraifemblance , une intrigue raifonnable qui
réunît l’intérêt à la gaîté, dont les caractères fuf-
fent yrais , 8c où les perfonnages deftinés à exciter
l’attendriffement fuuent exempts de ce ridicule
qu’il répandit,fur les autres. M. Piccinni comprit
8c féconda parfaitement fis intentions. Il diftingua
le cara&ère de fes acleurs par le ftyle de fes airs
8c fut allier , fans difparate , le pathétique le plus
' touchant aux gentilieftes de la gaîté. Les finals
n’en avoient pas encore cette variété de mouve-
mens 8c de fituations qu’on leur a donnés depuis,
8c quit les rendent fi admirables ; mais c’eft au
même M. Piccinni que cette invention eft due ; 8c
ce fut cette même année 1760, fur le théâtre de
Naples , qu’il l’exécuta pour la première fois ,
comme on peut le voir au mot fin a l.
La B u o n a f i g l i u o U , qui parut fur les théâtres d’Italie
plus fouvent qu’aucun autre ouvrage , fervit
long-temps , pour les paroles 8c pour la mufique ,
de modèle à tout ce qu’on écrivoit. Il y a un 10m-
meil dans la B o n n e f i l l e : par-tout on voulut avoir
un fommeil. Les perfonnages y font égarés dans une
forêt : par-tout encore cette fituation a été copiée,
ôcc. Heureux, dit Voltaire, l’ouvrage dont quel