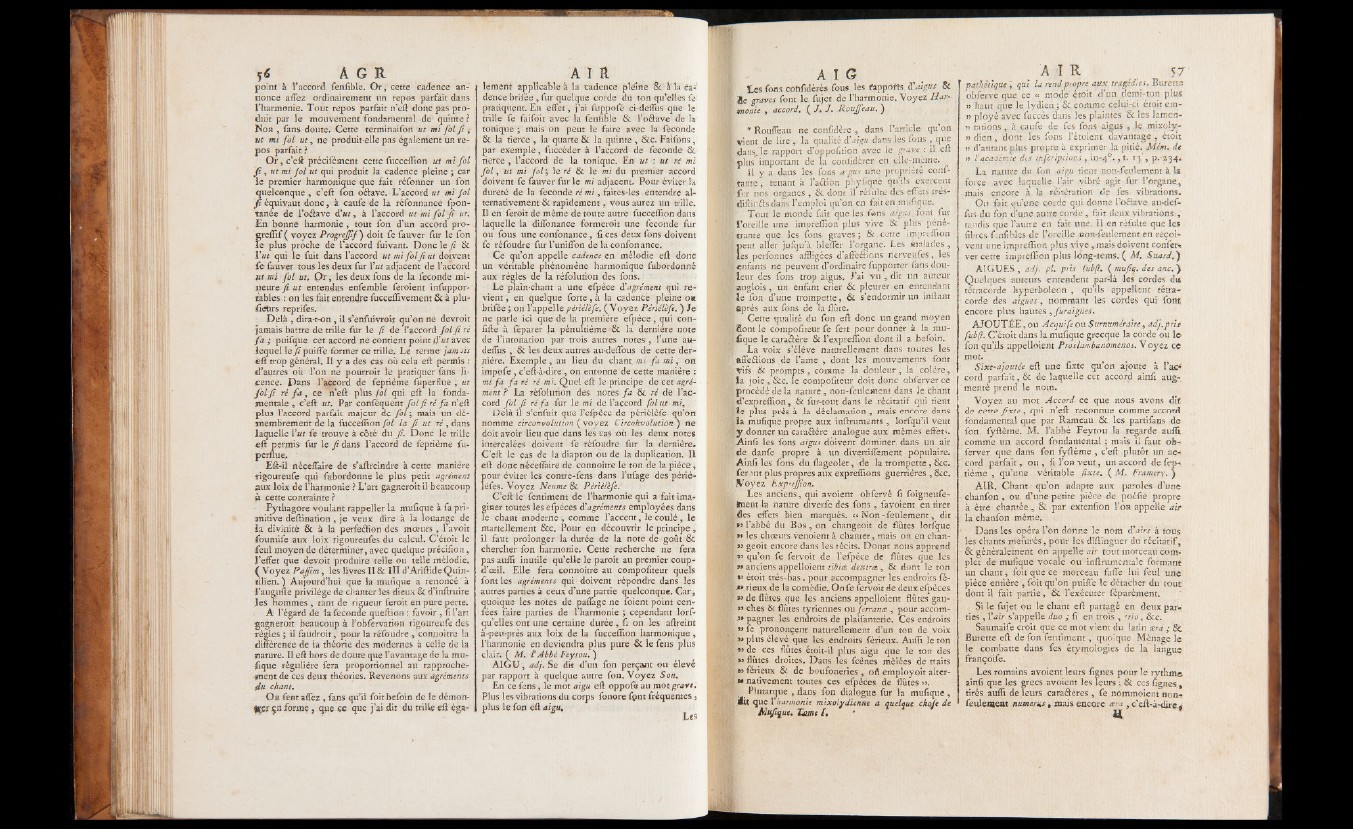
yt A G R
point à l’accord fenfible. O r , cette cadence annonce
affez ordinairement un repos parfait dans
l ’harmonie. Tout repos parfait n’eft donc pas produit
par le mouvement fondamental -de quinte ?
Non , fans doute. Cette terminaifori ut mi fol f i ,-
ut mi fo l ut , ne produit-elle pas également un repos
parfait ?
O r , c’eft précifément cette fucceffion ut mi fo l
f i , ut mi Jol ut qui produit la cadence pleine ; car
le premier harmonique que fait réfonner un fon
quelconque , c’eft Ion oâave. L ’accord ut mi jo l
f i équivaut donc, à caufe de la réfonnance fpon-
tanée de l’o&ave d’u t9 à l’accord ut mi fo l'fi ut.
En bonne harmonie, tout fon d’un accord pro-
greffif ( voyez PragreJJîf ) doit fe fauver fur le fon
le plus proche de l’accord fuivant. Donc le f i 6c
l ’ut qui le fuit dans l’accord ut mi fo l f i ut doivent
fe fauver tous les deux fur Y ut adjacent de l ’accord
ut mi fo l ut, Q r , les deux fons de la fécondé mineure
f i ut entendes enfemble feroient infuppor-
tables : on les fait entendre fuccefîivement & à plu-
fiêtlrs reprifes.
Delà , dira-t-on , il s’enfuivroif qu’on ne devroit
jamais battre de trille fur le (i de l’accord fo l f i ré
fa ; puifque cet accord ne contient point $ut avec
lequel le f i puiffe former ce trille. Lç terme* jamais
éft trop général. Il y a des cas où cela eft permis :
d'autres où l’on ne pourroit le pratiquer fans licence.
Dans l’accord de feptième fuperflüe , ut
fo l f i ré f a , ee n’eft plus fol qui eft la fondamentale
, c’eft ut. Par conféquent fol f i ré fa n’eft
plus l’accord parfait majeur de fo l ; mais un dé*
snembrement de la fucceffion fol la f i ut r é , dans
laquelle Y ut fe trouve à côté du fi. Donc le trille
eft permis fur le f i dans l’accord de feptième fu-
permie,
Eâ-il néceffaire de s?aftreindre à cette manière
ïigoureufe qui fubordonne le plus petit agrément
nux loix de l’harmonie ? L’art gagneroit il beaucoup
à cette contrainte ?
Pythagore voulant rappeller la mufique à fa primitive
deftination, je veux dire à la louange de
la divinité & à la perfeâion des moeurs , 1 avoit
foumife aux loix rigoureufes du calcul. C ’étoit le
feul moyen de déterminer, avec quelque précifion,
l ’effet que devoit produire telle ou telle mélodie.
( Voyez Pajjim, les livres II & III d’Ariftide Quin-
tilien. ) Aujourd’hui que la mufique a renoncé^ à
l ’aueufte privilège de chanter ies dieux & d’inftruire
Jes nommes , tant de rigueur feroit en pure perte.
A l ’égard de ia fécondé queftion : favoir , fi l’art
gagneroit beaucoup à Fobfervation rigonreufe des
règles ; il faudroit, pour la réfoudre , 'connoître la
différence de la théorie des modernes à celle de la
nature. Il eft hors de doute que l’avantage de la mu*
fique régulière fera proportionnel au rapproche-
•jnent de ces deux théories. Revenons aux agréments
{lu chant.
On fent affez , fans qu’il foitbefoin de le démon-
Hgf en forme ? que ce que j’ai dit du trille eft éga-
A I R
lem e r it a p p lic a b le à la c a d e n c e p lé in e 8c à la Cad
e n c e b r ifé e , fu r q u e lq u e c o rd e du to n qu ’e lle s fe :
p r a t iq u e n t .E n e f f e t , j ’ai fu p p o fé ci-d effus q ü e le
tr ille f e f a ifo it a v e c la fe n fib le & l ’o f t a v e de la
to n iq u e ; mais o n p e u t le fa ir e a v e c la fé co n d e
& la tie r c e , la qua rte & la q u in te , & c . F a i fo n s ,
p a r e x em p l e , fu c c é d e r à l’ a c co rd d e fé c o n d é 8c
tie rc e , l ’ a c co rd d e la to n iq u e . E n ut : ut ré mi
fol 9 ut mi fol ; l e ré 8c l e mi d u p r em ie r a c co rd
d o iv e n t f e fa u v e r fu r l e mi ad ja c en t. P o u r é v ite r la
du re té d e la fé c o n d é ré mi, fa ite s -le s en ten d re alte
rn a t iv em e n t 8c r a p id em e n t , Vous au re z u n trille.
I l en fe ro it d e m êm e d e to u te au tre fu c c e f fio n dans
la q u e lle la d iffo n an c e fo rm e ro it u n e fé c o n d é fu r
o u fo u s u n e c o n fo n a n c e , fi c e s d e u x fo n s d o iv e n t
fe r é fo u d r e fu r l’ u n iffo n d e la c o n fo n a n c e .
C e qu ’o n a p p e lle cadence e n m é lo d ie e f t d o n c
un v é r ita b le p h é n om èn e h a rm o n iq u e fu b o rd o n n e
a u x r è g le s d e la r é fo lu t io n de s fon s .
L e p lain -ch ant a u n e e fp è c e d'agrément qu i re v
ie n t , e n q u e lq u e f o r t e , à la ca d e n c é p le in e o u
b r ifé e ; o n l ’a p p e l le périélèfe. ( V o y e z Périélèfe. ) J e
n e p a rle ic i q u e d e la p rem iè re e f p è c e , q u i c o n -
f ifte à fép a re r Ja p én u ltièm e -& la d e rn iè re n o t e
d e l ’in to n a tio n p a r tro is au tre s n o te s , l ’u n e au-
deffus , & le s d e u x autres au-d effou s d e c e t t e de rn
iè re . E x em p l e , a u l ie u d u chant, mi fa mi, o n
im p e fe , c ’e ft-à -d ire , o n e n to n n e d e c e tte m an iè re :
mi fa fa ré ri mi. Q u e l e f t le p r in c ip e d e c e t agrément?
L a r é fo lu tio n d e s n o te s fa 8c ré d e l ’a c co
rd fol f i ré fa fu r l e mi d e l’ a c co rd fol ut mi,
D e là i l s ’en fu it q u e l ’e fp ê c e d e p é r ié lè fe q u ’o n
n om m e circonvolution ( v o y e z Circonvolution) n e
d o it a v o ir lie u q u e dans lé s ca s o ù le s d e u x n o te s
in tè r c a lé e s d o iv e n t fe ré fo u d r e fu r la dernière«
C ’e ft le ca s d e la d iap ton o u d e là d u p lica tio n . I l
eft d o n e n é c e ffa ire d e co n n o îtr e le to n d e la p i è c e ,
p o u r é v it e r le s c o n t r e - fen s dan s l ’u fa g e de s p é r ié -
I è fe s . V o y e z Neunte 8c Périélèfe.'
C ’eft: le fen tim en t d e l ’h a rm o n ie q u i a fa it imag
in e r tou te s le s e fp è c e s d’agréments em p lo y é e s dans
l e ch an t m o d e rn e , c om m e l ’a c c e n t , l e c o u lé , l e
m a r te llem en t & c . P o u r en d é c o u v r ir le p r in c ip e ,
il fau t p ro lo n g e r la d u ré e d e la n o t e de g o û t &
ch e r ch e r fo n h a rm o n ie . C e t t e r e c h e r c h e n e fe ra
pa s au ffi in u tile q u ’e l l e le p a ro ît au p r em ie r c o u p -
d ’oe il. E l l e fe ra co n n o ître a u com p o fiteu r q u e ls
fo n t le s agréments qu i d o iv e n t rép o n d r e dans le s
autres pa rtie s à ceux; d ’un e pa rtie q u e lc o n q u e . C a r ,
q u o iq u e le s n o te s d e p a flà g e n e fo ie n t p o in t c e n -
lé e s fa ir e pa rtie s d e l ’h a rm o n ie ; c e p en d an t lo r f -
q u ’e lle s o n t u n e c e r ta in e d u ré e , f i o n le s aftre int
à-peu -prè s a u x lo ix d e la fu c c e f fio n h a rm o n iq u e ,
l ’ ha rmon ie e n d e v ien d ra p lu s p u r e 8c l e fe n s p lu s
c la ir . ( M. V Abbé Feytou, )
A I G U , ad). S e d k d ’un fo n p e r ç a n t o u é le v é
p a r rap p o rt à q u e lq u e au tre fo n . V o y e z Son.
E n c e f e n s , l e m o t aigu e f t o p p o fé a u m o t grave.
P lu s le s v ib ra tio n s d u co rp s fo n o r e fo n t fré q u e n te s >
p lu s le fo n e ft aigu.
Les
A I G
L e s fon s co ftfid érès fo u s le s fa p p ô f ts cYaigus 8c
2 e graves fo n t l e fu je t d e l ’h a rm o n ie . V o y e z Harmonie
, accord. { J . J. Roujfeau. )
* R o u fle au n e co n fid è re -, dan s l’ a r t ic le q u ’o n
v ie n t de lire , la qua lité d’aigu dans le s fo n s ., q u e
dans, le rap p o rt d’ o p p o fitio n a v e c l e grave : i l e ft
p lu s imp ortant d e la c o n fid é re r e n e lle -m em e .
I l y a , dans le s fon s a'gus u n e p ro p r ié té c o n f ia
n te , tenant à l’aé tion p h y fiq u è q u ’i ls e x e r c e n t
fu r nos org an e s , & d o n t il r é fu lte des e ffe ts ir e s -
diftin& s .d an s l ’em p lo i qu ’o n en f a i t e n m u fiq u e .
' T o u t l e m o n d e fait q u e le s fo n s aigus , font fur
f o re ille un e im p re ffio n p lu s v i v e & p lu s p én é t
ra n te q u e le s fo u s g r a v e s ; & . c e tte imp re ffion
p e u t a lle r ju fq u ’à b le ffe r l ’o rg an e . L e s ma lad es ,
T e s p e r fo n n e s a fflig é e s d ’aft'eétions n e r v e u fe s , les
[en fan ts n e p e u v e n t d’o rdin aire fu p p o r te r fans d o u le
u r de s fo n s trop a ig u s . J’a i v u , dit un au teu r
^anglois , un en fan t cr ie r & p leu r e r e n en ten d an t
l e fo n d ’un e t rom p e t t e , 8c s ’en d o rm ir un in ftan t
ap rè s a u x fo n s d e la flû te .
[ C e t t e q u a lité d u fo n eft d o n c u n g ran d m o y e n
S o n t le com p o fiteu r f e fe r t p o u r d o n n e r à la m u -
ü q u e le ca ra& è re & l ’e x p r e f fio n d o n t i l a b e fo in .
L a v o ix s ’é lè v e n a tu re llem e n t dans to u te s le s
t iffe â io n s d e . l ’am e , d o n t le s m o u v em en t s fo n t
V ifs & p rom p ts , com m e la d o u le u r , la c o l è r e ,
l a jo ie , & c , l e com p o fiteu r d o it d o n c o b fc r v e r c e
p ro c é d é d e la n a tu r e , n o n - fe u lem e n t dan s le ch an t
d ’e x p r e f fio n , & fur-tout dans le r é c ita ti f qu i t ien t
l e p lu s p rè s à la d é c lam a tio n , mais e n c o r e dans
l a mu fiqu ë p ro p r e a u x in ftrum en ts , lo r fq u ’i l v e u t
y d o n n e r u n c a ra ftè r e a n a lo g u e a u x m êm e s e ffe ts .
A in f i le s fon s aigus d o iv e n t d om in e r , dans u n air
f ie d a n fe p ro p r e à u n d iv e r tiflem en t p o p u la ire .
A in f i le s fo n s d u f la g e o le t , d e la t r om p e t t e , & c .
fe r ont p lu s p ro p re s au x e x p r e flio n s g u e r r iè re s , & c .
ployez ExpreJJîon.
L e s a n c ie n s , q u i a v o ie n t o b fe r v é f i fo ig n e u fe -
fn e n t la n atu re d iv e r fe d e s fo n s , fa v o ie n t e n t irer
id e s effe ts b ie n m a rqu és . « N o n - f e u l em e n t , dit
• j l ’a b b é d u B o s , o n ch an g e o it d e flû te s lo r fq u e
»* le s choe u r s v e n o ie n t à ch a n te r , mais o n en ch an -
w g e o it en c o r e dans le s réc its . D o n a t n ou s ap p ren d
q u ’o n fe fe r v o i t d e l ’e fp è c e d e flû te s q u e le s
o» anc iens ap p e llo ie n t tibia dextra, , & d o n t le ton
•s é to it t r è s -b a s , p o u r a c com p a gn e r le s en d ro its fé -
-»» r ie u x d e la com é d ie . O n f e fe r v o i t d e d e u x e fp è c e s
99 d e flûtes, q u e le s an c ien s a p p e llo ie n t flû te s g au -
» ch e s & flûtes ty r ie n n e s o u ferrante , p o u r a c com -
9» pa gn er le s en d ro its d e p la ifan te r ie . C e s end roits
« f e p ro n o n ç e n t n a tu re llem e n t d ’un ton d e v o ix
9» p lu s é le v é q u e le s en d ro its fé r ie u x . A u f f i le ton
99 de c e s flûtes é to it -il p lu s a ig u q u e l e ton des
; 99 flû te s dro ite s . D a n s le s fc è n e s m ê lé e s de traits
*9 fé r ieu x & d e b o u fo n e r ie s , oA em p lo y o i t alter-
m n a t iv em e n t tou te s c e s e fp è c e s d e flû te s » .
P luta rque , dan s fo n d ia lo g u e fu r la m u f iq u e ,
m q u e Y harmonie mixolydienne a quelque ckofe de
Mufique. Tome /•
A I R 5 7
pathétique 9 qui la rend, propre aux tragédies. Burette
obferve que ce « mode étoit "d’un clemi-ton plus
» haut que le lydien,; .& comme celui-ci étoit em-
99 ployé avec fuccès dans les plaintes & les lamen-
99 tâtions ,.,à c-aufe de fes fons aigus , le mixoly-
99 dien, dont les fons l’étoient davantage , étoit
» d’autant plus propre à exprimer la pitié. Mém. de
99 Y académie des inferiptions , in-40. ,t, 13’ , p.234.
La nature du fon aigu tient non-feulement à la
forçe avec laquelle l’air vibré agit fur l’organe,
mais encore à la réitération de fes vibrations.
O11 fait qu’une corde qui donne l’oefave au-def-
fus du fon d’une autre corde , fait deux vibrations.,
tandis que l’autre en fait une. Il en réfulte que les
fibres fonfibles de l’oreille «en-feulement en reçoivent
une impreffion plus v iv e , mais doivent confère
ver cette impreffion plus long-tems. ( M. Suard. )
A IGU E S , adj. pl. pris (ubfl. ( mufiq. des anc. )
Quelques auteurs entendent par-là les cordes dit
tétracorde hyperboleon , qu’ils appellent tétra-
corde des aigues, nommant les cordes qui fontj
encore plus hautes , furaigiies.
AJO U TÉ E , ou Acquife ou Surnuméraire, adj.prît
fubfl. C ’étoit dans la mufique grecque la corde ou le>
fon qu’ils appelloient Proslambanomenos. V oyez ce
mot.
Sixe-ajoutée eft une fixte qu’on ajoute à l ’ac*
cord parfait, & de laquelle cet accord ainfi augmenté
prend le nom.
Vo yez au mot Accord ce que nous avons dif
de cette fixte , qui n’eft reconnue comme accord
fondamental que par Rameau 8c les partifans de
fon. fyftême. M. l’abbé Feytou la regarde auffi,
. comme un accord fondamental ; mais il faut ob-*
ferver que dans fon fyftême , c’eft plutôt un accord
parfait, o u , fi l’on v eut, un accord de feptième
, qu’une véritable fixte. ( M. Framery. )
AIR. Chant qu’on adapte aux paroles d’une
chanfon, ou d’une petite pièce de poéfie propre
à être chantée, & par extenfion Fon appelle air
la chanfon même.
Dans les opéra l’on donne le nom d’airs^à tous
les chants mefurés, pour les dîftinguer du récitatif,
& généralement on appelle air tout morceau complet
de mufique vocale ou inftrumcntale formant
un chant, foit que ce morceau faffe lui feul une
pièce entière , foit qu’on puiflè le détacher du tout
dont il fait partie, & l’exécuter féparément.
Si le fujet ou le chant eft partagé en deux par-;
ties , Y air s’appelle duo ; fi en trois , trio, &c.
Saumaife croit que ce mot vient du latin ara ; 8c
Burette eft de fon fentiment, quoique Ménage le
le combatte dans fes étymologies de la langue
françoife.
Les romains avoient leurs fignes pour le rythme
ainfi que les grecs avoient les leurs ; & ces fignes %
tirés auffi de leurs cara&ères , fe nommoient non**
feulement numeras, mais encore a r a , c’eft-à-dire 4
%