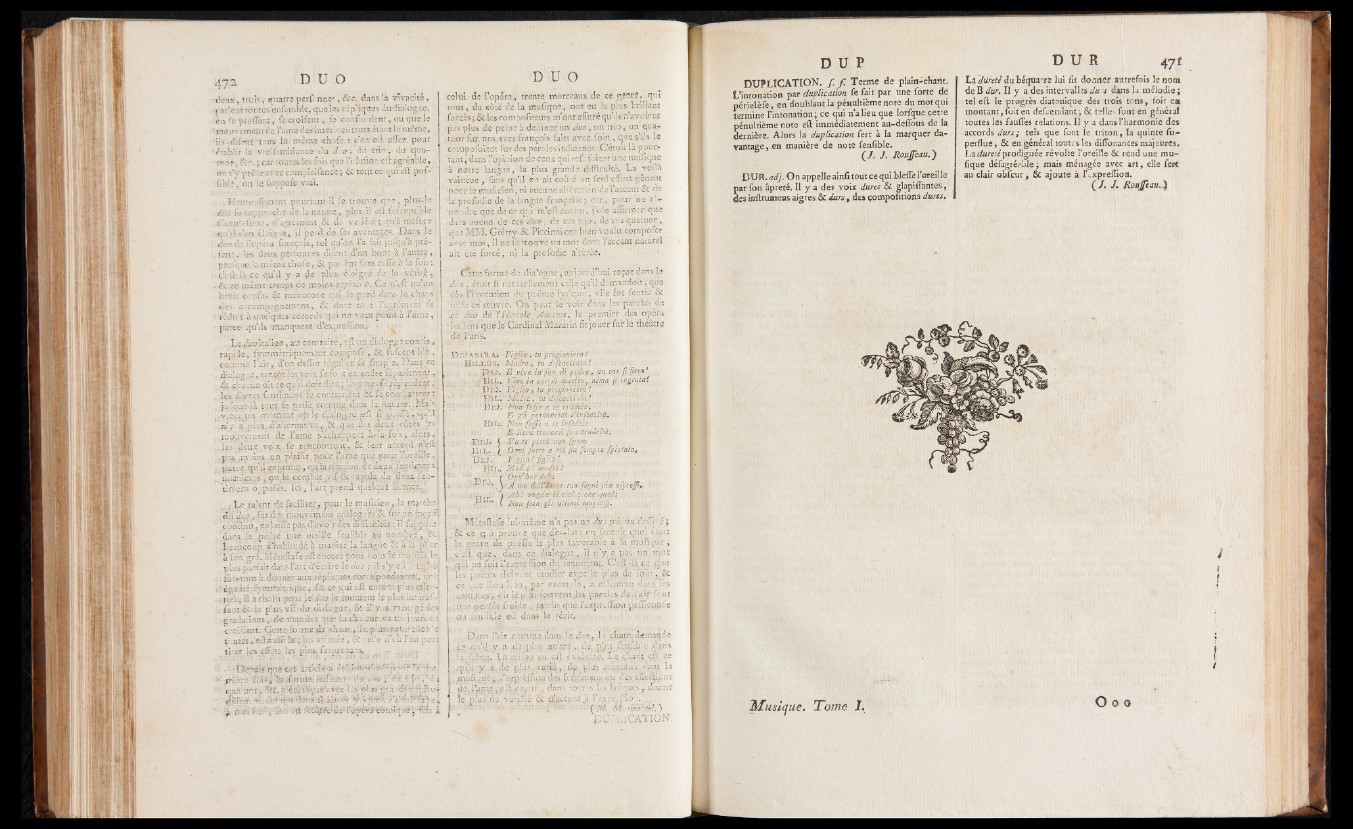
deux, 'tr'ois, quatre perfonnes, &c. dans îa vivacité,
• parlent toutes en (omble, que les répliques du dialogue,
en fe preftant , fecroifent, fe confordent, ou que le
J mouvement-de l’ame desintericcuteurs étant le même,
ils-difetit 'tous la même cliofe :• ç’en!,eft afïez pour
‘ établir la vraiftmblanee- du d . o , du trio, du qua-
tu o fS ic , ; car toutes les fois que l’Hution eft agréable,
on s’y prête avec complaifance ; & tout ce qui eft' pof-'
•fibls, on le fuppole vrai.
, Heureuftemsnt pourtant il fe trouve .qpe, plusfte
duo fo-i approche de là na/ure/, plus il eft fufceptible :
d’expreftion *-d lag y émsn td e v.aüéié;' qu’à melure '
qu'd. s’en éloigné $ il perd: de fes avantages. .Dans le ,
duo do l’opéra” françbis, .tel qu’on l’a fait j.iifqu’à.pré-
lent, les deux per tonnes, difentftd’un bout à l’autre,
prefque la même chofe, & par ent fans cefie à ’a fois :
' ceiVl'i ce qu’il y a de plus- -éloigné.de la véri:é ,
. 6c en même -.temps de jiioin sr àgréàb ' é .. Ce fn’eft qu’un •
bruit confus & monotone qui fe:1p/rd dans la/chacs i
des acccmpsgnenuns, & dont tout l’agrcment fe j
< rédivt' à qUélÿtes âCéords qui ,t t& m -p pofet-à-Fame , j
• parce: qu’ils manquent'd’eXpreriion.: <■
Le^woitalien, au-contraire, eft un dialcgpe.conci^,
rapide îofymmftriquement compofe , &, fufcépt b!ç ,
comme l ’air, d’un defifm régulier & |Jjgple^Dans;ce
.dialogue, tantôt les. voix fe fon.tçatendçè féparémenr, ;
chacun dit ce qu’;ildoit direles^mçsjfo^épQndd^t ,j
. les diyers-ftnümenshfe contrarient $£ f e ço^l^tteat
..jufquedà tout fe pâlie, commp.,dans ]a j^fune. r?Æaîs;
: -vierqmn m om en t où> le cÇ^jggtie,jeft 1
‘ In’y a 'pius, .dViten7ati've-,. ,& ,que .des'deux ^côtés tes J
mqpvemens de d’ame s’échappent a.-la-fo.:s.j alor^,-,
, les 'deux voix fe renççntreot,^ leur accord, n’çft-j
. pas. jra DÎns; -upj. .p!ai-us pour {lame que pour,.l’prejlle ,1
, .paccf'quij exmrmg , o^ ^ ré^ ÿo^ ed ep x ^egtimef s j
*’-»nqns^us , pu.îe-combat v if & rapide de deux fça- i
Vïmen's oppofés. Ici, l’art prend quelque licence,J. j
( _c Le ;talent de faciliter.,, pour Je mqficienla marche)
du c;:70,(iirdus mouviméris analogues cl iur un motif
' 'continu, nè'lâtlTe pas dmvb'r dès aiffrchlfft/: il fuppofe*
dans, le ipol^é uiie 'oréille fenfible ju nqm^re^&j
È.eancoup d’habuudé à manier la langue '& a là;plier
' a ion 'gre I lyiétaftafé'éft encorê poiir ûbus'ië le>
plus parfait dans l’art d’ écrire le duo ; il Vy^ft à.ttachéj-
; : ftarrtnut à.dônnér auxïrépliqùes. ccxrrefpondan-eSI, une!
i - égaâté'.fyrnjfiétî-iqûe, tôft.çe qui eft .encé^-pliiseffç;1.-
- iiiel^ il à choïfi pmr felcfuo Le: moment le plus'intèref-j
fans'.&j Ig .plus, ytf-.dii- .dialogue-, ?&'il.'y;.«3‘rnénrgi les»'
,gradations:,ride maaièse qufe ia.chaleor via toujours.en,
croiffant; Geste forme Je .ebaaf,,.iia: plîkî-patürçllejr'e'
t AU.tés, eftjaulït 1kplus animée, & celle d’c-u l’on peut
tirer les effets les plus, iurprenc.ns. --
, •.• Depuis què éèb krëc\ë-a re-
H sfiière 'fcâVÿ 5- { ^ i f c ^ i t l é i ^ - f o - ' d l
'■ "qnà’ücf ? ;S3è. a^élé’^çuè^.^éc- les- rpl us -çfahds h;ipft.u|
ÿ :feoi feldVxè’-t ^ à
celui de l ’opéra, trente morceaux de ce genre, qui
tou s, du côté de la mufique, ;ont eu -î'e plus ^brillant
fuccès; & lescompofiteurs m’ont a duré qu’ils n’avoien.t
■ pas plus .de peine à deffiner un d u o lin trio, un qua-r
tu,or fur. nos..vers françois. faits avec foin , que s’ils le
compofoient fur des paroles italiecnes. C ’éto.it là pourtant,"
dans l’opinion de ceux qui refu fuient une mufiqiiè
à notre langue, la plus grande difficulté. La voila
vaincue , fans qu’ il en aitcoûié un feul effort gênant
pouf le muficien, ni aucune altération de l’accent & de
'la' profoüie de la langue françoife ; car, pour ne r . -
pondre que de ce qui m’eft connu, j’oie afiîrmer -que
edans aucun de ces diio‘ , de ces trio , de’ces quatuor ,
que M M . G ré tfy & Piccinni ont bien voulu-compofer
avec moi , il ne le trouve un m ot dont l’acccnt naturel
ait été forcé, ni la profoc\ie altérée.
Cette 'forms de. dia’ôgüe faù jourd’hui reçu e dans J e
duo , étôit ft naturellement celle qu'il damaftdoit, que
‘ dès l’invention du poëme lyriqu e, elle'fut fentie &
.' nilfe én oeuvre. On peut le vdir dans' les-par oies de
\cé duo de YHertoU. '■ Amante,. lepptemief . des
f italien squ e le' Cardinal Ms-zarih fit jouer fur le théâtre
' dè .Paris.
DE-Jf a n iR A-. F!g[[o:} tu prigioinero !
H i LEU S. Madré, tu ddcaccio^a.1 . -
. .. DE.J. iJE vipe in'lféii di\p0i\£'j;.un cor.
, y'H'iL.. l(iué in cor. di tp a ijto a ln ^ fi ingratai
' - " DE3. Figlio s. ta, prigiomero ! .
. ' 1 ÎHiL'.“Màir&l’M VijcàccŸatà r
' '• Ï)E>. ‘Nâir 'fè ffé' a te crüd&è, .1
E gli peim/ieiei-lAn^edeii^L, '
H lin Non fojje a te iiifede le ' -
É : lieite trovarèi fua truàcltà, :
- -DEJv J &çt-te pieté non fpe.ro • -, • ,
I3IL. { Ogni forte a M fia feindre jpietàia,
. D e/ . , FÏgliphjiglio | .
.t ‘ l/ïE .‘ JfâàalèTmadré!
. < fy .'m td e t liL r mn figni f in cfiref:.. > '
3 rT r y' dï'h-J va gli a i l -cithï\eke>qtftfii
.” IL* i ( 'N9ni^ n i ^ï--^ûmj.j^npdpff^l . .
Mctaftaïg lui-iftême n’a'pas,on </w/.mh uxdcOiï'é;
• & ce q.-i Ipfoiiv.e quédes^iors onjfentoit que] était ■
, Je . genre dé ppéfie lg-.piu.s- favorable, à là .njuftqüè ,
, ç’eft q ue , dans, ce. dialàgûé.-, il n’y,, a. pas. un -mot
qui ng .fpit i’expçgflion çlu, fentmaenp C éft^jiâ.çe, que
les poètes doivent' étudier avgefte. plus de foin
ce que Rou fftau , par exemple, a méco.bnu dans fes
. captât gSârôh le p;'û3-'fpqv£nt les paroi es- c* e ; l’a i r ( o n t
^ que pentée frpjde p tandis qiie^Jlçxpreftipn p^ffionpée
■ pu feijiitle eft dans le récit/,, '
Dans l’air comme dans 1 e d::o, la chant-demande
ce y a de pîc.s an'mé , .de; pi,;'-'; fcnfibh: dans
. la.fcôqg. l a rai ion .gu eft évident?, Le. çha fît eft. ce
qu’ il - y a de j-lu.s varié , de. plus acçgptué dans la
îïuifi ,,ne ; ..’exp: eifioa des fi. rci rner.s pu c es aRcélipns
de -l’anASveft. .co;c u i , dans'otites les langues, donne
le p lu / d ç . vaftê.é d/ic cp n t ji l’ex p rc fu o à.
ij-;r;r ;. ■; .;••*.r r : . -•i'Çflff. -Mrrfiiôr.4/.)
| r P p i / P L lC A T 1 0 Nr.
D ü P
DUPLICATION, ƒ f . Terme de plain-chant.
L’intonation par duplication fe fait par une forte de
périelèfe, en doublant la pénultième note du mot qui
termine l’intonation; ce qui n’a lieu que lorfque cette
pénultième note eft immédiatement au-deffous de la
dernière. Alors la duplication fert à la marquer davantage
, en manière de note fenfible.
( / . J. Roujfeau. )
DUR. adj. On appelle ainfi tout ce qui bleffe l’oreille
par fon âpreté. Il y a des voix dures & glapiffantes,
des inftruaiens aigres & durs, des çompoutions dures.
D U R 47 f
L i durete1 dubéquarre lui fit donnet autrefois le nom
de B dur. Il y a des intervalles dus dans la mélodie ;
tel eft le progrès diatonique des trois tons, foir ea
montant, foit en defeendant; & telle' font en général
toutes les fauffes relations. Il y a dansl’harmonie des
accords durs; tels que font le triton, la quinte fu-
perflue, & en général toutes les diffonances majeures,
La dureté prodiguée révolte l’oreille & rend une mu-
fique défagréeble ; mais ménagée avec art, elle ferc
au clair obfcur, & ajoute à l’-xpreffion.
( / . /. Roujfeau
Musique. Tome 1. O o o