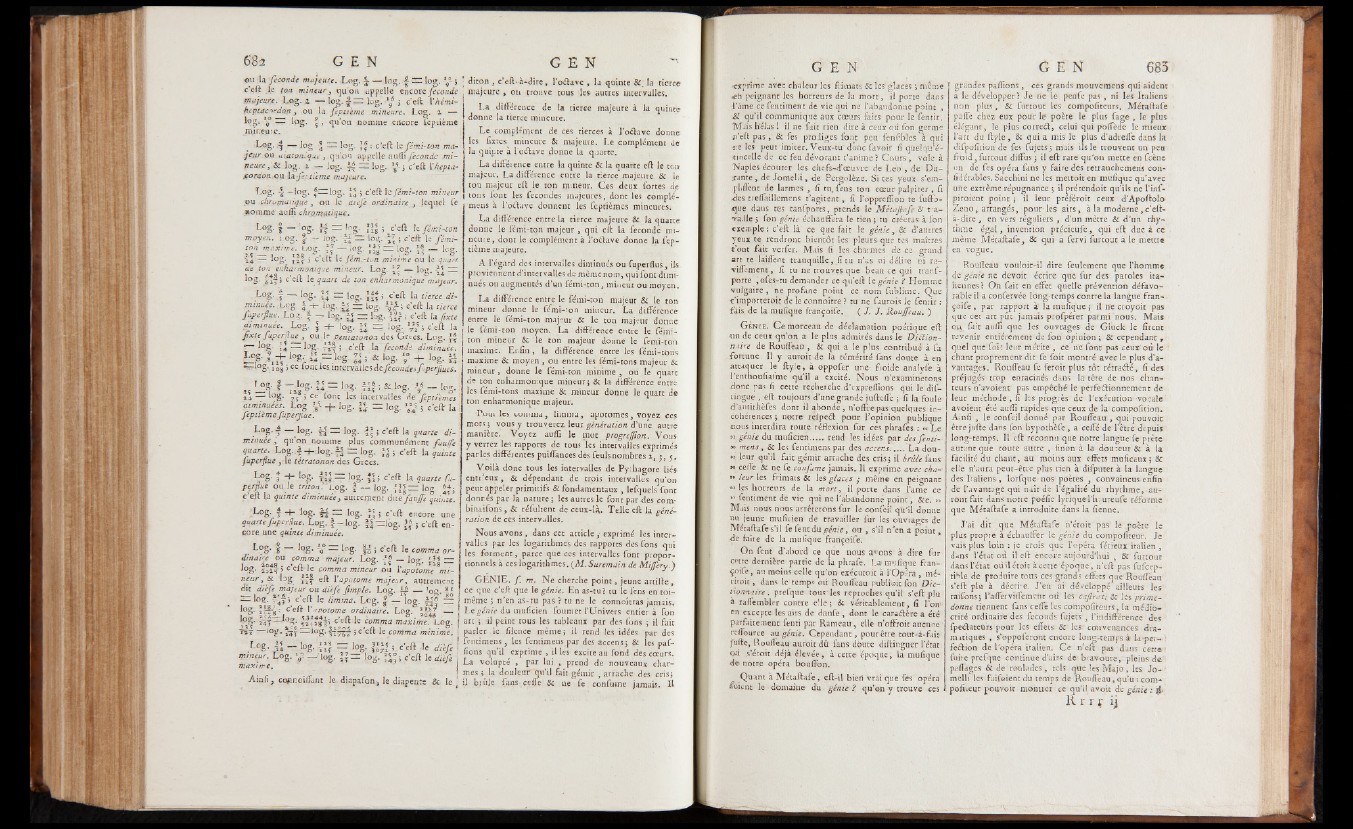
ou ;la fécondé majeure. Log. J- — log. .■ j. 2Z Iog. *9- ;
c’eft le ton mineur, qu’on appelle encore fécondé
majeure. Log. i — log. |==::log. *96 ; c’eft. l'hémi-
hcpfâc'iedQfij ou la feptième mineure. Log. i —■
V* Ipg* ç> qu’on nomme encore fêpeième
mjr.eu.e.
Log. — log | — log. c’eft Le fémi-ton majeur.
ou aiatp/uqxe , .qu’pn appelle au Si fecon.de mi-
neure, 8c log. z — Jog. z z lo g . y . j c’eft i’hepta-
fordon.oa lafegtïéme majeure.
Log. ~ — log. |= io g . |'î>; c’eft le fémi-ton mineur
ou çkrvmaiique, ou le diefe ordinaire , lequel le
a o n im e aoffi chromatique.
L° g - 1 B :SS- iB x12îs8 .> c’eft le fémi-ton
moyen. L°g-1- - iog. — log. - ; c’eft ie fémiton
rnaxi
log
me. l.og.
• 1u15s ..J cr*
| î — ioSelt'le
liS — Jog- ,ïî — log-
'ton minime ou le quart
fém.-
de ton en:karmoniq
ue mineur,
uart de ton
c’eft le q
Log
1 enlit
■ 15 log. wp —
irmonique majeur.
.Lof l — Jpg- I l = iog. 144.
12 s > c’eft la tierce diminuee.
L«g M , il 1Slog. -y/- j c’eft la tierce
fuperflue. .Log. | —- log- i l = : log- ISf j c’eft la fixte
diminuée,
fixte fuper
Log. |
nue , ou
log. I l log. !; c’eft la
E Pentatohon des Grecs. Log.
L>g- 24— j .c’eft la féconds diminuée.
‘ “Si U = log- I I ; & log. \° + Jog. g j
iog j ce ionc les intervalles de féconda fperjiues.
| £ É g m S ^ m m m & lp s- v - m
44 — log- 7,s i Cfj l°nc les mtervalles de feptiémes
aiminuiès. Log ÿ + log. S = log. I*/ ; c'eft la
Jeptieme Juperpue.
L o g .| — log. y — log. | | ; c'eft la quarte di-
mi nuée } qu on nomme plus communément fauffe
quarte. Log..|^-..lQg . | I i= lo g . JJ; c'eft la quinte
fuperfiue ,:le iitratonon des Grecs.
Log- t ■ +• log- f S Jog. j i j c'eft la quarte Cu-
ptrflue ouje triton**Log. f- — log. {lu — jôo 64 j
c’eft la quinte diminuée, autrement dite fauffe quinte.
lLo& I *+“ t e * H — Iog- i l i c’eft encore une
quarte fuperfiue. Log. f— log. fjz z là g . j c’eft encore
une quinte diminuée.
. Log- tf lQg. — log. ; c’eft le comma or- ;
dîna ire ou comma majeur. Log. — log. — ■ I
log. c’eft-le comma mineur ou ïapotome mineur
, & log. y|-|- eft l’apotome majeur, autrement
dit diefe majeur ou diefe fimple. Log. — ?0g ’ 81
— log. j c’eft le limma. Lcg. f — log. z z |
log. c’eft l’-7Uo/oi77e ordinaire. Log. — |
Î i î c’eft le comma maxifne. Log.
T»"? iog* —— l°g- | i 7 } c’eft le comma minime. I
,L°g* \ l ~ log- i z f = log* MIL i c’eft -le J
Log. ÿ -^log. log. S J i c'eft le diefe j
maxime.
Ainfij copnoiffant le diapafon-, le diapenre & le 1
; diton , c'eft-à-dire, l’oftavc , la quinte 8c la tierce
j majeure , on trouve tous les autres intervalles.
La différence de la tierce majeure à la quinte
donne la tierce fliineure.
Le complément de ces tierces à I’oéhve donne
les fixtes mineure & majeure. Le complément «Je
la quinte à l cétavç .donne la quarte.
La différence entre la quinte 8c la quarte eft le tcu
majeur. La différence entre la tierce majeure & le
ton majeur eft le ton mineur. Ces deux fortes dp
tons font les fécondés majeures, dont les complé-
mens à l’oftave donnent les feptiémes mineures«
La différence entre la tierce majeure & la quarte
donne le fémi-ton majeur , qui eft la fécondé milieu!
e, dont le complément à l’oélave donne la fçp-
tième majeure.
A l’égard des intervalles diminués ou fuperfluS, ils
proviennent d’intervalles de même nom, qui font diminués
ou augmentés d’un fémi-ton, mineur ou mdyen.
La différence entre le fémi-ton majeur & le ton
mineur donne le fémi-ton mineur. La différence
ent-re le fémi-ton majeur & le ton majeur donne
le fémi-ton moyen. La ' différence entre le fémi-
ton mineur & le ton majeur donne le femi-ton
maxime. Enfin, la différence entre les fémi-tons
maxime & moyen , ou entre les fémi-tons majeur &
mineur , donne le fémi-ton minime, ou le quart
de ton enharmonique mineur} & la différence entre
les fémi-tons maxime & mineur donne le quart de
ton enharmonique majeur.
Pour les. comma, limma, apotomes, voyez ces
mors} vous y trouverez leur génération d’une autre
manière. Voyez auffi le mot progreffion, Vous
y verrez les rapports de tous les intervalles exprimés
parles différentes puiffances dès feulsnombres 2, 3, y.
Voilà donc tous les intervalles de Pythagore liés
entr’eux, & dépendant de trois intervalles qu’on
peut appeler primitifs & fondamentaux , lefquels font
donnés par la nature; les autres le font par des com-
binaifons, & réfultent de ceux-là. Telle eft la pénétration
de ces intervalles.
Nous avons, dans cet article y exprimé les intervalles
par les logarithmes des rapports des fons qui
les forment, parce que ces intervalles font proportionnels
à ces logarithmes. (M.Suremain de Mijfery.)
GENIE, f m. Ne cherche point, jeune artifte,
ce que c’eft que le génie. En as-tu? tu le fens en toi-
même ; n’en as-tu pas ? tu ne le connoîtras jamais,
L G génie du muficien foumet l’Univers entier à fon
art;; il peint tous les tableaux par des fons il fait
parler .le filcnce même; il rend les idées par des
lentimens, les fentimens par des accens; & les paf-
fions qu’il exprime , il les excite au fond des coeurs.
La volupté', par lui , prend de nouveaux charmes
; la douleur qu’il fait gémir , arrache des cris;
il brûle fans ceffe & ne fe confuine jamais. Il
-exprime avec chaleur les fiimats & les glaces ; même
*eh peignant les horreurs de la mort, il porte dans
l’àme ce fentiment de vie qui ne l’abandonne point ,
8L qu'il communique aux coeurs faits pour le fentir.
M il s fa'élas ! il ne fait rien dire à ceux ou fon germe
n’eft pas, & fes proliges font peu fenfîbles a qui
ne les peut imiter. Veux-tu" dofic favoir fi qùelqlfé-
tincelle de ce feu dévorant t’anime? Cours , vole à
Naples écouter les chefs-d’oeuvre de Léo , de Du-
xante, de Jonlelii, de Pergolèze. Sites yeux s’em-
pliffent de larmes , fî tu. fens ton coeur palpiter , fi
des creffaillemens t’agitent, fî l’oppreflion te fuffo-
■ que dans tés canfports, prends le Métaftafe 8> t a-
và.Jle ; fon génie échauffera le tien; tu créeras à fon
exemple: c’eft là ce que fait le génie, & d’autres
yeux te rendront bientôt les- pleurs que tes maîtres
t’ont fait verfer. Mais fi les chàrmes de ce grand
art te laiffent tranquille, fi tu n’as ni délire ni râ-
viffement, fi tu ne trouves que beau ce qui trar.f-
porte ,ofes-tu demander ce qu’eft le génie ? Homme
vulgaire , ne profane point ce nom fublime. Que
t ’importeroirde leconnoître ? tu ne faurois le fentir :
fais de la mufique françoife. ( J . J. Roujfeau. )
G ente. Ce morceau de déclamation poétique eft
un de ceux qu’on a le plus admirés dans le Dictionnaire
de Rouffeau , & qui a le plus contribué à fa
fortune II y aurait de Ja témérité fans doute à en
attacjuer le ftyîe, à oppofer une fioide analyfe à
l'enthoufialme qu’il a excité. Nous n’examinerons
Üonc ras fi cette recherche d’cxprefllons qui le dif-
iwrgue , eft toujours d’une grande jufteffe ; fi la foule
d’antithèfes dont il abonde, n’offrepas quelques incohérences
; notre refpe<ft pour l’opinion publique
nous interdira toute réflexion fur ces phrafes : ec Le
m. génie du mufleien..... rend les idées par des fenti-
» mens, & les fentimens par des accens......La dou-
» leur qu’il fait gémir arrache des cris; il brûlé fans
*» ceffe & ne fe confume jamais. Il exprime avec cha-' ;
*» leur lés frimats & les glaces ; même en peignant
•5 les horreurs de la mort, il porte dans l’ame ce ;
»■> fentiment de vie qui ne l’abandonné point, &c. »
Mais nous nous arrêterons fur le confeil qti’il donne
au jeune muficien de travailler fur les ouvrages de
Métaftafes’il fe lent du génie, ou , s’il n’en a point,
de faire de la mufique françoife.
On fent d’abord ce que nous avons à dire fur
cette dernière partie de la phrafe. La mufique fran-
^oife, au moins celle qu’on exécutoit à i’Opéra, nvé-
riroit, dans le temps où Rouflcau publioit fon Dictionnaire
, prefque rous'Ies reproches qu’il s’eft plu
à raffembler contre elle; 8c véritablement, fi l ’on'
en excepte les airs de danfe , dont le caractère a été
parfaitement fenti par Rameau, elle n’offrait aucune
reffource au génie. Cependant, pour être tout-à-fait
jufte, Rouffeau aurait dû fans dtyute diftinguer l’état
où .s’étoit déjà élevée, à cette çpoque, la mufique
de. notre opéra bouffon.
Quant à Métaftafe, cft-il bien vrai que fes opéra
Soient le domaine du génie ? qu’on y trouve ces
grandes paflîons , ces grands mouvemens qui aident
à le développer ? Je ne le pente pas, ni les Italiens
non plus, & ftirtout les compofîteurs. Métaftafe
paflé chez eux pour fe poère le plus fage , le plus
élégant, le plus correét, celui qui poffèae le mieux
l’art du ftyle , 8c qui a mis le plus d’adreffe dans la
difpofîtion de fes fujets; mais ils le trouvent un peu
froid, furtout diffus; il eft rare qu’on mette en fcène
un de fes opéra fans y faire des retranchcmens con-
fidérables. Sacchini ne les mettoit en mufique qu’avec
une extrême répugnance ; il précendoit qu’ils ne l’inf-
piroient point ; il leur préférait ceux d’Apoftolo
Zeno, arrangés, pour les .airs, à la moderne, c’eft-
à-dire , en vers réguliers , d’un mètre & d’un rhy-
tiime égal, invention précicufc, qui eft duc à cc
même Métaftafe, 8c qui a fervi furtout à le mettre
en vogue.
Roufleau vouloit-il dire feulement que l’homme
de génie ne devoit écrire que fur des paroles italiennes?
On fait en effet quelle prévention défavorable
il a confervée long-temps contre la langue françoife
, par rapport à' la mufique ; il ne croyoit pas
que cet artjuit jamais profpérèr parmi nous. Mais
ou fait auln que les ouvrages de Gluck le firent
revenir entièrement de fon opinion; & cependant ,
quel que foie leur mérite , ce ne font pas ceux où le
chant proprement dit fë'foit montré avec le plus d’a-
vantàges. Roufleau fe ferait plus tôt rétrafté, fi des
préjugés trop enracinés dans la tête de nos chanteurs
n’avoient pas empêché le pérfeftionnemcnt de
leur méthode, fi Es progrès de l’exécution vocale
avoient été aufli rapides que ceux de la compofition.
Ainfi , le confeil donné par Rouffeau , qui pouvoir
être jufte dans fon hypothèfe , a ceffé de l’être depuis
longtemps. Il eft reconnu que notre langue fe prête
autant que toute autre , finon à la douteur & à la
facilité du chant, au moins aux effets mufîcaux; &
elle n’aurà peut-être plus rien à difputer à la langue
des Iraliens , lorfque-nos poètes , convaincus enfin
de l’avantage qui naît de l'égalité du rhythme, auront
fait dans notre poéfîe lyrique l’iitureufe réforme
que Métaftafe a introduite dans la fienne.
J’ai dit que Métaftafe n’étoit pas'le poète le
plus propre à échauffer le génie du compofîteur. Je
vais plus loin : je crois que l’opéra férieux italien,
d'ans l’état où il eft encore aujourd’hui • & furtout
dans l’état où il étoit à cette époque, n’eft pas fufeep-
tible de produire tous ces grands effets que-Rouffeau
s’eft plu à décri-e. J’eù ai développé ailleurs les
raifons; l’afferviffemcnc où les caflrati & lés prime-
donne tiennent fans ceffe les compofîteurs, la médiocrité
ordinaire des féconds fujets , l’indifférence des
fpeétateurs pour les effets & les convenances dramatiques
I, s’oppoferont encore long-temps à la-per- : feftion de l ’opéra italien. Ce n’eft pas dans cette-
fuire prefque continue d’airs de bravoure, pleins de
pa fl âge s & de roulades, tels que lesMajo, les Jo-
melli les faifwient du temps de Rouffeau,qu’mcom-
pofiteur pouvoir montrer cc qu’il avoit de génie:
K r r f ij