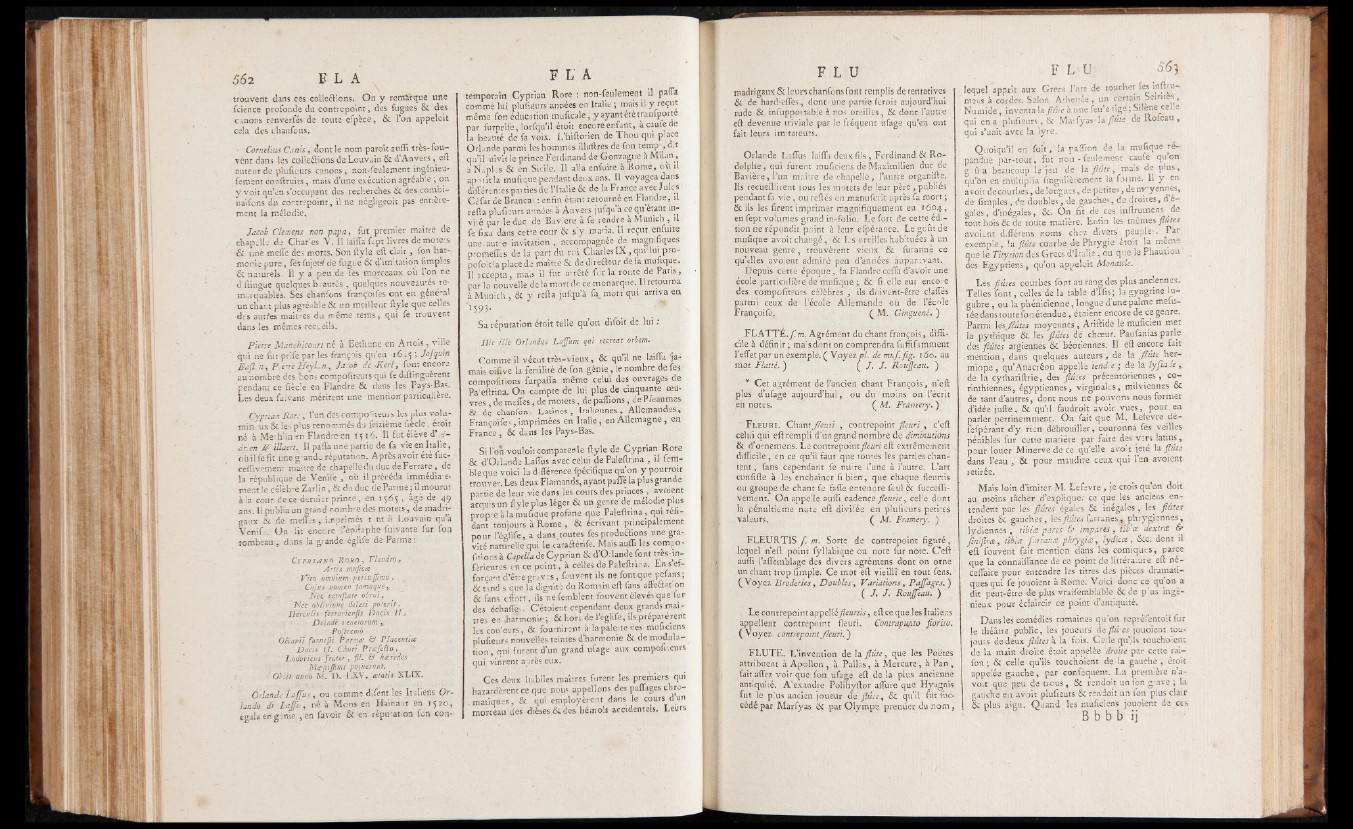
56 2 E L A
trouvent dans ces collerions. On y remarque une
fcience profonde du contrepoint, des fugues & des
canons renversés de toute efpèce, & l’on appeloit
cela des chanfons.
■ Cornélius Canrs, dont le nom paroît auffi très-fou-
vënt dans les colleélions de Louvain & d’Anvers, eft
auteur de plufieurs canons , non-feulement itagenieu-
fement confiruits, mais d’une exécution agréable ; on
y voit qu’en s’occupant des recherches & des combinai
fons du contrepoint, il ne négligeoit pas entièrement
la mélodie.
Jacob Clemejis non papa, fut premier maître de
chapelle de Char es V . 11 laiffa fept livres de motets
& une meffe des morts. Son ftyle eft clair , fon harmonie
pure, fefujet^de fugue & d’imitation fimples
& naturels. Il y a peu.de fes morceaux où l’on ne
d flingue quelques b sautés , quelques nouveautés remarquables.
Ses charifons françoifes ont en général
un chant plus agréable & un meilleur ftyle que celles
des autres maîtres du même tems, qui fe trouvent
dans les mêmes recueils.
Pierre Manchicourt né à Béthune en Artois, ville
qui ne fut prife par les françois qu’en 1645 ? J°fauin
Baft h , P en-e HeyLn, Jasob de -Kerl, font encore
au nombre des bons composteurs qui fe diftinguèrent
pendant ce fiècte en Flandre & dans les Pays-Bas.
Les deux fui vans méritent une mention particulière.
Cyprian Rare, l’un des composteurs les plus volumineux
& les plus renommés da feizième iiècle, etoit
né à Me-'hiin en Flandre-en 1516. 11 fut élève d’A drien
Jpillaert. Il paflà une partie de fa vie en Italie,
où il fe fit une grande réputation. Après avoir été fuc- •
ceffivement maître de chapelle du. duc de Ferrare, de
la république de Venife , où il précéda immédiatement
|e célèb-e Zarlin, & du duc de Parme ; il mourut
à la cour de ce dernier prince, en 1565 , âgé de 49
ans. Il publia un grand nombre des motets., de madrigaux
& de meffe-s, imprimés t nt à Louvain qu’à
Venife/ On lit encore l’épifaphe fuivante fur fon
tombeau, dans la grande églife de Parme:
CrpRUxn Ro r o Flandro,
Artis mufica Vîto omnium.peritljfimo, . „
Cujus nomen famaqi/e, ^
JVec j•etiijlate obrui,
Nec oblivione deleri porerit,
H er eu lis ferrarienfis Ducis II,
Deindè l enetorum ,
Poflremà.
' OEiavii farnefii P arma &. Placenticc
Ducis IJ. Chori Pràfeâo ,
Loiovicus fréter, fil. & kâfedes
Mcejiijfuni pojuerunt. -
■ Obïtt- ûntio JV1. D. LXV. atatis XLIX.
Ôrlandc Laffus, ou comme difent les Italiens Orlando
dï Lajfo, né à Mons en Hainaut en 1520,
égala en génie , en favoir & en réputation fon con-
F L A
temporain Cyprian Rore : non-feulement il paffa
commè lui plufieurs années en Italie ; mais il y reçut
même fon éducation muficale, y ayant été tranfporte
par furprife, lorfqu’il étoit encore enfant, acaufede
la beauté de fa voix. L’hiftorien de Thou qui place
Orlande parmi les hommes illuftres de fon temps dit
qu’il ùivitle prince Ferdinand de Gonzague à Milan,
à Naples & en Sicile. Il alla enfuite à Rome, où il
j api>rit la mufique pendant deux ans. Il voyagea dans
différentes parties de l’Italie & de la France ayec Jules
Céfarde Brancas : enfin étant retourné en Flandre, il
refta plufieurs années à Anvers jufqu a ce qu étant invité
par le duc de Bavière à fe rendre à Munich , il
fe fixa dans cette cour & s'y maria. Il reçut enfuite
une antre invitation , accompagnée de magnifiques
promeffes de la part du roi CharlesIX, qui lui pro-
pofoitla place de maître Si de direéleur de fa mufique.
Il accepta, mais il fut arrêté fur la route de Paris,
par la nouvelle de la mort de ce monarque. Il retourna
à Munich , & y refta jufqu’à fa.mort qui arriva en
M 9 3 -
Sa réputation étoit telle qu’on difoit.de lui t
Hic ille Orfindiîs Lajfum qui recréât orbem.
Comme il vécut très-vieux, & qu’il ne laiffa jamais
oifive la fertilité de fon génie , le nombre de fes
compofitions furpaffa même celui des ouvrages de
Pa eftrina. On compte de lui plus de cinquante oeuvres
, de meffes, de motets, de pallions, de Pfeaumes
& de chanfon. Latines, Italiennes,, Allemandes,
Françoifes, imprimées en Italie, en Allemagne, en
France, & dans les Pays-Bas.
Si l’on vouloit comparesle ftyle de Cyprian Rore
& d’Otlande Laffus avec celui de Paleftrina , il fem-
bleque voici la d.fférence fpécifique qu’on y pourroit
trouver. Les deux Flamands, ayant paffé la plus grande
partie de leur vie dans, les cours des princes, avoient
acquisun ftyle plus léger & un genre demélodie plus
propre àla mufique profane que^Paleftrina, qui rendant
toujours à Rome , & écrivant principalement
pour l’églife, a dans.toutes fes produflions une gravité
naturelle qui le caraâérife. Mais auffi les compos
ion s à Captlla de Cyprian & d’Orlande font très-inférieures
en ce point, à celles de Paleftrina. Eus efforçant
d’être graves s fou vent ils ne font que pefans;
& tandis que la dignité du Romain eft fans affeélaton
&fans effort, ils nefemblent fouvént élevés que fur
des échaffe.s. C ’étoient cependant deux grands maîtres
en ,harmonie ; & hors de l’eglife, ils préparèrent
les cou’eurs, & fournirent à la palette des muficiens
plufieurs nouvelles teintes d’harmonie & de modulation
, qui furent d’un grand ufage aux compofueurs
qui vinrent après eux.
Ces deux habiles maîtres furent les premiers qui
hazardèrent ce que nous appelions des paffages ebro- I . manques, & qui employèrent dans le cours d un
j morceau des dièses &. des bémols accidentels. Lettre
F L U
madrigaux Scieurs chanfons font remplis de tentatives
& de hardi elles, dont une partie feroit aujourd’hui
rude & infuppoitable à nos oreilles, & dont l’autre
eft devenue triviale par le fréquent ufage qu’en ont
fait leurs imitateurs.
Orlande- Laffus laiffa deux fils., Ferdinand & Rodolphe
, qui furent muficiens de Maximilien duc de
Bavière, l’un maître~de chapelle, l’autre organifte.
Ils recueillirent tous les motets de leur père, publies
pendant fa vie , ou reliés en manuferit après fa mort ;
& ils les firent imprimer magnifiquement en 1604,
en fept volumes grand in-folio. Le fort de cette édition
ne répondit point à leur efpérance. Le goût de
mufique avoir changé, & l:s oreilles habituées à un
nouveau genre, trouvèrent vieux & furanné ce
quelles avoient admiré peu d’années auparavant.
Depuis cette époque, la Flandre ccffa d’avoir une
école particulière de mufique & fi elle eut encore
des compofiteurs célèbres , ils doivent-être dalles
parmi ceux de l’école Allemande ou de . l’école
Françoifes " ( M. Ginguené, )
JFLATTÉ.f.m. Agrément du chant françois, difficile
à définir; mais dont on comprendra fuffifamment
l’effet par un exemple. ( Vpyez pl. de muf.fig. 160. au
mot Flatté. ) ( J. J. RoiijJeau. )
* Cet agrément de l’ancien chant François, n’eft
plus d’ufage aujourd’h u i o u du moins on l’écrit
en notes. ( M. Framery. )
F l e u r i . Chant fleuri , contrepoint fleuri , c’eft
celui qui eft rempli d’un grand nombre de diminutions
& d’ornemens. Le contrepoint fleuri eft extrêmement
difficile , en ce qu’il faut que toutes les parties chantent,
"fans cependant fe nuire l’une à l’autre. L’art
confille à les enchaîner fi bien', que chaque fleurtis
ou groupe de. chant fe faffe entendre feul & fucceffi-
vement. On appelle auffi cadence fleurie, celle dont
la pénultième note eft divifée en plufieurs petites
Valeurs. ( M. Framery. )
FLEURTIS f . m. Sorte de contrepoint figuré,
lequel n’eft point fyllabique ou note fur note. C’eft
auffi l’affemblage des divers agrémens dont on orne
un chant trop fimple. Ce mot eft vieilli en tout fens.
(V oy e z Broderies, Doubles, Variations, Paffages, )
( J. J. Roujfeau. )
Le contrepoint appelle fleurtis, eft ce que les Italiens
appellent contrepoint fleuri. Contrapujito fiorito.
( V oyez contrepoint fleuri. )
FLUTE. L’invention de la flûte, que les Poètes
attribuent à Apollon, à Pallâs, à Mercure, à Pan ,
fait allez voir que fon ufage eft de la plus ancienne
antiquité. A ’exandre Polihyftor allure que Hyagnis
fut le plus ancien joueur de flû te % & qu’il fût fuc-1
cédé par Marfyas 6c par Olympe premier du nom,
F L U 5 63
lequel apprit aux Grecs l’art de toucher les inftru-.
nier.s à cordes. Selon Athenée , un certain Seintes ,
Numide inventa la flûte à une feu'e tige ; Silene cel.e
qui en a plufieurs , & Marfyas-la flûte de Rofeau ,
qui s’unit avec la lyre.
Quoiqu’il en foit, la paffion de la mufique répandue
par-tout , fut non - feulement caufé qu on
g ;û:a beaucoup le "jeu de la flûte, mais de plus,
qu’on en multiplia fingulièrement la forme. Il y en
avoit de courbes, de longues, de petites, de moyennes,
de fimples , de doubles, de gauches, de droites, d e -
gales, d’inégales, &. On fit de ces inftrumens ^de
tout bois & de toute matière. Enfin les mêmes flûtes
avoient différens noms chez divers peuple?. Par
exemple, la flûte courbe, de Phrygie étoit la même
que le Tityrion des Grecs d’Italie, ou que le Phauiion
des Egyptiens, qu’on appeloit Monaule.
Les flûtes courbes font au rang des plus anciennes.
Telles font, celles de la table d’Ifis; la gyngrine lugubre
, ou la phénicienne, longue d une palme mefu-
rée dans toute fon étendue, étoient encore de ce genre.
Parmi les flûtes moyennes, Ariftide le muficien met
la pythique & les flûtes dè choeur. Paufanias parle
des flûtes argiennes & béotiennes. Il eft encore fait
mention, dans quelques auteurs * de la flûte her-
miope , qu’Anacréon appelle tendre ,* de la lyfîaJe ,
de la cythariftrie, des flûtes précentoriennes , corinthiennes,
égyptiennes, virginales, milviennes &
de tant d’autres, dont nous ne pouvons nous former
d’idée jufte, & qu’il faudroit avoir vues, pour en
parler pertinemment. On fait que M. Lefevre de-
fefpérant d’y rien débrouiller, couronna fes veilles
pénibles fur cette matière par faire des vers latins,
pour louer Minerve de ce qu’elle a voit jeté la flûte
dans l’eau, ôc pour maudire ceux qui l’en avoient
retirée.
Mais loin d’itniter-M. Lefevre , je crois qu’on doit
au moins tâcher d’expliquer ce que les anciens entendent
par les flûtes égales & inégales , les flûtes
droites & gauches , les flûtes famines., phrygiennes,
lydiennes , tibia pares & impures , tib a dexirtz 6*
finiflm, tibia farrana phrygia, lydica , &c. dont il
eft fouvent fait mention dans les comiques , parce
que la connaiffance de ce point de littérature eft né-
ceffaire pour entendre les titres des pièces dramatiques
qui fe jouoient à Rome. Voici donc ce qu’on a
dit peut-être de plus vraifembiable & de plus ingénieux
pour éclaircir ce point d’antiquité.
Dans les comédies romaines qu’on repréfentoit fur
le théâtre public, les joueurs' de flû es jouoient toujours
de deux flûtes à la fois. Celle qu’ils touchoient
de la main droite étoit appelée droite par cette rai-
fon ; & celle qu’ils touchoient de la gauche , étoit
appelée gauche, par conféquenr. La première n’a-
voit que peu de trous , & rendoit un fon g-ave ; la
gauche en avoit plufieurs & rendoit un fon plus clair
& plus aigu. Quand les muficiens jouoient de ces
B b b b ij