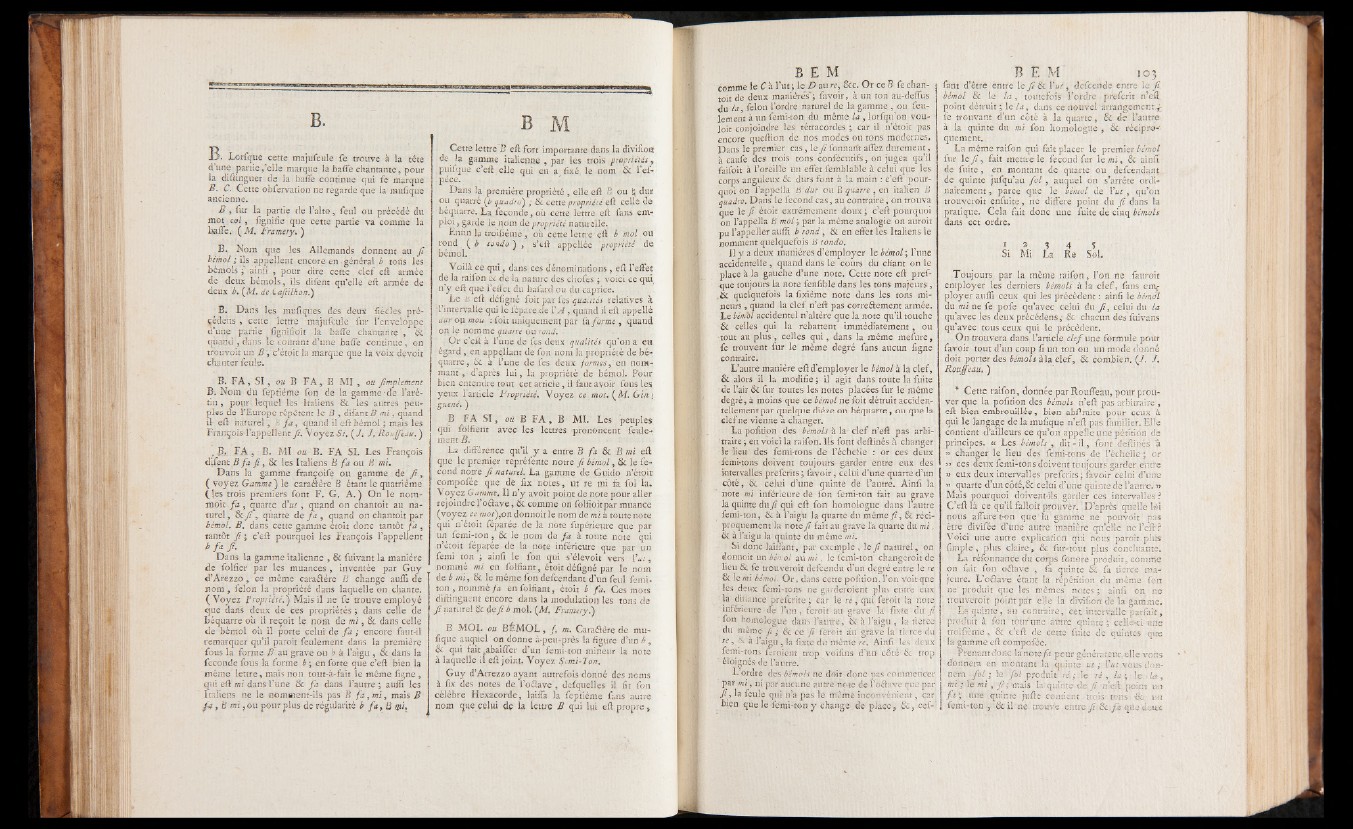
B. B M
B . Lcrfgue cette majufcule fe trouve à la tête
d’une partie/elle marque la baffe chantante, pour
la diftinguer de la;baffe continue qui fe marque
E. C. Cette obfervation ne regarde que la mufique
ancienne.
B , fur la partie de l’alto, feul ou précédé du
mot c o l, fignifie que cette partie va comme la
baffe. ( AL Framery. )
B. Nom que les Allemands donnent au f i
bémol ; ifs appellent encore en général b toûs les
bémols ; ainfi ., pour dire cette cle f eft armée
de deux bémols, ils difent qu’elle efb armée de
deux b. (AL de Lafdlhoq.)
B. Dans les mufiques des deux fiêcles pré-
çédeOs j cette lettre majufcule fur l’enveloppe,
d’une partie fignifioit la baffe chantante , &
quarid , dans le courant d’une baffe continue, on
trouvoit un B', c’étoit la marque que la voix devoit
chanter feule.
B. F A , S I , ou B F A , B MI , ou fimplement
B. Nom du feptième fon de la gamme -de_ Taré-?
tin , pour lequel lès Italiens & les autres peuples
de l’Europe répètent le B , difant B mi, quand
il eft n a t u r e lB f a , quand il eft bémol ; mais les
François l’appellent fi. "Voyez Si. (/ ; J. Roufie.au. )
. B. FA , B. MI ou B. FA SI. Les François
difent B fa f i , Sc les Italiens B fa ou B mi.
Dans la gamme françoife ou gamme de f i
( voyez Gamme ) le caraftère B étant le quatrième
(le s trois premiers font F. G. A .) On le nom-
m.oit'sfa . quarte d'u t , quand on chantoit au naturel
, B&fi,- quarte de fa , quand on chantoit par
bémol. B. dans cette gamme étoit donc tantôt fa ,
tantôt f i ; ç’eft pourquoi les François l’appellent
4 / “ / •
Dans la gamme italienne , & fuivant la manière
de folfier par les muances, inventée par Guy
d’A re z zo , ce même caractère B change auffi de
nom , félon la propriété dans laquelle on chante.
(V o y e z Propriété.') Mais il ne fe trouve employé
que dans deux de ces propriétés ; dans celle de
béquarre où il reçoit le nom de m i, & dans celle
de bémol où il porte celui de fa ; encore faut-il
remarquer qu’il paroît feulement dans la première
fous la forme B au grave ou h à l’aigu , oc dans la
fécondé fous la forme b ; en forte que c’efl bien la
même lettre, mais non tout-à-fait le même ligne,
qui efl mi dans l’une Sc fa dans l’autre ; auffi les
Italiens ne le nomment-ils pas B fa , mi, mais B
ffi f B mi ? ou pour plus de régularité b f a , B W-i♦
Cette lettre B efl fort importante dans la divifiort
de la gamme italienne , par les trois propriétés,
puifque c’efl elle qui en a fixé le nom & l’ef-
pèce.
Dans la première propriété , elle efl B ou fcj dur
ou quarré (J> quadro) ,■ 8c cette propriété efl celle de
bequarre. La fécondé, où cette lettre efl fans em-
p lo i, garde le nom de propriété naturelle,
Enfin la troifième, où cette lettre efl b mol ou
rond ( b totdo) , s’efl appellée propriété de
bémol.
Voilà ce qui, dans ces dénominations, efl l’effet
de la raifon 6c de la nature des chofes ; voici ce qui
n’y efl que l’effet du hafard ou du caprice.
Le b efl défigné foit par fes qualités relatives à
l’intervalle qui le fépare_de VA , quand il efl appelle
dur ou mou : foit uniquement par fa forme , quand
on le nomme quarré ou rond. -
Or c ’efl à l’une de fes deux qualités qu’on a eu
égard, en appelant de fon nom la propriété de bé-
; quarré, 8c.à l’une de fes deux formes, en nommant
, d’après lu i, la propriété de bémol. Pour
bien entendre tout cet article, il faut avoir fous les
yeux l'article Propriété* Vo yez ce mot, (AL &in\
pue né.)
B F A S I , où B F A , B MI. Les peuples
qui folfient avec les lettres prononcent feulement
B.
La différence qu’il y a entre B fa 8c B mi eft
que le premier repréfente notre f i bémol, 8c le fe-
i cond notre f i naturel. La gamme de Guido n’étoit:
1 compofée que de fix notes, ut re mi fa fol la.
Voyez Gamme. Il n’y avoit point de note pour aller
rejoindre l’oétave, Ôc comme on folfipitpar muance
(voyez ce mot),on donnoitle nom de mi à toute note
qui n étoit féparée. de la note fnpérieure que par
un femi-ton , 8c le nom de fa à toute note qui
n’étoit féparée de la note inférieure que par un
femi ton ; ainfi le fon qui s’élevoit vers Put,
nommé mi çn folfiapt, étoit défigné par le nom
de b mi, 8c le même fon defcendant d’un feul femi.
ton , nommé fa enfolfiant, étoit b fa. Ces mots
difti liguent encore dans la modulation les tons de
f i naturel Scdefib mol. (AL Framery.)
B MOL ou B ÉM O L , ƒ, m. Caraélère de mu-
fique auquel on donne à-peu-près la figure d’un b ,
8c qui fait .abaiffer d’un femi-ton mineur la note
à laquelle il efl joint. Voyez Semi-Ton,
G u y d’Arrezzo ayant autrefois donné des noms
à fix des notes de l’oâave , defquelles il fit fon
célèbre Hexacorde, laiffa la feptième fans autre
nom que celui de la lettre B qui lpi efl propre,
comme le C à l’ut ; le D au re, 8cc. Or ce B fe chantoit
de deux manières"; favoir, à un ton âu-deffus
du la, félon l’ordre naturel de la gamme , ou feulement
à un femi-ton du même la , lorfqu’on vou-
Joit conjoindre les tétracordes ; car il n’étoit pas
encore queflion de nos modes ou tons modernes.
Dans le premier cas, le f i fonnarit affez durement,
à caufe des trois tons confécutifs, on jugea qu’il
faifoit à l’oreille un effet femblable à celui que les
corps anguleux 8c durs font à la main : c’efl pourquoi
on l’àppéila B dur ou B quarré , en italien B
quadro. Dans le fécond cas, au contraire, on trouva
que le f i étoit extrêmement doux ; c’efl pourquoi
on l’appella B mol ; par la même analogie on auroit
pu l’appeller auffi b rond, 8c en effet les Italiens le
nomment quelquefois B tondo.
Il y a deux manières d’employer le bémol; l’une
accidentelle, quand dans le cours du chant on le
place à la gauche d’une note. Cette note efl pref-
que toujours la note fenfible dans les tons majeurs,
.8c quelquefois la fixième note dans les tons mineurs
, quand la clef n’efl pas correélement armée.
Le bènibl accidentel n’altère que la note qu’il touche
8c celles qui la rebattent immédiatement, ou
tout au plus -, celles q u i, dans la même mefure, !
fe trouvent fur le même degré fans aucun figne
contraire.
L’autre manière efl d’employer le bémol à la clef,
8c alors il la modifie; il agit dans toute la fuite
de l’air 8c fur toutes les notes placées fur le même
degré, à moins que ce bémol ne foit détruit accidentellement
par quelque diéze ou béquarre, ou que la
clef ne vienne a changer.
La pofitiori des bémols à la- c le f n’efl pas arbitraire
; en voici la raifon. Ils font deflinés à changer
le lieu des femi-tons de l’écheiie : or ces deux
femi-tons doivent toujours garder entre eux des
intervalles preferits; favoir, celui d’une quarte d’un
côté, 8c celui d’une quinte de l’autre. Ainfi la
note mi inférieure de fon femi-ton fait au grave
la quinte du f i qui efl fon homologue dans l’autre
femi-ton, 8c à l’aigu la quarte du même f i , 8c réciproquement
la note f i fait au grave là quarte du mi,
8c à l’aigu la quinte du même mi.
Si donc lailfanr, pair exemple , le f i naturel, on
donnoit un bèn ol au m i, le femi-ton- changeroit de
lieu 8c fe trouveroit defeendu d’un degré entre le re
8c le rni bémol. O r , dans cette pofition, l’on voit que?
les deux femi-tons ne garderoient plus entre eux
' la diiiance preferite ; car le re, qui feroit la note;
inférieure de l’irn , feroit au grave la fixte diï f i
' fon homologue dans l’autre, 8c à l’aigu, la tierce!
du mêmè fi ; 8c ce fi feroit au grave la tierce du
!re, St k l’aigu, la fixte du même re. Ainfi les deux
femi-tons feroient trop voifins d’un côté 8c trop
éloignés de l’autre.
L ’ordre des bémols ne doit donc pas commencer
par ml, ni par aucune autre noie de l’oélaVe que par
f i , la feule qui n’a pas le meme inconvénient, car
bien que le femi-ton y change de place, 8c, cef-*
fant d’être entre le f i 8c Vue, defeende entre le f i
bémol 8c le la , toutefois l ’ordre ■ preferit n’eft
point détruit ; 1 e la , dans ce nouvel arrangement^
ie trouvant d’un côté à la quarte, 8c de l’autre
à la quinte du mi fon homologue , 8c réciproquement.
La même raifon qui fait placer le premier bémol
fur le f i , fait mettre le fécond fur le mi, & ainfi
de fuite, en montant de quarte ou defcendant
de quinte jufqu’au fo l , auquel on s’arrête ordinairement
, parce que le bémol de Put, qu’on
trouveroit enfuite, ne différé point du f i dans la
pratique. Cela fait donc une fuite de cinq bémols
dans cet ordre.
1 2 j 4 5
Si Mi La Re Sol,
Toujours, par la même raifon, l’on ne fauroit
employer les derniers bémols à la c le f, fans env
ployër auffi ceux qui les précèdent : ainfi le bémdl
du mi ne fe pofe qu’avec celui du f i , celui du la
qu’avec les deux précédens,- 8c chacun des fuivans
qu’avec tous ceux qui le précèdent.
On trouvera dans l’article c le f une formule pour
favoir tout d’un coup fi un ton ou un mode donné
doit porter des bémols à la c le f, 8c combien. (J. J.
R o u f eau. )
* Cette raifon, donnée par Rouffeau, pour prouver
que la pofition des bémols n’efi: pas arbitraire ,
efl bien embrouillée, bien abfiraite pour ceux à
qui le langage de la mufique n’efi: pas familier. Elle
contient d’ailleurs ce qu’on appelle une pétition cle
principes. « Les bémols , d i t - i l , font cîefiinés à
« changer le lieu des femi-tons de l’échelle ; or
>y ces deux femi-tons doivent toujours garder entre
» eux deux intervalles preferits ; favoir celui d’uiie
” quarte d’un côté,8c celui d’une quinte de l’autre. »
Mais pourquoi doivent-ils garder ces intervalles ?
C ’efi là ce qu’il falloir prouver/ D ’après quelle loi
nous affure t-on que la gamme ne potivoit pas
être diviféê cl’une autre manière qu’elle n e l’efi'?
Voici une autre explication qui nous paroît plus
fimple, plus claire , 8c fur-tout plus concluante.
La réfonnancë du corps fonere produit, comme
on fait fon oélave , fa quinte 80 fa tierce majeure.
L ’oéiàve étant la répétition du même fon
ne produit que les mêmes notes; ainfi on ne
’ trouveroit point par elle la divifion dé la gamme.
La quinte , au contraire, cet intervalle parfait,
produit à fon tour une autre quinte ; celle-ci une
troifième , 8c c’efi de cette fuite de quintes que
la gamme eft compofée.
Prenant donc la note fa pour généraîeur,elle vous
• donnera en montant la quinte ut ; lW/vous donnera
fo l ; le fol pfoduit ré-; le ré , la • le .la ,
le mi , f i ; mais la: quinte de. f i n’efi:’point
fa )I une quinte jufie contient trois tons ? ■ &• rn
femi-ton : 8c il ‘ ne trouve entre fi. 8c. fa que deux