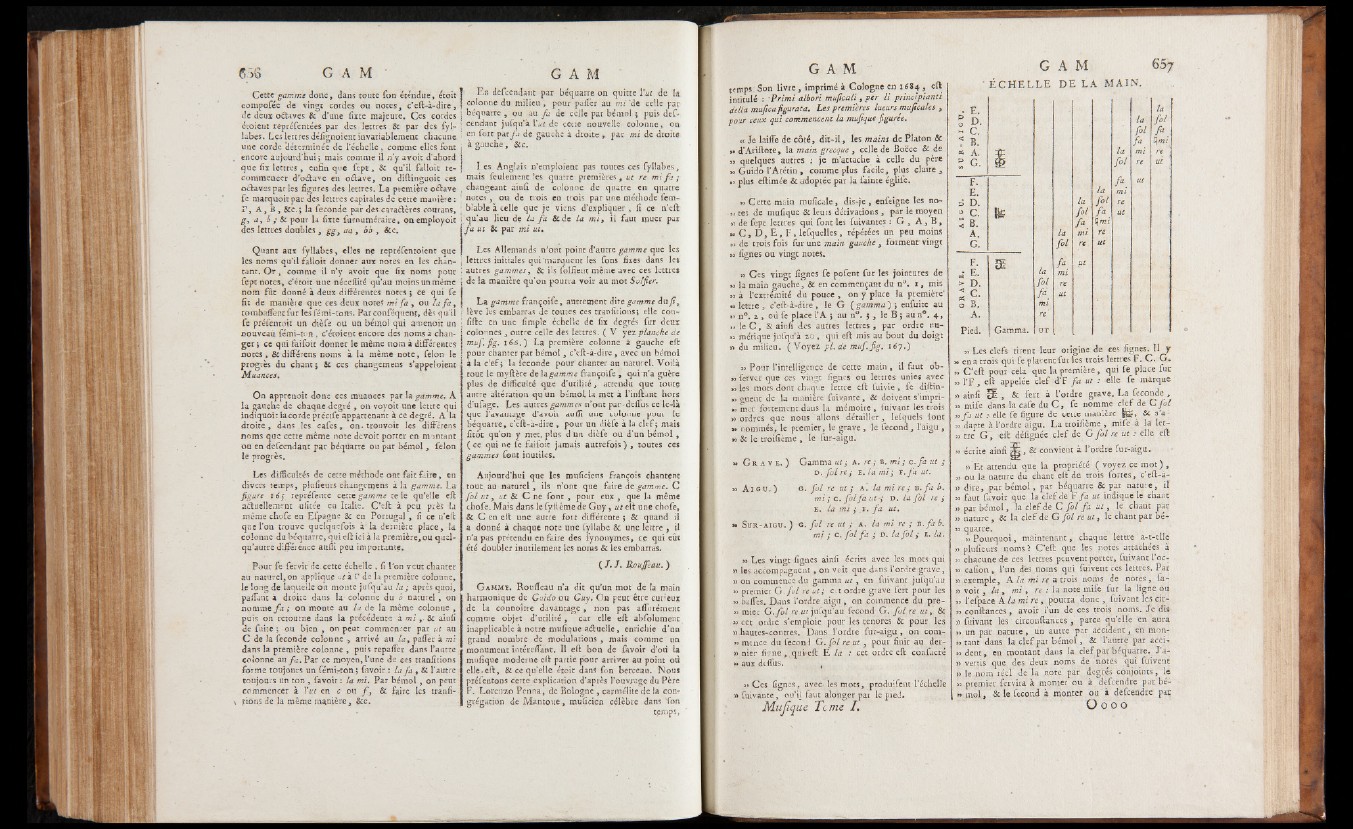
Cette gamme donc, dans toute Ton étendue, étoit
compofée de vingt cordes ou notes, c’eft-à-dire,
de deux odtaves & d’une fixte majeure. Ces cordes
étoient repréfentées par des lettres & par des fyl-
labes. Les lettres délîgnoient invariablement chacune
une corde déterminée de l'échelle , comme elles font
encore aujourd’hui; mais comme il n’y avoir d’abord
que fix lettres , enfin que fept , & qu’il falloit recommencer
d'oftave en o«ftave, on diftinguoit ces
o&avespar les figures des lettres. La première oélave
fe marquoitpar des lettres capitales de cette manière:
r , A , B , &c.; la fécondé par des caractères courans,
g, a, b y & pour la fixte furnuméraire, onemployoit
des lettres doubles , gg, aa » b b , &c.
Quant aux fyllabcs, elles ne repréfentoient que
les noms qu’il falloit donner aux notes en les chantant.
O r , comme il n’y avoir que fix noms pour
fept notes, c’étoit une néceffité qu’au moins un même
nom fût donné à deux différentes notes j ce qui fe
fit de manière que ces deux notes mi f a , ou la fa ,
tombnflentfur les fémi-tons. Par conféquent, dès qu’il
fe préfencoit un dièfe ou un bémol qui amenoit un
nouveau fémi-ton , e’étoient encore des noms à changer
} ce qui faifoit donner le même nom à différentes
notes, & différens noms à la même note, félon le
progrès du chant; & ces çhangemens s’appeloient
Muances,
On apprenait donc ces muances par la gamme, A
la gauche de chaque degré , on voyoit une lettre qui
indiquoit la corde précife appartenant à ce degré. A la
droite, dans les cafés , on • trou voit les différens
noms que cette même note devoir porter en montant
ou en descendant par béqüarre ou par bémol , félon
le progrès.
Les difficultés de cette méthode ont fait faire, en
divers temps, plufieurs çhangemens à la gamme. La
figure 1 6 y repréfente gamme te le qu’elle eft
actuellement ufïtée en Italie. C ’eft à peu près la
même chofe en Efpagne & en Portugal , fi ce n’eft
que l’on trouve quelquefois à'la dernière place, la
colonne du béqtiarre, qui eft ici à la première, ou quel-
qu’autre différence aufli peu importante.
Pour fe fervir de cette échelle , fi l’on veut chanter
au naturel, on applique ut'z r de la première colonne,
l.e long de laquelle on monte jufqu’au la ; après quoi,
paffant à droite dans la colonne du b naturel, on
nomme fa ; on monte au la de la même colonne ,
puis on retourne dans la précédente à mi ,. & ainfi
de fuite ; ou bien , on peut commencer par ut au
C de la fécondé colonne , arrivé au La, paflèr à mi
dans la première colonne , puis repaffer dans l’autre
colonne au fa . Par ce moyen, l’une de ces ttanfitions
forme toujours un fémirton j favoir : la f a , & l’autre
toujours un ton , favoir : la mi. Par bémol, on peut
commencer à Y ut en c ou ƒ , & faire les tranfi-
îions de la même manière, &c.
En defeendant par béquarre on quitte Yut de la
colonne du milieu , pour palier au mi *de celle pay
béquarre, ou au fa de celle par bémol ; puis def*
Cendant jufqu’à Yut de cette nouvelle colonne, on
en fort par fa de gauche à droite , par mi de droite
à gauche, &ç.
le s Anglais n’emploient pas toutes ces fyllabes,
mais feulement les quatre premières, ut re mi fa ;
changeant ainfi de colonne de quatre en quatre
notes, ou de trois en trois par une méthode fem^
blable à celle que je viens d’expliquer , fi ce n’eft
qu’au lieu de la fa &de la mi, il faut muer par
fa ut & par mi ut.
Les Allemands n’ont point d’autre gamme que les
lettres initiales qui marquent les fons fixes dans les
autres gammes, & ils lolfient même avec ces lettres
de la manière qu’on pourra voir au mot Solfier.
La gamme françoife, autrement dire gamme du fi,
lève les embarras de toutes ces tranficions; elle con-r
fifte en une fîmple échelle de fix degrés fur deux
colonnes , outre celle des lettres. ( V yez planche de
muffig. 166.) La première colonne à gauche eft
pour chanter par bémol , c’cft-à-dire , avec un bémol
à la clef; la fécondé pouf chanter au naturel. Voilà
tout le myftère de \z gamme françoife , qui n’a guère
plus de difficulté que d’utilité, attendu que toutç
antre altération qu un bémol la met à l’inftant hors
d’ufage. Les autres gammes n’ont par-deflus ceile-là
que l’avantage d’avoir auffi une colonne pour le
béquarre, c’cft-à-dire , pour un dièfe à la clef; mais
fitôt qu’on y mec. plus d'un dièfe ou d’un bémol ,
( ce qui ne fe faifoit jamais autrefois ) , toutes ces
gammes font inutiles.
Aujourd’hui que les muficiens françois chantenç
tout au naturel, ils n’ont que faire de.gamme. Ç
fo l ut, ut & C ne font , pour eux , que la même
chofe. Mais dans le fyllême de G uy, ut eft une chofe,
& C en eft une autre fort différente ; & quand il
a donné à chaque noyé une fyllabe & une lettre , il
n’a pas prétendu en faire des fynonymes, ce qui eût
été doubler inutilement les noms & les embarras.
( J. J. Roujfeau. )
G amme. Roufléau n’a dit. qu’un mot de la main
harmonique de Guido ou Guy. On peut être curieux
de la connoître davantage, non pas affurémenc
comme objet d’utilité, car elle eft abfolument
inapplicable à notre mufique a&uelle, enrichie d’un
grand nombre de modulations , mais comme un
monument intéreffant. Il eft bon de là voir d’ou la
mufique moderne eft partie pour arriver au point où
elle-cft, & ce qu’elle étoit dan$ fon berceau. Nous
préfentons cette explication d’après l’ouvrage du Père
F. Lorenzo Penna, de Bologne , carmélite de la congrégation
de Mantoue, muûcien célèbre dans 'fon
tpmps,
temps- Son livre, imprimé à.Cologne en 1684, eft
intitulé : Primi albori muficali, per l i principianti
délia mufica figurata. Les premières lueurs muficales ,
pour ceux qui commencent la mufique figurée.
« Je laiffe de côté, dit-il, les mains de Platon &
» d’Ariftote, la main grecque , celle de Boëce & de
» quelques autres : je m’attache à celle du père
»» Guido I’Arétin , comme plus facile, plus claire ,
»> plus eftimée & adoptée par la faince égliie.
» Cette main muficale, dis-je , enfeigne les no-
») tes de mufique & leurs dérivations , par le moyen
» de fept lettres qui font les fuivantes : G , A , B ,
» C , D , E , F , iefquelles, répétées un peu moins
m de trois fois fur une main gauche , forment vingt
m lignes ou vingt notes.
» Ces vingt lignes fe pofent fur les jointures de
» la main gauche, & en commençant du n°. 1 , mis
as à l’extrémité du pouce , on y place la première'
•« lettre , c’eft-à-dire , le G ( gamma ) ; enfuite au
» n°. z , où fe place l’A j au n°. 5 , le B ; aun°. 4,
» le C , & ainn des autres lettres , par ordre nu-
*s mérique jufqu’à z o , qui eft mis au bout du doigt
» du milieu. (V oy e z p l.d e m u ffig . 167.) *
»s Pour l’intelligence de cette main , il faut ob-
»3 ferver que ces vingt lignes ou lettres unies avec
>3 les mots dont chaque lettre eft fuivie, fe diftin-
»3 «ment de la manière fuiyanre, & doivent s’impri-
»3 mer fortement, dans la mémoire, fuivant les-trois
» ordres que nous allons détailler, lefquels font
*» nommés, le premier, le grave , le fécond, l’aigu ,
»3 & le troisième , le fur-aigu.
>» G r a v e . ) Gamma ut ; a . re; b. mi; c .fa ut ;
d. fo l re; e. la m i; F. fa ut.
»3 A i g u . ) g. fo l re ut ; a . la mi re y b . fa b.
mi ; c. fo l fa ut-; d. la fo l re ;
E. la mi ; F. f a ut.
m S u r - a ï g u . ) G. fo l re ut j a . la mi re ; B. fa b.
mi ; c. fo l fa ; d. la f o l ; e . la.
»3 Les vingt lignes ainfi écrits avec les mots qui
» les accompagnent, on voit que dans l’ordre grave,
» on commence du gamma ut , en fuivant jufqu’au
33 premier G fo l re ut; c.t ordre grave fert pour les
»3 baffes. Dans l’ordre aigu , 011 commence du pre-
33 miec G. fo l re ut jufqu'au fécond G. fo l re u t, &
» cet ordre s’ emploie pour les tenores & pour les
»hautes-contres. Dans l’ordre fur-aigu, on com-
» mence du fécond G. fol re ut , pour finir au der-
» nier fisne, quif eft Ë la : cet ordre eft confacré
»• aux dtffus. #
3* Ces lignes, avec-les mots, produifein l’échelle
» fuivante, ou’il faut alonger par le pied.
Mujique Te me L
G A M 667
’ É C H E L L E D E L A M A IN .
E. la
D. la .fii
« C. fol f a
< B. fi Êj mi
ai A. -rr la mi re
£> G. i f i i re ut
F. fi ut
E. la mi
D D. la f i i re
O C. te f i i î a ut
B. fi \mi
A. la mi re
G. fol re ut
F. m f a ut
la
E. mi
> D. fol re
< C . f i . ut
O B. mi
A. re
Pied. Gamma. UT
33 Les clefs tirent leur origine de ces lignes. Il y
3# en a trois qui fe placent fur les trois lettres F. C . G .
33 C ’eft pour cela que la première, qui fe place fur
35 l’F , eft appelée clef d’ F fa ut : elle fe marque
» ainfi tïE , & fert à l’ordre grave. La fécondé ,
33 mile dans la cafe du C , fe nomme clef de C fo l
53 fa ut :■ elle fe figure de cette manière j f c , & s’a-
33, dapte à l’ordre aigu. La troilième , mife à la let-
33 tre G , eft défignée clef de G fo l re ut : elle eft
33 écrite ainfi ^ , & convient à l’ordre fur-aigu.
» Et attendu que la propriété ( voyez ce mot) ,
53 ou la nature du chant eft de trois fortes , c’eft-à-
» dire, par bémol, par béquarre & par nature, il
33 faut favoir que la clef de F fa ut indique le chant
» par bémol, la clef de C f o l fa u t, le chant par
» nature , & la clef de G fo l re ut, le chant par bé-
33 quarre.
» Pourquoi, maintenant, chaque lettre a-t-elle
» plufieurs noms? C ’eft que les notes attachées à
33 chacune de ces lettres peuvent porter, fuivant l’oc-
»3 cafîon, l’un dés noms qui fuivent ces lettres. Par
» exemple, A la mi re a trois, noms de notés, la-
» voir , l a , mi , re : la note mife fur la ligne ou
33 l’efpace A la mi re , pourra donc , fuivant les cir-
33 conftances, avoir l’un de ces trois noms. Je dis
» fuivant les circonftances , parce qu’elle en aura
33 un par nature, un autre par accident, en mon-
3» tant dans la clef par bémol, & l’autre par acci-
33 dent, en montant dans la clef par béquarre. J’.i-
» vertis que des deux noms de notes qui fuivent
» le nom réel de la note' par degrés conjoints, le
U premier fervira à monter ou à defeendre par bé-
>» moL & le fécond à monter ou à defeendre par
O 0 0 O