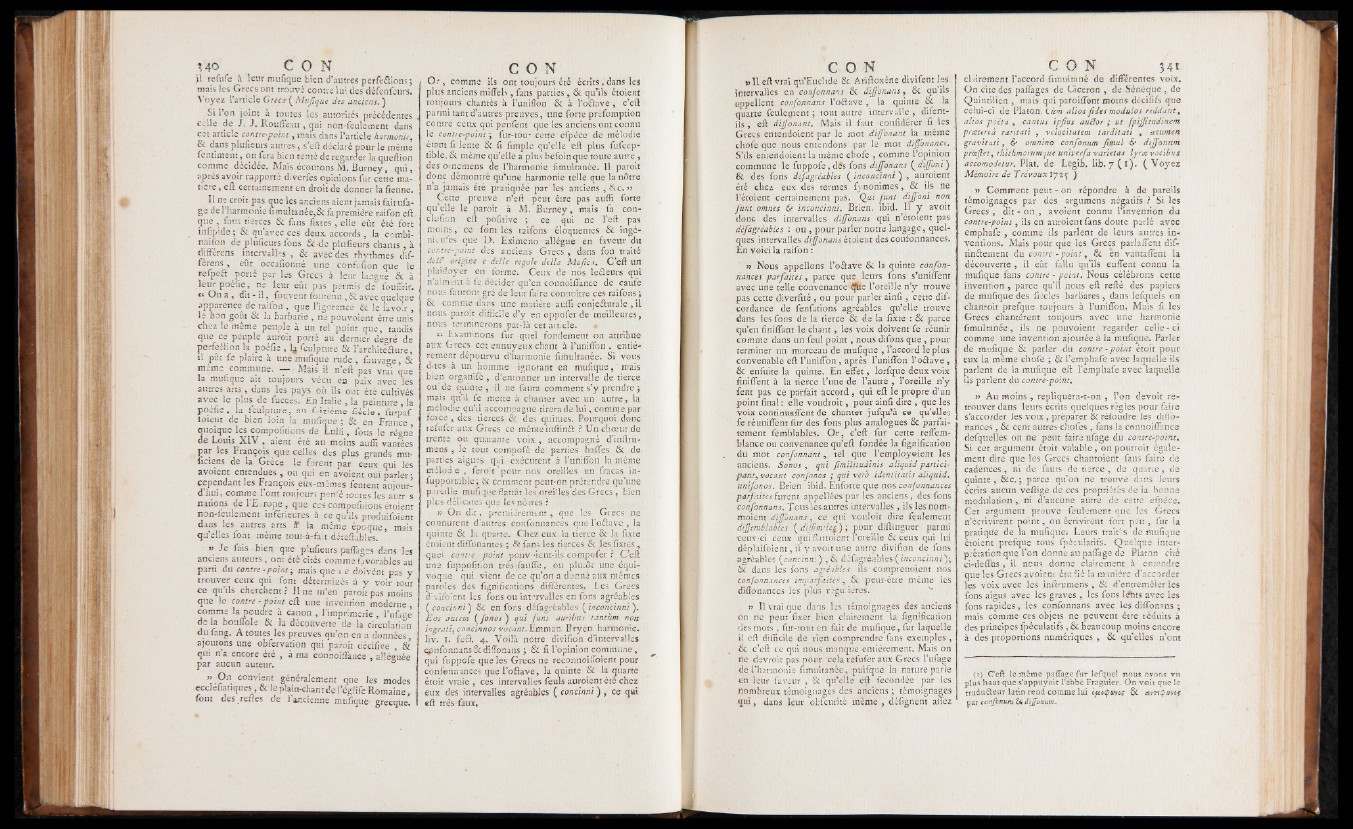
}\ refufe à leur mufique bien d’autres perfeéfions ;
mais les Grecs ont trouvé contre lui des défendeurs.
Voyez l’article Grecs* ( Mufique des anciens. )
Si l’on joint a toutes les autorités précédentes
celle de J. J. Roufteau , qui non-feulement dans
cet article contre-point , mais dans l’article harmonie,
Sc dans plufieurs autres, S’eft déclaré pour le même
fentiment, on fera bien tenté de regarder la queftion
comme décidée. Mais écoutons M. Burney, qui,
après avoir rapporte diverfes opinions fur cette matière
, eft certainement en droit de donner la Benne.
Il ne croit pas que les anciens aient jamais fairufa-
ge de l’harmonie fimultanée,& fa première raifon eft,
que , fans tierces & fans Bxtes , elle eût été fort
irifipide ; & qu’avec ces deux, accords , la combi-
c^e plufieurs fons &=de plufieurs chants , à
différens intervalles , & avec des rhythmes dif-
férens, eut occafionné une confufion que le
refpea porté par les Grecs à leur langue & à
leur poéfie, ne leur eût pas permis de^ fouffrir.
“ O n a » dit - i l , fouVent fourenu, & avec quelque
apparence de raifon , que l’igorance & le lavoir ,
le bon goût & la barbarie , ne pouvaient être unis
chez le meme peuple a un tel point que, tandis
que ce peuplé auroit porté au dernier degré de
perfe&ion la poéfie , la fculpture & l ’architefture,
il pût fe plaire à une mufique rude, fauvage, &
même commune. — , Mais il n’eft pas vrai que
la mufique ait toujours vécu en paix avec les
autres arts , dans les pays ou ils ont été cultivés
avec le plus de fuccés. £n Italie , la peinture , la
poéfie, la fculpture, au feizième fiècle, furpaf-
ioient de bien loin la mufique ; & en France,
quoique les compofitions de L u lli, fous le règne
de Louis X I V , aient été au moins aulîi vantées
par les François que celles des plus grands mu-
liciens de la Grèce le furent par ceux qui les
avoient entendues , ou qui en avoient ouï parler ;
cependant les François eux-mêmes fentent aujourd’hui,
comme l’ont toujours penfë toutes les autr s
nations de 1 Europe , que ces compofiiions étoient
non-feulement inférieures à ce qu’ils produisent
dans les autres ans & la meme époque, mais
qu’elles font même tout-à-falt déteftables.
» Je fais bien que plufieurs paffages dans les
anciens auteurs , ont été cités comme favorables au
parti du contre-point ; mais qus t e doivent pas y
trouver ceux qui font déterminés à y voir tout
ce qu ils cherchent ? Il ne m'en paroit pas moins
que le contre-point eft une invention moderne,
comme la poudre à canon , l'imprimerie , l ’ufage
de la bouffole & la decouverte de la circulation
du fang. A tomes les preuves qu’on en a données,
ajoutons une obfervation qui paroit décifive , &
qui n a encore ete , a ma connoiftance , alléguée
par aucun auteur. °
” On convient généralement que les modes :
eccléfiatiques, & leplain-ebantdel’églifeRomaine,
font des refies de l’ancienne mufique grecqiie.
O r, comme ils ont toujours été écrits, dans les
plus anciens mi (Tels, fans parties & qu’ils étoient
toujours chantés à l’unifion & à l’oiftave , c’eft
parmi tant d’autres preuves., une forte préfomption
contre ceux qui penfent que les anciens ont connu
le contre-point ; fur-tou*- cette efpêce de mélodie
étant fi lente & fi fimple qu’elle eft plus fufeep-
tible, & même qu’elle a plus befoinque toute autre ,
des omemens de l’harmonie fimultanée. 11 paroit
donc démontré qu’une harmonie telle que la nôtre
n’a jamais été pratiquée par les anciens , &c. »
Cette preuve n’eft peut être pas aufli forte
qu’elle le paroit à M. Burney , mais fa con-
clufion eft pofitive ; ce qui ne l’eft pas
moins, ce font les raifons éloquentes & ingénie
u'es que D. Eximeno allègue en faveur du
contre-point des anciens Grecs , dans fon traité
deir origine e délie r ego le délia Mujica. C ’eft un
plaidoyer en forme. Ceux de nos leéreurs qui
n'a;ment à fe décider qu’en connoiftance de caufe
nous faurom gré de leur faire connoître ces raifons ;
oc comme dans une matière aufli conje&urale , il
nous paroit difficile d’y en oppofer de meilleures,
nous terminerons par-là cet article.
6C Examinons fur quel fondement on attribue
aux Grecs cet ennuyeux chant à l’uniflon , entièrement
dépourvu d’harmonie fimultanée. Si vous
dites^à un homme ignorant en muf iquemai s
bien organifé, d’entonner un intervalle de tierce
ou de quinte , il ne faura comment s’y prendre ;
mais qu’il fe mette à chanter avec un autre, la
mélodie qu’il accompagne tirera de lu i, comme par
force , des tierces & des quintes. Pourquoi donc
refufer aux Grecs ce même inftinâ: ? Un choeur de
trente ou quarante voix , accompagné d’inftru-
mens , le tout compofé de parties baffes & de
parties aigues qui exécutent à l’unifîcn la même
mélod e , feroit pour nos oreilles un fracas in-
fupportable; & comment peut-on prétendre quTune
pareille mufique flattât les orei’les des Grecs , bien
plus délicates que les nôtres ?
» On d it, premièrement, que les Grecs ne
connurent d’autres confonuances que l’oélave , la
quinte 8c la quarte. Chez eux la tierce 8c la fixte
étoient diffonantes ; & fians les tierces 8c les fixres,
quel contre - point pouvaient-ils compofer ? C ’eft
une fuppofition très-fauffe, ou plutôt une équivoque
qui vient de ce qu’on a donné aux mêmes
paroles des bonifications différentes^ Les Grecs
dlvifoient les ions ou intervalles en fons agréables
( concinni ) 8c en fons défagréables ( inconcinni ).
Eos autan (fonos^ qui funt auribus tantum non
ingrati, concinnos vocant. Emman. Bryen. harmonie,
liv. i. fecl. 4. Voilà notre divifion d’intervalles
confonnans8cdiffonans ; 8c fi l ’opinion commune,
qui fuppofe que les Grecs ne reconnoiffoient pour
confonnances que l’oftave, la quinte 8c la quarte
étoit vraie , ces intervalles feuls auroient été chez
eux des intervalles agréables ( concinni ) ^ ce qui
eft très-faux.
»11 eft vrai qu’Euclide 8c Ariftoxène divifent les
intervalles en confonnans 8c dijfonans, 8c qu ils
•appellent, confonnans l’oâave , la quinte 8c la
quarte feuleçient ; tout autre intervalle , difent-
i l s , eft dijfonant. Mais il faut confidérer fi les
Grecs entendoient par le mot diffonant la même
chofe que nous entendons par le mot dijfonance.
S’ils eniendoient la même chofe , comme l’opinion
commune le fuppofe, dés fons dijfonans ( dijfoni')
& des fons défagréables ( inconcinni ) , auroient
été chez eux des termes fynonimes, 8c ils ne
l’étoient certainement pas. Qui funt dijfoni non
funt omnes & inconcinni. Brien, ibid. Il y avoit
donc des intervalles dijfonans qui n’étoient pas
défagréables : ou , pour parler notre langage, quelques
intervalles dijfonans étoient des confonnances.
En voici la raifon :
» Nous appelions l’o&ave 8c la quinte confonnances
parfaites, parce que leurs fons s’uniffent
avec une telle convenance efiie l’oreille n’y trouve
pas cette diverfité , ou pour parler ainfi , cette discordance
de fenfations agréables qu’elle trouve
dans les fons de la tierce 8c de la fixte : 8c parce
qu’en finifîant le chant, les voix doivent fe réunir
comme dans un feul point, nous difons que , pour
terminer un morceau de mufique , l’accord le plus
convenable eft l’uniflbn, après l’uniflbn l’oftave ,
8c enfuite la quinte. En effet, lorfque deux voix
finiflent à la tierce l’une de l’autre , l’oreille n’y
fent pas ce parfait accord, qui eft le propre d’un
point final : elle voudroit, pour ainfi dire , que les
voix continuaient de chanter jufqu’à ce qu’elles
fe réunifient fur des fons plus analogues 8c parfaitement
femblables. O r , c’eft fur cette reflem-
blance ou convenance qu’eft fondée la lignification
du mot confonnant, tel que l’employoient les
anciens. Sonos , qui fimilitudinis aliquid participant,
vocant confonos ; qui ver b identitatis aliquid.
unijbnos. Brien ibid. Enforte que nos confonnances
parfaites furent appellées par les anciens , des fons
confonnans. Tous les autres intervalles , ils les nom-
moient dijfonans, ce qui voitloit dire feulement
dijjemblables ( dïjfîmde^ ) ; pour diftinguer parmi
ceux-ci ceux qui flattoient l’oreille 8c ceux qui lui
déplaifoient, il y avoit une autre divifion de fons
agréables ( concinni) , 8c défagréables (inconcinni);
8c dans les fons agréables ils comprenoient nos
confonnances imparfaites , 8c peut-être même les
difïonances les plus régu ières.
» Il vrai que dans les témoignages des anciens
on ne peut fixer bien clairement la fignificarion
des mots , fur-tout en fait de mufique, fur laquelle
il eft difficile de rien comprendre fans exemples ,
8c c’eft ce qui nous manque entièrement. Mais on
ne devroit pas pour cela refufer aux Grecs l’ufage
de rhannonïe fimultanée, puifque la nature parle
en leur faveur , 8c qu’elle eft fécondée par les
nombreux témoignages des anciens ; témoignages-
q u i, dans leur obfcurité même , défignent aflez
C O N 3 41
clairement l’accord fimultané de différentes voix.
On cite des paffages de Cicéron , de Sénèque , de
Quintilien , mais qui paroiffent moins décififs que
celui-ci de Platon. Cum altos Jides rnodulos reddant,
altos poëta , cantus ipjius auElor ; ut fpijfitudinem
prattereà raritati , vclocïtatem tarditati , acuinen
gravitait, 6* omnino confonum Jimul 6* dijfonum
prccflet, rhithmorumque univerfa vahetas lymvocibus
accomodetur. Plat, de Legib. lib. 7 ( 1 ) . (V o y e z
Mémoire de Trévoux Ij2<: )
» Comment peut - on répondre à de pareils
témoignages par des argumens négatifs ? Si les
Grecs , dit - on,, avoient connu l’invention du
contre-point, ils en auroient fans doute parlé avec
emphafe , comme ils parlent de leurs autres inventions.
Mais pour que les Grecs parlaflent dif-
tin&ement du contre - point, & en vantaffent la
découverte , il eût fallu qu’ils euffent connu la
mufique fans contre - point. Nous célébrons cette
invention , parce qu’il .nous eft refté des papiers
de mufique des fiècles barbares, dans lefquels on
chantoit prefque toujours à Puniffon, Mais fi les
Grecs chantèrent toujours avec une harmonie
fimultanée, ils ne pouvoient regarder c e lle -c i
comme une invention ajoutée à la mufique. Parler
de mufique & parler du contre -point étoit pour
eux la même chofe ; & l’emphafe avec laquelle ils
parlent de la mufique eft l’emphafe avec laquelle
ils parlent du contre-point.
n Au moins , repliquera-t-on , l’on devoit retrouver
dans leurs écrits quelques règles pour faire
s’accorder les v o ix , préparer & réfoudre les diffo-
nances, & cent autres chofes , fans la connoiftance
defquelles on ne peut faire ufage du contre-point.
Si cet argument étoit valable , on pourroit également
dire que les Grecs chantoient fans faire de
cadences , ni de fauts de tierce , de quarte, de
quinte , &c. ; parce qu’on ne trouve dans leurs
écrits aucun veftige de ces propriétés de la bonne
modulation ,. ni d’aucune autre de cette efpëce.
Cet argument prouve feulement que les Grecs
n’écrivirent point, ou écrivirent fort peu , fur la
pratique de la mufique. Leurs traitas de mufique
étoient prefque tous fpéculatifs. Quelque interprétation
que l’on donne au paffage de Platon cité
ci-deffhs , il nous donne clairement à entendre
que les Grecs avoient étudié la manière d’accorder
le? voix avec les inftrumens , & d’entremêler les
fons aigus avec les graves , les fons lèhts avec les
fons rapides , les confonnans avec les diffonans ;
mais comme ces objets ne peuvent être réduits à
des principes fpéculatifs , & beaucoup moins encore
à des proportions numériques , & qu’elles n’ont
(r) C’eft le même paffage fur lefquel nous avons vu
plus haut que s’appuyoit l’abbé Fraguier. On voit que le
tradu&eur latin rend comme lui ôftotpwyos 8i ayrftpmos
par confonum 8i dijfonum.