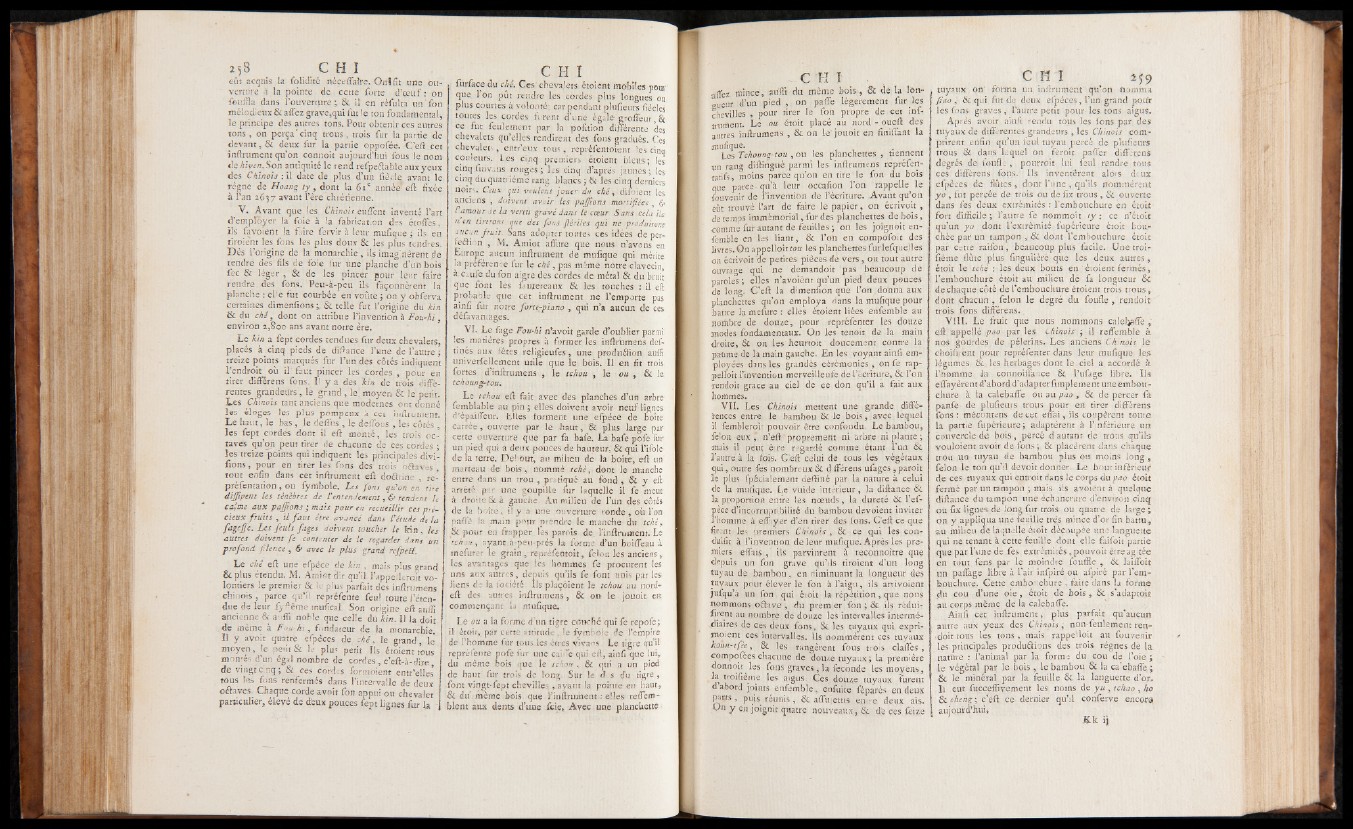
258 C H I
eût acquis la folidité néceffaîre. Oriîfit une ouverture
.i la pointe de cette forte d’çeuf : on
fouilla dans l ’ouverture; & il en réfulta un fon
mélodieux & affez grave,qui fut le ton fondamental,
le principe des autres tons. Pour obtenir ces autres
tons , on perça 'cinq trous, trois fur la partie de
devant, & deux fur la partie oppoféë. C ’eft cet
inflrument qu’on connoit aujourd’hui fous le nom
de hiven. Son antiquité le rend refpeflable aux yeux
des Chinois : il date de plus d’un Cède avant le
règne de Hoang ty , dont la 61e année* eft fixée
à l’an 2637 avant l’ère chrétienne.
V . Avant que les Chinois ouilent inventé l’art
d’employer la foie à la fabrication des étoffes,
ils favoient la faire fervir à leur mufiqtie ; ils en
Croient les fons les plus doux & les plus tendres.
Dès l’origine de la monarchie , ils imaginèrent de
tendre des fils de foie fur une planche d’un bois
fec & léger , & de les pincer pour leur faire
rendre, des fons. Peu-à-peu ils façonnèrent la
planche : ePe fut courbée en voûte ; on y obferva
certaines dimenfions & telle fut l’origine du kin
& du chê, dont on attribue l ’invention à Fou-hi,
environ 2,800 ans avant notre ère.
Le kin a fept cordes tendues fur deux chevalets,
placés à cinq pieds de diftance l’une de l’autre ;
treize points marqués fur l’un des côtés indiquent
l ’endroit où il faut pincer les cordes , pour en
tirer différens fons. I! y a des kin de trois différentes
grandeurs, lé grand, le. moyen & le petit.
Les Chinois tant anciens que modernes ont donné
les éloges les plus pompeux à. cet inftrument.
Le haut, le bas, lé defftts , le deffous , les côtés
les fept cordes dont il eft monté, les trois octaves
qu’on peut tirer rie chacune de ces cordes ;
les treize points qui indiquent les principales divi-
fions, pour en tirer les fons des trois oélaves
tout enfin dans cet inftrument eft doârine re-
préfentation, ou fymbole. Les fons qu'on en tire
dijjipent Us ténèbres de l'entendement, & rendent le
calme aux pajjtons ; mais pour en recueillir ces précieux
fruits , il faut être avancé dans l'étude de la
ftgejfe. Les feuls fages doivent toucher le kin , les
autres doivent fe contenter de le regarder dans un
profond filence , & avec le plus grand refpeCl.
Le chê eft une efpëce de kin , mais plus grand
& plus étendu. M. Amist dit qu’il, l’appellerqît volontiers
le premier & le plus parfait des inftrumens
chinois , parce qu’il repréfente feu! toute l’étendue
de leur fyftême tnufical. Son origine eft auflî
ancienne & suffi noble que celle du kin. 11 la doit
de meme a Fou-hi, fondateur de la monarchie.
Il y avoit quatre efpèces de chê, le grand, le
moyen, le petit & le plus petit Ils étoient tous
montés d’un égal nombre de cordes, c’eft-à-dire,
de vingt cinq ; Sc ces cordes formoient entr’eiles
tous tes fons renfermés dans l ’intervalle de deux
oâaves. Chaque corde avoit fort appui ou chevalet
particulier, élevé de deux pouces fept lignes fur la
C H I
furface du chê. Ces chevajets étoient mobiles pour
que l’on put rendre les cordes plus longues ou
plus courtes à volonté; car pendant plufieurs fiècles
toutes les cordes furent d’une égale groffeur, 8c
ce fut feulement par la pofition différente des
chevajets qu’elles rendirent des fons gradués. Ces
chevalets, entr’eux tous, repréfentoient les cinq
couleurs. Les cinq premiers étoient bleus; les
cinq.fuivans rouges; les cinq d’après jaunes; les
cinq du quatrième rang blancs ; & les cinq derniers
noir».. Ceux qui veulent jouer du chê, diloient les
anciens , doivent avoir les pajjions mortifiées &
l amour de la vertu gravé dans le coeur Sans cela ils.
n en tireront que des fons ftériies qui ne produiront
iucun fruit. Sans adopter toutes ces idées de per-
reéfion , M. Amiot afliire que nous n’avons en
Europe aucun inftrument de mufique qui mérite,
la préférence lur le chê, pas même notre clavecin,
à caufe du fon aigre des cordes de métal & du bruit
que font les f.iufereaux & les touches : il eft
probable que cet inftrument ne l’emporte pas
ainfi fur notre forte-piano , qui n’a aucun de ces
défavantages.
Vï. Le fage Fou-hi n’a voit garde d’oublier parmi
les matières propres à former les inftrumens def-
tines aux fêtes religieufes, une produéfion auflî
univerfellement utile que le bois. Il en fit trois
fortes d’inftrumens , le tchou , le ou , & le
tchoung-tou.
Le tchou eft fait avec des planches d’un arbre
femblable au pin; elles doivent avoir neuf lignes
d’épaifleur. Elles forment une efpèce de boîte
carrée , ouverte par le .haut, & plus large par
cette ouverture que par fa bafe. La bafe pofe fur
un pied qui a deux pouces de hauteur, & qui l’ifole
de la terre. Debout, au milieu de la boîte, eft uni
marteau de bois , nommé tchè, dont le manche
entre dans un trou , prstiqué au fon d , & y eft
arrêté par une goupille fur laquelle il fe meut
à droite & à gauche. Au milieu de l’un des côtés I
de la boîte, il y a une ouverture ronde, où l’on
paflê la main pour prendre le manche du tchè,
& pour en frapper les parois de. l'infiniment. Le
tchou , ayant à-peu-près la forme d’un boiffeau à
inefurer le grain, repréfentoit, félon les anciens J
les avantages que les hommes fe procurent les
uns aux autres, depuis qu’ils fe font unis par les
liens de la fociété Ils plaçôient le tchou au nord-
eft des autres inftrumens, & on- le jouoit en
commençant la mufique.
Le ou a la forme d’un tigre couclîê qui fe repofe;
il étoir, par cette attitude, le fymbole de l’empire
de l’homme fur tous les êtres viyans Le tigre qu’il
repréfente pofe fur une eaiffe qui eft, ainfi que lui,,
du même bois que le tchou , & qui a un pied
de haut fur trois de long. Sur le dos du tigre ,
font vingt-fept chevilles, ayant la pointe en haut»
& du même bois que l’inftrument : elles reflem-
blent aux dents d’une fcie* Avec une planchette
C FI 1
iffez mince, aufîi du même bois-, Si de la tond
eu r d’un pied , . on pafte légèrement fur les
chevilles , pour tirer le fon propre de cet infiniment.
Le ou étoit placé au nord - oueft des
autres inftrumens , & on le jouoit en finifiant la
mufique.
Les Tchoung-tou , ou les planchettes , tiennent
un rang diftingué parmi les inftrumens repréfen-
tatifs, moins parce qu’on en tire le fon du bois
que parce qu’à leur occafion l’on rappelle le
fouvenir de l’invention de l’écriture. Avant qu’on
eût trouvé l’art de faire le papier, on écrivoit,
de temps immémorial, fur des planchettes de bois,
comme fub autant de feuilles ; on les joignoit en-
femble en les liant, & l’on en compofoit des
livres. On appelloitrow les planchettes furlefquelles
on écrivoit de petites pièces de vers, ou tout autre
ouvrage qui ne demandoit pas beaucoup de
paroles ; elles n’avoiènr qu’un pied deux pouces
de long. C ’eft la dimenfion que l’on donna aux
planchettes qu’on employa dans la mufique pour
battre la mefure : elles étoient liées enfemble au
nombre de douze, pour repréfenter les douze
modes fondamentaux. On les tenoit de la main
droite, & on les heur toit doucement contre la
patime de la main gauche. En les voyant ainfi employées
dans les grandes cérémonies , on fe rap-
pdloit finvention merveilleufe de l’écriture, & l’on
rendoit grâce au ciel de ce don qu’il a fait aux
hommes.
VII. Les Chinois mettent une grande différences
entre le bambou & le bois, avec lequel
il fembleroir pouvoir être confondu. Le bambou,
félon eux j, n’eft proprement ni arbre ni plante;
mais il peut ê;re regardé comme étant l’un &
l ’autre, à la fois. C ’eft celui de tous les végétaux
qui, outre fes nombreux &. d fférens ufages , paroît
le plus fpécialement deftiné par la nature à celui
de la mufique. Le vuide intérieur, la diftance &
la proportion entre les noeuds, la dureté & l’efpèce
d’incorruptibilité du bambou dévoient inviter
l’homme à effiyer d’en tirer des fons. C’eft ce que
firent les premiers Chinois , & ce qui les con-
duifit à l’invention de leur mufique. Après les premiers
efiais , ils parvinrent à reconnoître que
depuis un fon grave qu’ ils tiroient d’un long
tuyau de bambou. en diminuant la longueur des
tuyaux pour élever le fon à l’aigu, ils arrivoient
jufqu’à un fon qui étoit la répétition, que nous
nommons oftave , du prem.er fon ; & ils rédui-
firent au nombre de douze les intervalles intermédiaires
de ces deux fons, & les tuyaux qui exprimaient
ces intervalles. Ils nommèrent ces tuyaux
koun-tfèe, & les rangèrent fous trois claffes ,
compofées chacune de doiue tuyaux; la première
donnoir les fons graves , la fécondé les moyens,
la troifième les aigus. Ces douze tuyaux furent
d abord joints^ enfemble, enfuite féparés en deux
paçts, puis réunis, & affifettis .entre deux ais.
Un y en joignit quatre nouveaux 16c de ces feize
C H I if9
tuyaux on‘ forma un infiniment qu’on nomma
f/ao , & qui fut de deux efpèces, l’un grand pour
les fons graves , l’autre petit pour les tons aigus.
Après avoir ainfi rendu tous les fons par des
tuyaux de différentes grandeurs , les Chinois comprirent
enfin qu’un feul tuyau percé de plufieurs
trous & dans lequel on feroit paffer différens
degrés deiffoufle, pourroit lui feul rendre tous
ces différens fons. Ils inventèrent alors deux
efpèces de flûtes, dont l’ une , qu’ils nommèrent
yo , fut percée de trois ou de fix trous , & ouverte
dans fes deux extrémités .* l'embouchure en étoit
fort difficile ; l’autre fe nommoit ty : ce n’étoit
qu’un yo dont l ’extrémité fupérieure étoit bouchée
par un tampon , & dont l’embouchure étoit
par cette raifon, beaucoup plus facile. Une troifième
flûte plus fingulièré que les deux autres,
étoit le tchè : les deux bouts en étoient fermés,
l’embouchure étoit au milieu de fa longueur &
de chaque, côté de l’embouchure étoient trois trous,
dont chacun , félon le degré du foufle , rendoit
trois fons différens.
VIII. Le fruit que nous nommons calera fie
eft iappellé pao par les Chinois y\\ reffemble à
nos rgoürdes de pèlerins. Les anciens Chinois le
choifirent pour repréfenter dans leur mufique les
légumes 6c les herbages dont le ciel a accordé à
l’homme la connoifiar.ee & l’ufage libre. Ils
effayèrent d’abord d’adapter Amplement une embouchure
à la calebafle ou au pao , 6c de percer fa
panfe de plufieurs trous pour en tirer différens
Ions : mécontens de cet effai, ils coupèrent toute
la partie fupérieure; adaptèrent à l’inférieure un
couvercle de bois, percé d autant de trous qu’ils
vouloient avoir de fons ; & placèrent dans chaque
trou un tuyau de bambou plus ou moins lon g,
félon le ton qu’il devoir donner. Le bout inférieur
de ces tuyaux qui entroit dans le corps du pao étoit
fermé par un tampon ; mais iis avoiént à quelque
diftance du tampon une échancrure d’environ cinq
où fix lignes de long fur trois ou quatre de large;
on y appliqua une feuille très mince d’or fin battu,
au milieu de laquelle étoit découpée une languette
qui ne tenant à cette feuille dont elle faifoit partie
que par l’une de fes extrémités , pouvoit être agitée
en tout feras par le moindre fouffle , & laiffoit
un paffage libre à l’air infpiré ou afpiré par l’embouchure.
Cette embouchure . faite dans la forme
du cou d’une o ie , étoit de b ois , 6c s’adaptoit
au corps même de la calebafle.
Ainfi cet inftrument, plus parfait qu’aucun
autre aux yeux des Chinois, non-feulement ren-
<doit tous les tons, mais rappelloit au fouvenir
les principales productions des trois règnes dè la
nature : l’animal par la forme du cou de l’oie ;
le végétal par le bois , le bambou & la ca'ebaffe ;
& le minéral par la feuille & la languette d’or.
Il eut fucceflivement les noms de yu , tchao , ho
& cheng ; c’eft ce: dernier qu’il conferve encore»
aujourd’hui*
K k ii