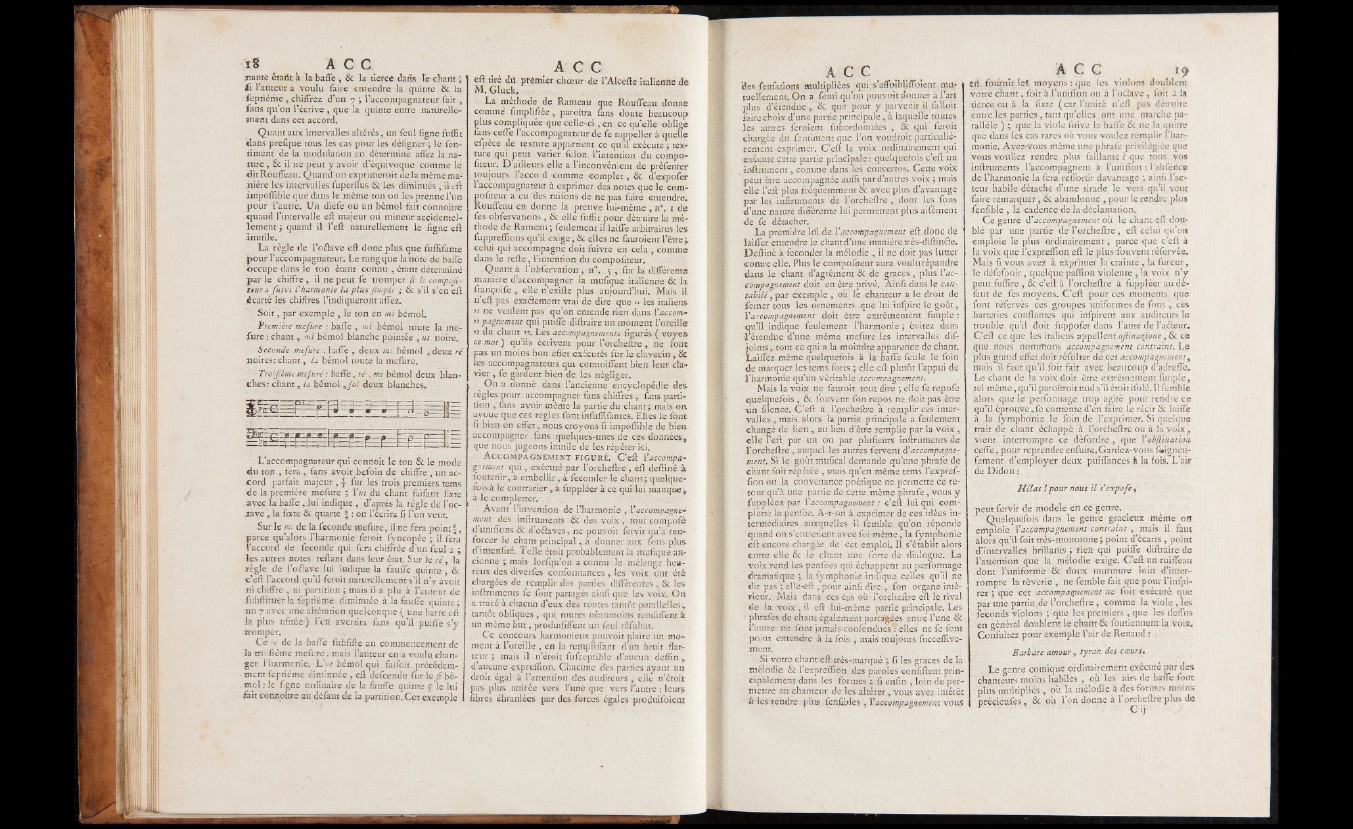
i8 A C C
liante êtafit à la baffe , & la tierce dans Fe chartt ;
£i l’auteur a voulu faire entendre la quinte & la
feptième , chiffrez d’un 7 ; l’accompagnateur fa it ,
fans qu’on l’écrive , que la quinte entre naturellement
dans cet accord.
Quant aux intervalles altérés, im feul ligne fuffit
clans prefque tous les cas pour les défigner ; le fen-
timént de la modulation en détermine affez la nature
, & il ne peut y avoir d’équivoque comme le
ditRouffeau. Quand on exprimeroit delà même manière
les intervalles fuperflus & les diminués, il eft
impoffible que dans le même ton on les prenne l’un
pour l’autre. Un dlèfe ou un bémol fait cônnoître
quand l’intervalle eft majeur oti mineur accidentellement
; quand il l’eff naturellement le ligne eff
-inutile.
La règle de l ’oélave eff donc plus que fuffifante
jpour l’accompagnateur. Le rang que la note de baffe
occupe dans le ton étant connu , étant déterminé
par le chiffre , il ne peut fe tromper fi Le compofi-
teùra fuivi Lé harmonie la plus Jîmple ; 8c s’il s’en eff
(écarté les chiffres l’indiqueront affez.
S o i tp a r exemple , le ton en mi bémoL
Première mefure : baffe , mi bémol toute la me-
fure : chant , mi bémol blanche pointée , ut noire.
Seconde me/tire ; baffe , deux-vni bémol , deux ré
noires:chant, la bémol toute la mefure.
Troiferrie me Juré : baffe, ré , mi bémol deux blanches:
chant, la bémol ,fo l deux blanches.
L ’accompagnateur qui conçoit le ton & le mode
du ton , fera, fans avoir befoin de chiffre , un accord
parfait majeur , } fur les trois premiers tems
de la première mefure ; Y ut du chant faifant fixte
avec la baffe, .lui indique , d’après la règle de l ’oc-
.tave , la fixte & quarte | : on l’écrira fi l’on veut.
Sur le mi de la fécondé mefure, il ne fera point - ,
parce qu’alors l’harmonie feroit fyncopée ; il fera
l ’accord de fécondé qui fera chiffrée d’un feul 2 ;
les autres notes reffant dans leur état Sur le ré, la
règle de l’oéîave lui indique la fauffe quinte, &
c ’eft l’accord qu’il feroit naturellement s’il n’y avoit
ni chiffre , ni partition ; mais il a plu à Fauteur de
fubffituer la feptième diminuée à la fauffe quinte ;
un 7 avec une altération quelconque ( une barre eff
la plus ufitée) l’en avertira fans qu’il puiffe s y
tromper.
Ce re de la baffe fubffffe au commencement de
la troifième mefure, mais Fauteur en a voulu changer
l’harmonie. Une bémol qui faifoit précédemment
feptième diminuée , eff defeendu fur le ƒ bémol
: le figne ordinaire de la fauffe quinte ÿ le lui
fait connoître au défaut de la partition. Cet exemple
A c c
éff tiré dit premier choeur de l’Alceffe italienne de
M. Gluck.
La méthode de Rameau que Rouffeau donne
comme' Amplifiée, paroîtra fans doute beaucoup
plus compliquée que celle-ci, en ce qu’elle oblige
fans ceffe l’accompagnateur de fe rappeller à'quelle
efpèce de texture appartient ce qu’il exécute ; tex-
ture qui peut varier félon l’intention du compo-
fiteur. D ’ailleurs elle a l’inconvénient de préfenter
toujours l’accord 'comme complet, & d’expofer
l’accompagnateur à exprimer des notes que le compofiteur
a eu Hes raifons de ne pas faire entendre»
Rouffeau en donne la preuve lui-même , n®. 1 de
fes obfervations , & elle fuffit pour détruire la méthode
de Rameau ; feulement il laiffe arbitraires les
fuppreffîons qu’il exige, & elles ne fauroient l’être ;
celui qui accompagne doit fuivre en cela , comme
dans le reffe, l’intention du compofiteur.
Quant à l’obfervation , n°. 5 „ fur la différente
manière d’accompagner la mufîque italienne & la
françoife , elle n’exiffe plus aujourd’hui. Mais il
n’eff pas exaélement vrai de dire que « les italiens
53 ne veulent pas qu’on entende rien dans Yaccom-
>3 parlement qui puiffe diftraire un moment l’oreille
33 du chant >3. Les accompagnements figurés ( voyez*
ce mot ) qu’ils écrivent pour l’orcheftre , ne font
pas un moins bon effet exécutés fur le clavecin, &
les accompagnateurs qui connoiffent bien leur cia*
vier , fe gardent bien de les négliger.
^ Gn a donné dans l’ancienne encyclopédie des
règles pour , accompagner fans chiffres , fans partition
, fans avoir même la partie du chant ; mais on
avoue que ces règles font infuffifantes. Elles, le font
fi bien en effet, nous croyons fi impoffible de bien
-■ accompagner fans quelques-unes de ces données,
que nous jugeons inutile de les répéter ici.
A ccompagnement figuré. C ’eft Y accompagnement
q u i, exécuté par l’oreheftre , eff deftiné à
foute ri ir, à embellir, à féconder le chant; quelquefois^
le contrarier , à füppléer à ce qui lui manque ,
à le completter.
Avant l’invention de l’harmonie , Y accompagnement
des inffruments & des voix , tout compofé
d’uniffons & d’oélaves, ne pouvoit fèrvir qu’à renforcer
le chant principal, à donner aux fons plus
d’intenfité. Telle étoit probablement la mufîque ancienne
; mais lorfqu’on a connu le mélange heureux
des diverfes confonnances , les voix ont été
chargées de remplir des parties différentes , & les
inffruments fe font partagés ainfi que les voix. On
a tracé à chacun d’eux des routes tantôt parailelles*
tantôt obliques , qui toutes néanmoins tendiffent à
un même but, produififfent un feul réfultat.
Ce concours harmonieux pouvoit plaire un moment
à l’oreille , en la rempliffant d’un bruit flatteur
; mais il 11’étoit fufceptible d’aucun deffin y
d’aucune expreffion. Chacune des parties ayant un
droit égal à l’attention des \aiuliteurs , elle n’étoit
pas plus attirée vers l’une que vers l’autre : leurs
fibres ébranlées par des forces égales produifoiem
a c c
des fenfations multipliées q u is ’affoibliffoient mutuellement.
On a fenti qu’on pouvoit donner à l’art
plus d’étendue, & que pour y parvenir il falloit
faire choix d’une partie principale, à laquelle toutes
les autres feroient fubordonnées , & qui feroit
chargée du fentiment que l’on voudroit particuliérement
exprimer. C ’eft la voix Ordinairement qui
exécute cette partie principale : quelquefois c’eff: un
infiniment, comme dans les concertos. Cette voix
peut être accompagnée aufîi par d’autres voix ; mais
elle l’eff plus fréquemment & avec plus davantage
pat les inffruments de l’orcheffte , dont les fons
d’une nature différente lui permettent plus aifément
de fe détacher.
La première ldi de, Y accompagnement eft donc de
laiffer entendre le chant d’une manièrestrès-diftinéle.
Deftiné à féconder la mélodie , il ne doit pas lutter
contre elle. Plus le compofiteur aura voulu répandre
clans le chant d’agrément 8c,de grâces , plus Y accompagnement
doit en être privé. Ainfi dans le can-
tabilé ,par exemple , où le chanteur a le droit de
femer tous les ornements que lui infpire le goût,
Y accompagnement doit être extrêmement Ample :
qu’il indique feulement l’harmonie ; évitez dans
l ’étendue d’une même mefure les intervalles dif-
joints.,-tout ce qui a la moindre apparence de chant.
Laiffez même quelquefois à la ; baffe feule le foin
de marquer, les tems forts ; elle eff plutôt l’appui de
l ’harmonie qu’un véritable accompagnement.
Mais la voix ne fauroit tout dire elle fe repofe
quelquefois , & fouvent fon repos ne doit pas être
iun filenc-e. C ’eft à Forcheftre à remplir ces intervalles
, mais alors la partie principale a feulement
changé de lieu , au lieu d’être remplie par la voix ,
elle F éff; par un ou par plufieurs inffruments de
l’orcheftre , auquel les autres fervent dé accompagnement.
Si le goût mufical demande qu’une phrafe de
chant foit répétée , mais qu’en même tems l’expref-
fion ou la convenance poétique ne permette ce retour
qu’à une partie de cette même phrafe, vous y
fuppléez par Y accompagnement : c’eft lui qui complexe
la penfée. A-t-on à exprimer de ces idées intermédiaires
auxquelles il femble qu’on réponde
quand on s’entretient avec foi-même, là fymphonié
eft encore chargée de cet emploi. Il s’établit alors
entre elle & le chant une forte de dialogue. La
voix rend les penfées qui échappent au perfonnage
dramatique ; la fymphonié indique celles qu’il ne
dit pas ; elle-eft , pour ainfi dire , fon organe intérieur.
Mais dans ces cas où ■ Forcheftre eft le rival
de la voix , il eft lui-même partie principale. Les
’ phrafes de chant également partagées entre l’une &
l’autre ne font jamais confondues T elles ne fe font
po.int entendre à la fois , mais toujours fuccefîive-
ment.
Si votre chant eft très-marqué ; fi les grâces de la
mélodie. & l’expreffion des paroles ccnfiftent principalement
dans les formes ; fi enfin , loin de permettre
au chanteur de les altérer, vous avez intérêt
a les rendre plus, fenfibles , Y accompagnement vous
à c c 19
eil fournit le8 moyens : que les violons doublent
votre chant, foit à Funiffon ou à l’oélave , foit à la
tierce pu à la fixte ( car l’unité n’eff pas détruite
entre les parties, tant qu’elles ont une marche parallèle
) ; que la viole fuive la baffe 8c ne la quitte
que dans les cas rares où vous voulez remplir l ’har-
riionie. Avez*Vous même une phrafe privilégiée que
vous vouliez rendre plus faillante ? que tous vos
inffruments l’accompagnent à Funiffon : Fabfence
de l’harmonie la fera reffortir davantage ; ainfi Facteur
habile détache d’une tirade le vers qu’il veut
faire remarquer, & abandonne , pour le rendre plus
fenfible , la cadence de la déclamation.
Ce genre dé accompagnement où le chant eff doublé
par ime partie de Forcheftre, eft celui qu’on
emploie le plus ordinairement, parce que c’eft à
la voix que l’expreffion eft le plus-fouvent réfervée.
Mais fi vous avez à exprimer la crainte , la fureur,
le défefpoir, quelque paffion violente , la voix ti’y
peut fumre , 8c c’eft à Forcheftre à füppléer au défaut
de fes moyens. C ’eft pour ces moments que
font réfervés ces groupes uniformes de fons * ces
batteries confiantes qui infpirent aux auditeurs le
trouble qu’il doit fuppofer dans l’ame de l ’aéleur.
C ’eft ce que les italiens appellent^ojlinasfione , & ce
que nous nommons accompagnement contrainti Le
plus grand effet doit résulter de cet accompagnement,
mais il faut qu’il foit fait avec beaucoup d’adreffe.
Le chant de la voix doit être extrêmement fimple,
tel même, qu’il paroîtroiinud s’ il étoit ifolé. Il femble
alors que le perfonnage trop agité pour rendre ce
qu’il éprouve,fe contente d’en faire le récit & laiffe
à la fymphonié le foin de l’exprimer. Si quelque
trait de chant échappé à Forcheftre ou à la voix -,
vient interrompre ce défordre , que 1’'obflirtation
ceffe, pour reprendre enfuit«^.Gardez-vous ftaigneu-
fernent d’employer deux puiffances à la fois. L ’air
de Didon :
Hélas ! pour nous i l s* expo fe ;
peut fervir de modèle en ce genre. ^
Quelquefois dans le genre gracieux mênie ofl
emploie Y accompagnement contraint , mais il faut
alors qu’il foit très-monotone ; point d’écarts , point
d’intervalles brillants ; rien qui puiffe diftraire de
l’attention que la mélodie exige. C ’eft un ruiffeau
dont l’uniforme 8c doux murmure loin d’irïter-
rompre la rêverie , ne femble fait que pour l’infpi-
rer ; que cet accompagnement ne foit exécuté que
par une partie.de Forcheftre , comme la viole , les
féconds violons ; que les premiers , que les deflùs
en général doublent le chant & foutiennent la voix;
Confultez pour exemple l’air de Renaud :
Barbare amour , tyran des coeurs,
Le genre comique ordinairement exécuté par des
chanteurs moins habiles , où les airs de baffe font
plus multipliés , où la mélodie à des formes moins
précieufes, & ou Fon donne à l’orcheftre plus de
C'ij