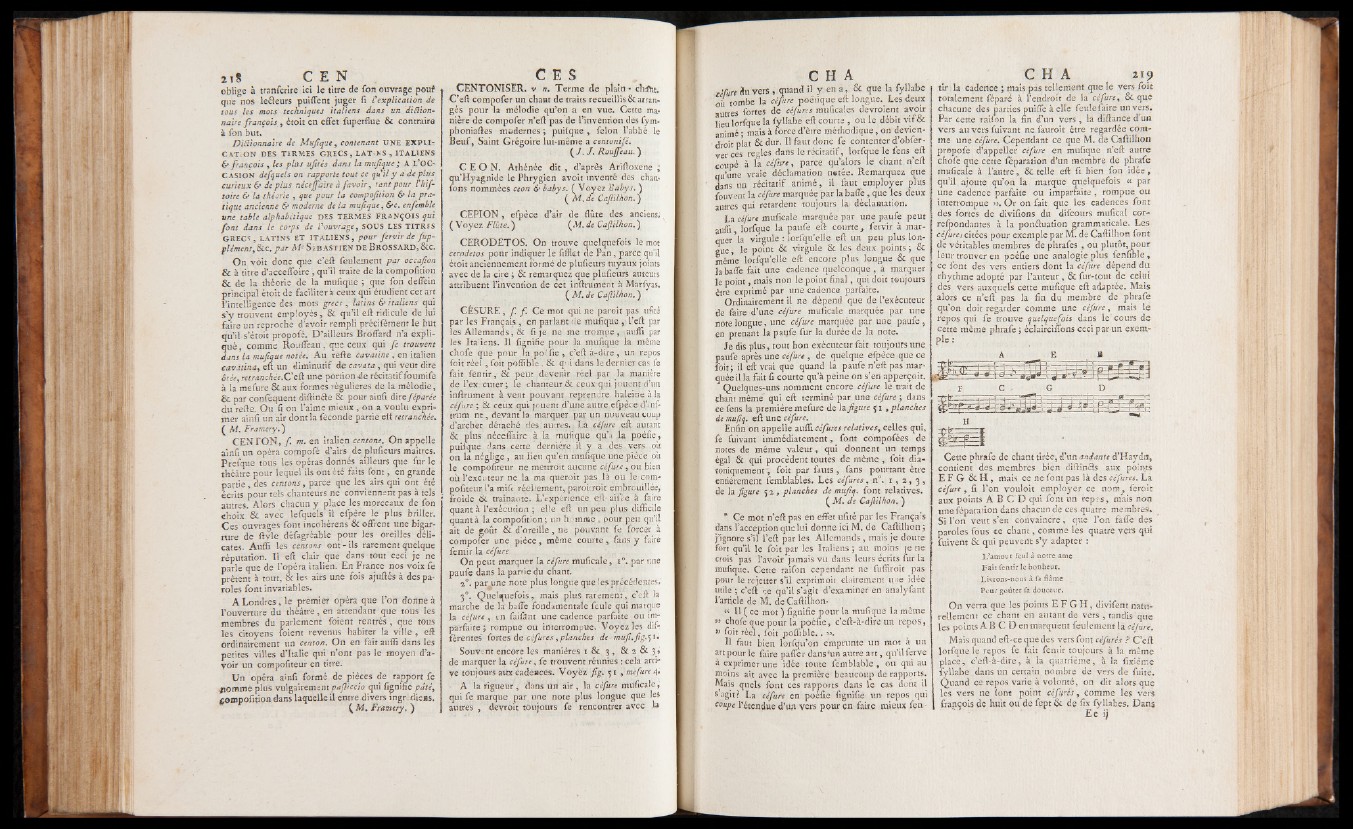
2 , 8 C E N
oblige à tranfcrire ici le titre de fon ouvrage pouf
que nos leâeurs puiffent juger fi l'explication de
tous les mots techniques italiens dans un diélion-
naire françois, étoit en effet fuperflue & contraire
à fon but«
Uittionnaire de Mufique, contenant UNE EX P 1 I?
C AT ION DES TERMES GRECS , L AT i K S , ITALIENS
& françois , les plus ufités dans la mufique ; A l’OC-
C a SION defquels on rapporte tout ce qu'il y a de plus
curieux & de plus néceffaire à [avoir, tant pour Vhif-
toire & la théorie , que pour la compofition & la pratique
ancienne & moderne de la mujîque, &c. enfemble
une table alphabétique DES TERMES FRANÇOIS qui
font dans le corps de Vouvrage, SOUS LES TITRES
g r e c s , LATINS ET ITA L IEN S , pour fervir de fup-
plément, &C. par M« SEBASTIEN DE BROSSARD, &C.
On voit donc que c’eff feulement par occafion
& à titre d’acceffoire , qu’il traite de la compofition
& de la théorie de la mufique ; que fon deffein
principal étoit de facilitera ceux qui étudient cet art
l ’intelligence des mots grecs, latins & italiens qui
s’y trouvent employés, & qu’il eff ridicule de lui
faire un reproche d'avoir rempli précifémenr le but
qu’il s’étoit propofé. D ’ailleurs Broffard n’a expliqué
, comme Rouffeau, que ceux qui fe trouvent
dans la mufique notée. Au refte cavatine , en italien
cavàtina, eft un diminutif de cavata , qui veut diré
ôtée, retranchée.C ’eff une portion de récitatif foumife
à la mefure & aux formes régulières de la mélodie,
& par conséquent diftin&e & pour ainfi dire féparée
du refte. Ou fi on l’aime mieux , on a voulu exprimer
ainfi un air dont la fécondé partie eff retranchée.
f Ai. F ramer y. )
CEN TON, f . m. en italien centone. On appelle
ainfi un opéra compofé d’airs de plufieurs maîtres.
Prefque tous les opéras donnés ailleurs que fur le
théâtre pour lequel ils ont été faits font, en grande
partie, des centons, parce que les airs qui ont été
écrits pour tels chanteurs ne conviennent pas à tels
autres. Alors chacun y place les morceaux de fon
choix. & avec lefquels il efpère le plus briller.
Ces ouvrages font incohérens & offrent une bigarrure
de ftyle défagréable pour les oreilles délicates.
Auffi les centons ont-ils rarement quelque
réputation. Il eft clair que dans tout ceci je ne
parle que de l’opéra italien. En France nos voix fe
prêtent à tout, & les airs une fois ajuftés à des paroles
font invariables.
A Londres , le premier opéra que l’on donne à
l’ouverture du théâtre, en attendant que tous les
membres du parlement foient rentrés , que tous
les citoyens foient revenus habiter la v ille , eft
ordinairement un centon. On en fait auffi dans les
petites villes d’ Italie qui n’ont pas le moyen d’avoir
un compofiteur en titre.
Un opéra ainfi formé de pièces de rapport fe
jiomme plus vulgairement pajliccio qui fignifie pâté,
compofition dans laquelle il-entre divers ingrédiens.
Q M. Fràmery, )
C E S
CENTONISER. v n. Terme de plain - cliàht.
C ’eft compofer un chant de traits recueillis & arrangés
pour la mélodie qu’on a en vue. Cette manière
de compofer n’eft pas de l ’invention des fym-
phoniaftes modernes ; puilque , félon l’abbé le
Beuf, Saint Grégoire lui-même a csntonifé.
( 7 . 7. Rouffeau. )
C E O N. Athénée dit , d’après Ariftoxene ;
qu’Hyagnide le Phrygien avoit inventé des chantons
nommées ceon & babys. ( Voyez Babys. )
( M . de Cafiilhon. )
CEPION , efpèce d’air de flûte des anciens;
( Voyez Flute. ) {M. de Cafiilhon.)
CERODETOS. On trouve quelquefois le mot
cerpdetos pour indiquer le fifikt de Pan, parce qu’il
étoit anciennement formé de plufieurs tuyaux joints
avec de la cire ; & remarquez que plufieurs auteurs
attribuent l’invention de cet inftrument à Marfyas,
( M. de Cafiilhon. )
CÉSURE i fi. f i Ce mot qui ne paroit pas ufitê
par les Français , en parlant de mufique , l’eft par
les Allemands, & fi je ne rne trompe, >auffi par
les Italens. Il lignifie pour la mufique la même
chofe que pour la poéfie , c’eft à-dire, un repos
foit réel , foit poffible, & quidans le dernier cas fe
fait fentir, & peut devenir réel par la manière
de l’ex cuter; le chanteur .& ceux qui jouent d’un
inftrument à vent pouvant reprendre haleine à la
céfure ; & ceux qui jouent d’une autre, efpèce d’ inf-
trum n t , devant la marquer par un nouveau coup
d’archet détaché des autres. ; Là céfure eft autant
& plus néceffaire à la mufique qù’a la poéfie,
puilque dans cette dernière il y a des vers .où
on la néglige, au lieu qu’en mufique une pièce où
le compofiteur ne mettrait aucune céfure, ou bien
où l’excuteur ne la ma queroit pas là ou le comr
pofiteur l’a mift réellement, paroîtroit embrouillée,'
froide & traînante. L’expérience eft- aifée à faire
quant à l’exécution ; elle eft un peu plus difficile
quanta la compofition; un homme , pour peu qu’il
ait de goût & d’oreille, ne pouvant fe forcer à
compofer une pièce, même courte, fans y faire
fentir la céfure.
On peut marquer la céfure muficale, i°. par une
paufe dans la partie du chant.
a0, par une note plus longue que les précédentes.'
3°. Quelquefois, mais plus rarement, c’eft la
marche de là baffe fondamentale feulé qui marque
la céfure, en faifänt une cadence parfaite ou imparfaite
; rompue ou interrompue. Voyez les différentes'
fortes de cèfures, planches demufi.fig.^i»
Souvent encore les manières i & 3 , & 2 & 3 »
de marquer la céfure, fe trouvent réunies : cela arrive
toujours aux cadences. Voyez fig. 51 , mefure 4.
^ A la rigueur, dans un air, la céfure muficale
qui fe marque par une note plus longue que les
autres , devroit toujours fe rencontrer avec la
C H A
M f e h i vers » quand il y en a , & que la fyllabe
ou tombe la céfure poétique eft longue. Les deux
autres fortes de cèfures muficales devroient avoir
lieu lorfque la fyllabe eft courte , ou le débit v if&
animé ; mais à force d’être méthodique, on devien-
droit plat & dur. Il faut donc fe contenter d’obfer-
ver ces réglés dans le récitatif, lorfque le fens eft
coupé à la céfure, parce qu’alors le chant n’eft
qu’une vraie déclamation n©tée. Remarquez que
dans un récitatif animé, il faut employer plus
fouvent la céfure marquée par la baffe, que les deux
autres qui retardent toujours la’ déclamation.
La céfure muficale marquée par une paufe peut
auffi, lorfque la paufe eft courte, fervir à marquer
la virgule : lorfqu elle eft un peu plus longue
, le point & virgule & les deux points ; &
même lorfqu’elle eft encore plus, longue & que
la baffe fait une cadence quelconque, à marquer
le point, mais non le point final, qui doit toujours
être exprimé par une cadence p.arraite.
Ordinairement il ne dépend que de l’exécuteur
de faire d’une céfure mulicale marquée par une
note longue, une céfure marquée par une paufe,
en prenant la paqfe fur la durée de la note.
Je dis plus, tout bon exécuteur fait toujours une
paufe après une céfure , de quelque efpèce que ce
foit; il eft vrai que quand la paufe n’eft pas marquée
il la fait fi courte qu’à peine on s’en apperçoit.
Quelques-uns nomment encore céfure le trait de
çhant même qui eft terminé par une céfure ; dans
ce fens la première mefure de la figure 5 1 , planches
demufiq. eft un e céfure.
Enfin on appelle auffi cèfures relatives, celles qui,
fe fuivant immédiatement, font compofées de
notes de même valeur, qui donnent un temps
égal & qui procèdent toutes de même, foit diatoniquement;
foit par fauts , fans pourtant être
entièrement femblables. Les cèfures, n°. 1 , 2 , 3 ,
de la figure 52, planches de mufiq. font relatives.
( M. de Cafiilhon. )
1 Ce mot n’eft pas en effet ufité par les Français
dans l’acception que lui donne ici M. de Caftilhon ;
j’ignore s’il l’eft par les Allemands , mais je doute
fort qu’il le foit par les Italiens ; au moins je ne
crois pas l’avoir jamais vu dans leurs écrits fur la
mufique. Cette raifon cependant ne fuffiroit pas
pour le rejetter s’il exprimoit clairement une idée
utile ; c’eft ce qü’il s’agit d’examiner en analyfant
l ’article de M‘. de Caftilhon*
« Il ( ce mot ) fignifie pour la mufique la même
” chofe que pour la poéfie, c’eft-à-dire un repos,
w foit réel, foit poffible.. ».
H faut bien lorfqu’on emprunte un mot à un
art pour le faire paffer dans^un autre art, qu’il ferve
à exprimer une idée toute femblable, ou qui au
moins ait avec la première beaucoup de rapports.
Mais quels font ces rapports dans le cas dont il
8 agit? La céfure en poéfie fignifie lin repos qui
coupe l’étendue d’un vers pour en faire mieux fen -
C H A 219
tir la cadence ; mais pas tellement que le vers foit
totalement féparé à l’endroit de la céfure, & que
chacune des parties puiffe à elle feule faire un vers.
Par cette raifon la fin d’un vers , la diftance d’un
vers au vers fuivant ne fauroit être regardée comme
une céfure. Cependant ce que M. de Caftilhon
propofe d’appeller céfure on mufique n’eft autre
chofe que cette féparation d’un membre de phrafe
muficale à l ’autre, & telle eft fi. bien fon idée,
qu’il ajoute qu’on la marque quelquefois « par
une cadence parfaite ou imparfaite, rompue, ou
interrompue ». Or on fait que les cadences font
des fortes de divifions du difeours mufical cor-
refpondantes à la ponéhiation grammaticale. Les
cèfures citées pour exemple par M. de Caftilhon font
de véritables membres de phrafes , ou plutôt, pour
leur trouver en poéfie une analogie plus fenfible,
ce font des vers entiers dont la céfure dépend du
rhythme adopté par l’auteur , & fur-tout de celui
des vers auxquels cette mufique eft adaptée. Mais
alors ce n’eft pas la fin du membre de phrafe
qu’on doit regarder comme une céfure, mais le
repos qui fe trouve quelquefois dajis le’ cours de
cette même phrafe ; éclairciffons ceci par un exemple
:
A E_______ 8___
i l l i i i s S S i i i i lÔ g
F C v G D
H
Cette phrafe de chant tirée, d’un aniante d’Haydn,
contient des membres bien ciiftinâs aux poin.ts
E F G & H , mais ce ne font pas là des cèfures. La
céfure, fi l’on vouloit employer ce nom, feroit
aux points A B C D qui font un repos, mais non
une féparation dans chacun de ces quatre membres.
Si l’on veut s’en convaincre, que l’on faffe des
paroles fous ce chant, comme les quatre vers qui
fuivent & qui peuvent s’y adapter :
L’amour feul à notre ame
Fait fentir le bonheur.
Livrons-nous à fa flâme
Pour goûter fa douceur.
On verra que les points E F G H , divifent naturellement
ce chant en autant de v e rs , tandis que
les points A B C D en marquent feulement la céfure.
Mais quand eft-ce que des vers font cèfures ? C ’eft
lorfque le repos fe fait fentir toujours à la meme
place, c’eft-à-dire, à la quatrième, à la fixième
fyllabe dans un certain nombre de vers de fuite.
Quand ce repos varie à volonté, on dit alors que
les vers ne (ont point céfirés, comme les vers
françois de huit ou de fept & de fix fyllabes. Dans