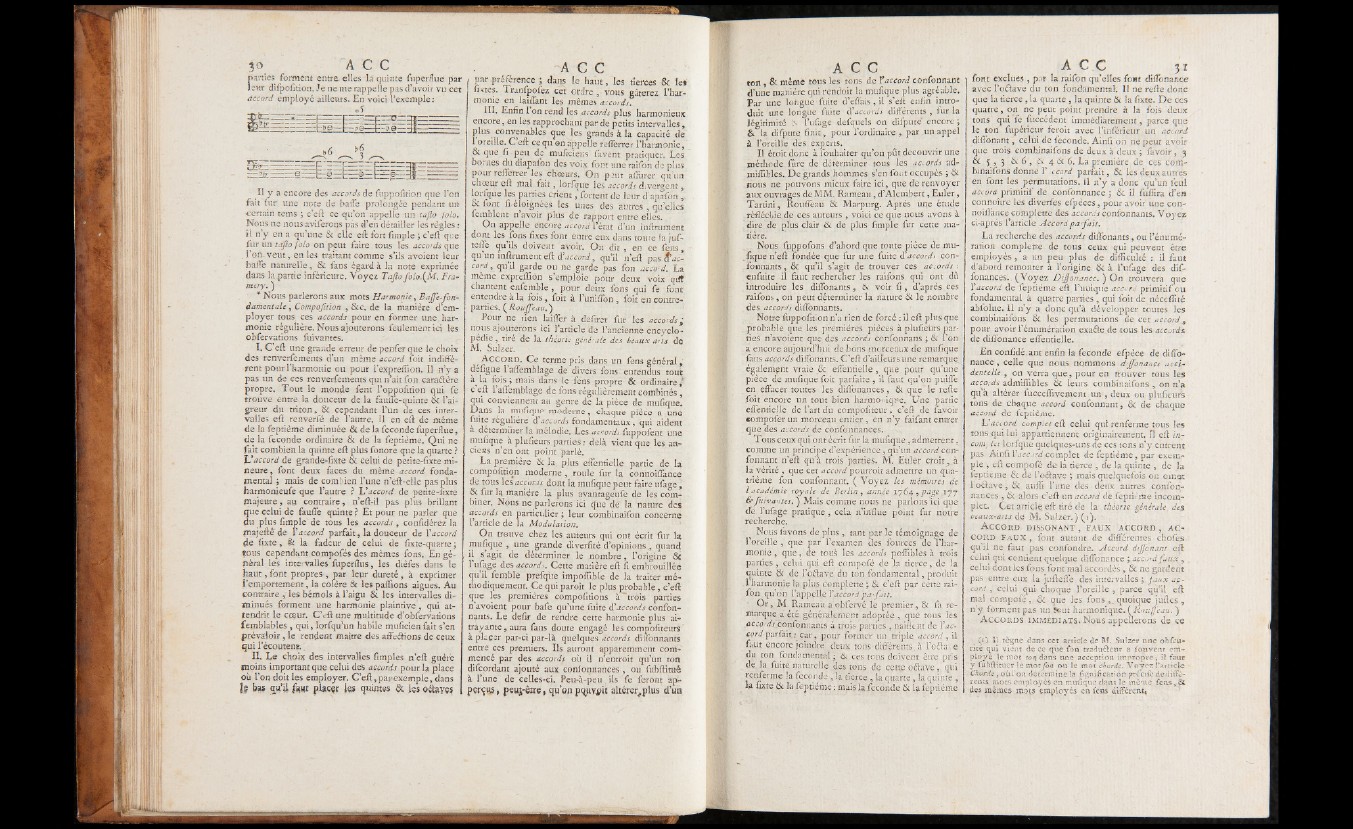
30 A C C
parties forment entre, elles la quinte fuperfliie par
leHr difpofition. Je ne me rappelle pas d’avoir vu cet
accord employé ailleurs. En voici l’exemple :
Il y a encore des accords de fuppofition que l’on
fait fur. une note dé baiTe prolongée pendant un
certain tems ; c’eft ce qu’on appelle un tajlo folo.
Nous ne nous aviferons pas d’en détailler les règles :
il n’y en a qu’une & elle eft fort fimple ; c’eft que
fur un tajlo folo on peut faire tous les. accordsapiQ
. Fon-veut, en les traitant comme s’ils avoient leur
baffe naturelle, & fans égard à la note exprimée
dans la,partie inférieure. Vo yez Tajlo folo JM. Fra-
mery. | -
• * Nous parlerons aux mots Harmonie, Baffe-fondamentale
, Compofition , &c. de la manière d’employer
tous ces accords pour en former une, harmonie
régulière. Nous ajouterons feulement ici lès
obfervations fuivantcs.
I. C ’eft une grande erreur de penfer que le choix
des renverfements d’un même accord foit indifférent
pour l ’harmonie ou pour l’expreflion. 11 n’y a
pas un de ees renverfements qui n’ait fon caratftère
propre. Tout le monde fent l’oppofition qui fe
trouve entre la douceur de la fauffe-quinte oc l’aigreur
du triton, & cependant l’un de ces intervalles
eft renverfé de l’autre, li en eft de même
de la feptième diminuée & de la fécondé fuperflue,
de la fécondé ordinaire. & de là feptième. Qui ne
fait combien la quinte eft plus fonore que la quarte ?
%daccord de grande-ftxte & celui de petite-fixte mineure
, font deux faces du même accord fondamental
; mais de combien l’une n’eft-elle pas plus
harmonieufe que l’autre ? L ’accord de petite-fixte
jnajeure, au contraire, n’eft-il pas plus brillant
que celui de fauffe quinte ? Et pour ne parler que
du plus fimple' de tous les accords 9 confidérez la
majefte de l’accord parfait, la douceur de Yaccord
de fixte, & la fadeur de celui de fixte-quarte ;
tous cependant compofés des mêmes fons, En général
les intervalles fuperflus, les dièfes dans le
hau t, font propres , par leur dureté , à exprimer
l ’emportement, la colère & les paflions aigues. Au
contraire ,Tes bémols à l’aigu & les intervalles diminués
forment une harmonie plaintive, qui at- ;
tendrit le cpeur. C ’eft une multitude d’obfervations
femblables , qui, lorfqu’un habile muficienfait s’en
prévaloir, le rendent maître des affections de ceux
qui l ’écoutent.
II. L e choix des intervalles fimples n’eft guère
moins important que celui des accords pour la place
où l’on doit les employer. C ’e ft, parexemple, dans
Il bas qu’il fm placer les quintes de les oétayes
;A C C
par préférence ; dans le haut, les tierces & le*
fixtes. I ranfpofez cet ordre , vous gâterez l’harmonie
en laiflânt les mêmes accords.
III. Enfin l’on rend les accords plus harmonieux
encore, en les rapprochant par de petits intervalles,
plus| convenables que les grands à la capacité de
l’oreille. C ’eft ce qu on appelle refferrer l’ha rmonie,
k ^ P?u muficiens favent pratiquer. Les
bornes du diapafon des voix font une rai (on de plus
pour refferrer les choeurs. On pmt affurer qu’un
choeur eft mal fait, lorfque les accords divergent ?
lorfque les parties crient, fortent de leur d apafon ,.
& font fi-éloignées les unes des autres , quelles
femblent n’avoir plus de rapport entre elles.
On appelle encore accord l’état d’un infiniment
dont lésions fixes font entre eux dans toute la juf-
teffe qu ils doivent avoir. On d i t , en ce fens,
qu’un infiniment eft tY accord 9 qu’il n’eft pas Raccord
, qu’il garde ou ne garde pas fon accd-d. La
même exprefîiôn s’emploie pour deux voix qiit
chantent enfemble, pour deux fons qui fe font
entendre a la fois, foit à l’uniflon, foit en contreparties.
( Roujfeau. )
Pour ne rien laiffer à defirer fur les accords
nous ajouterons ici l’article de l’ancienne encyclopédie
, tire de la théorie générale des beaux arts de
M. Sulzer.
; A c co r d . Ce terme pris dans un fens généralb
defigne 1 affemblage de divers fons entendus tout
dans le fens propre & ordinaire £
c eft 1 affemblage de fons régulièrement combinés ,
qui conviennent au genre de la pièce de mufique.
Dans la mufique' moderne, chaque pièce a une
fuite régulière d’accords fondamentaux, qui aident
a déterminer la mélodie. Les accords fuppofent une
mufique a plufieurs parties : delà vient que les anciens
n’en ont point parlé.
La première & la plus effentielle partie de la
compofition moderne, roule fur la connoiffance
de tous les accords dont la mufique peut faire ufage ,
8c fur la manière la plus avantageufe de les combiner.
Nous ne parlerons ici que de' la nature des
accords en particulier ; leur combinaifon concerne
l’article de la Modulation.
On trouve chez les auteurs qui ont écrit fur la
mufique , une grande diverfité d’opinions,, quand
il s’agit de déterminer le nombre, l’origine 8c
1 ufage des accords. Cette matière eft fi embrouillée
qu’il femble prefqiie impoflible de la traiter méthodiquement.
Ce qui paroît le plus probable, c’eft
que les premières compofitions à "trois parties
n’avoient pour bafe qu’une fuite dé accords confondants.
Le defir de rendre cette harmonie plus ai-
tràyante, aura fans doute engagé les compofiteurs’
à pkçer par-ci par-là quelques accords diffonnants
entre ces premiers. Ils auront apparemment commencé
par des accords où il n’entroit qu’un ton
difeordant ajouté aux confonnances, ou fubftitiiè
à l’une de celles-ci. Peu-à-peu ils fe feront ap**
perçus, peujrêrre, qu’on pquv^it altérer^plus d’un
A C C
to n , 8c même tous les tons de Y accord confonnant
d’une manière qui rendait la mufique plus agréable.
Par une lohgue fuite d’éfiais, il s’eft enfin introduit
une longue fuite d’accords différents , fur la
légitimité isj l’ufage defquels on difpute’ encore ;
& la difpute finit, pour l’ordinaire , par un appel
à l’oreilie des experts.
Il étoit donc à fouhaiter qu’on put découvrir une
méthode fure de déterminer tous les accords ad-
miffibles. De grands hommes s’en fout occupés ; &
nous ne pouvons mieux faire ici, que de renvoyer
aux ouvrages de MM. Rameau, d’A lembert, Euler,
Tartini, Kouffeau & Marpurg. Après une étude
réfléchie de ces auteurs , voici ce que nous avons à
dire de plus clair 8c de plus fimple fur cette matière.
Nous fpppofons d’abord que toute pièce de mufique
n’eft fondée que fur une fuite d accords con-
, formants, & qu’il s’agit de trouver ces accords :
enfuite il faut rechercher les raifôns qui ont dû
introduire les diffonants, 8c voir fi -, d’après ces
raifons, on peut déterminer la nature 8c le nombre
des accords diffonnants.
Notre fuppofition n’a rien de forcé : il eft plus que
, probable que les premières pièces à plufieiirs parties
n’avoient que des accords confonnans ; 8c l’on
a encore aujourd’hui de bons morceaux de mufique
fans accords diffonants. C ’eft d’ailleurs une remarque^
également vraie & effentielle , que pour qu’une
pièce de mufique foit parfaite , il faut qu’on puiffe
en effacer toutes les diffonances , & que Te refte
foit encore un tout bien harmonique. Une partie
effentielle de l’art du compofiteur, c’eft de lavoir
eompofer un morceau entier , en n’y faifant entrer
que des accords de confonnances.
Tous ceux qui ont écrit fur la mufique, admettent,
comme un principe d’expérience, qu’un accord confonnant
ri’eft qu’à trois parties. M. Euler croit, à
la vérité , que cet accord pourroit admettre un quatrième
fon confonnant. ( Voyez les mémoires de
l académie royale de Berlin , année 1764 , page .177
& fuivantes. ) Mais comme nous ne parlons ici que
de l’ufage pratique, cela n’influe point fur notre
recherche.
Nous l'avons de plus , tant par le témoignage de
l ’oreille , que par l’examen des fources de l’har- .
momie , que, de tous les accords poflibles à trois
parties, celui qui.eft compofé de .la tierce, de la
quinte & de l’o&ave du ton fondamental, produit
l ’harmonie la plus complette j & .c’eft par cette rai-
fon qu’on l’appelle Yaccord p a-fait.
• O r , M Rameau a obfervé le premier, & fa remarque
a été généralement adoptée , que tous les
accords confonnants à trois parties , naifient de Y accord
parfait ^ car, pour former un triple accord., il
faut encore joindre deux tons-différents à l’o£la\e
du ton fondamental ; & ces tons doivent être pris
de. la fuite, naturelle des tons de cett.e oélave , qui
renferme la fécondé , la tierce , la quarte, la quinte ,
lia fixte 8c la feptième : mais la fécondé & la feptième
A C C
font exclues , par la raifon qu’elles font diftonance
avec l’oâave du ton fondamental. Il ne refte donc
que la tierce, la quarte , la quinte & la fixte. De ces
quatre, on ne peut point prendre à la fois deux
tons qui fe fuccédent immédiatement, parce que
le ton fupérieur feroit avec l’inférieur un accord
diffonant, celui de fécondé. Ainfi on ne peut avoir
que trois comhinaifons de deux à deux ; favoir, 3
& 5 , 3 8c 6 , & 4 & 6. La première de ces com-
binaifons donne Y .ccord parfait, & les deux autres
en font les permutations, il n’y a donc qu’un i’eul
accord primitif de confonnance ; & il fufhra d’en
connoître les diverfes efpèces, pour avoir une con-
noilîànce complette des accords confonnants. Vo yez
ci-après l’article Accord parfait.
La recherche des accords diftbnants, ou l’énumération
complette de tous ceux qui peuvent être
employés, a un peu plus de difficulté : il faut
d’abord remonter à l’origine & à l’ufage des dif-
fonances.. (V o y e z Dijfonancc. ) On trouvera que
Y accord de feptième eft. l’uuique accor : primitif ou
fondamental à quatre parties , qui foit de néceflité
abfolue. 11 n’y a donc qu’à développer toutes les
combinaifons 8c. les permutations de cet accord 9
pour avoir l’énumération exaéle de tous les accords.
de diffonance effentielle.
En confidé.ant enfin la fécondé elpêce de diffo-
nance, celle que nous nommons d-ffonance accidentelle
, on verra que, pour en trouver tous les
accords admiflibles & leurs combinaifons , on n’a
qu’à altérer fucceflivement un , deux ou plufieurs
tons de chaque accord confonnant, 8c de chaque
accord de feptième.
L ’auord complet eft celui qui renferme tous les
tons qui lui appartiennent originairement, fl eft in-
com. Ut lorfque quelques-uns de ces tons n’y entrent
pas Ainfi Y accord complet de feptième, par exemple
, eft compofé de la tierce , de la quinte , de la
leptième 8c de l’oâave ; mais quelquefois on omot
l’oélave, 8c aufli l’une des deux autres confonnances
, 8c alors c’eft un accord de feptième incomplet.
Cet article eft tiré de la théorie générale, des
bcaux-aits de M. Sulzer. ) (1 ).
A c co r d dissonant , fau x a c co r d , a c cord
Fa ux , font autant de différentes chofes-
qu’il ne faut pas confondre. Accord diffonant eft
celui qui contient quelque diffonance yaccord faux ,
celui dont les fons font mal accordés, 8c ne gardent
pas entre eux la juftefte des intervalles ; faux accord
, celui. qui choque l’oreille , parce qu’il eft
mal compofé.,, 8c que les fons ,„ quoique juftes ,
n’y forment pas un Jfcut harmonique. ( Roujfeau. \
A c cord s immédiat?. Nous appellerons de ce
. (0 li règne dans cet article de M. Sulzer une obscurité
qui vient de ce que fon tradufteur a Souvent employé
le mot ton dans une acception impropre -, il faut
y fubftituer le motfon ou le mot ch or de. V o y e z Particîe
Chorée-, qùl’on détermine la jfignification précifc-dediffé"
rênes mots employés en mufique dans le même feus,
des mêmes mots employés en fens différent,