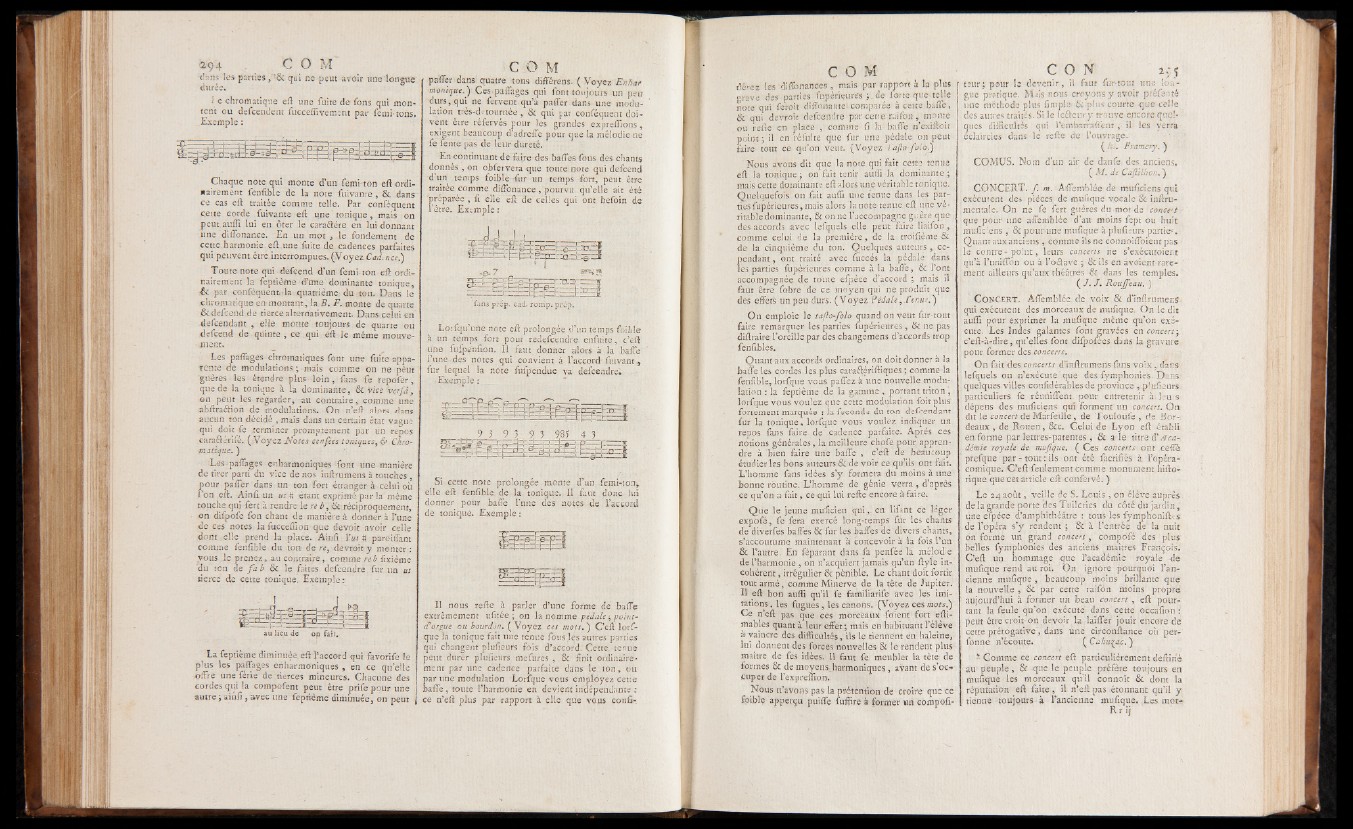
■294 C O M '
dans-'le» parties , ’>& <jui ne-peut avoir une longaè'
durée.
I e chromatique eft une fuite de fons qui montent
ou defcendent fucceflivemsnt par femi-tons.
_ Exemple :
Chaque note qui monte d’un femi-ton eft ordinairement
fenfible de la note fuivante , & dans
ce cas eft traitée comme telle. Par conféquent
cette corde fuivante eft une tonique, mais on
peut.aufli lui en ôter le caraâère en lui donnant
une diflbnance. En un mot * le fondement de
cette harmonie , eft .une fuite de cadences parfaites
qui peuventêtré.interrompues. (V oyez Cad.nce.)
Toute note qui defcend d’un femi-ton eft ordinairement
la feptième ■ d’une dominante tonique,
& par conféquenttla.quatrième, du ton. Dans le
.chromatique-en-montant, la B. F. monte de quarte
& defcend de tierce alternativement. Dans celui en
defeendant , elle monte toujours de quarte ou
defcend de quinte , ce qui eft le même mouvement.
Les paflages chromatiques font une fuite -apparente
de modulations ; mais comme on ne peut
guères les étendre plus lo in , fans fe repofer,
que de la tonique à la dominante, & vice ?verfâ,
©n peut les regarder, au contraire, comme une
. abftraéfion de modulations. On n’eft alors, dans
aucun ton décidé , mais dans un certain état vague
qui doit fe terminer promptement par ün repos
cara&erifé. (V o y e z Notes cenfles toniques, & Chromatique.
)
Les paffages enharmoniques font une manière
de tirer parti du vice de nos inftrumens à touches ,
pour pafter dans un ton fort étranger à celui où
l ’on eft. Ainfi. un ut # étant exprimé par la même
touche qui fert.à rendre: le re b, o£.réciproquement,
on difpofe fon chant de manière à donner à l’une
de ces notes la fuceeftlon que devoit avoir celle
dont,elle prend la place. Ainfi paroiffant
comme fenfible du ton de re9 devroit y monter :
vous ,le prenez, au contraire, comme reb fixième
du ton de fa b & le faites defcendre fur un ut
tierce de cette tonique. Exemple:
C O M
pafter dans quatre tons différons- ( Voyez Enhat
mi)nique.) Ces.paflages qui font toujours un peu
durs, qui ne fervent qu’à pafter dans une modulation
tres-d-?tournée , & qui par conféquent doivent
être réfervés pour les grandes expreflions,
exigent beaucoup d’adrefte pour que la mélodie ne
fe fente pas de leur dureté.
En continuant de faire des baffes fous des chants
donnés , on obfervera que toute: note qui defcend
d un temps foible fur un temps fort, peut être
traitée comme diffonance , pourvu qu’elle ait été
'préparée, fi elle eft de celles qui ont befoin de
l’être. Exemple :
fans prép. càd. rorrip. prép.
Lorfqu’une note eft prolongée d’un temps foible
à un temps fort pour redefcendre. enfuite, c’eft
une fufpénfion. 11 faut donner alors à la baffe
l’une des notes qui convient à l’accord fuivant y
fur lequel la note fufpendue va defcendre..
Exemple : __
I l l jÉ g H i l
9 3 _ 9 8 5 4 3
Si cette note prolongée monte d’un ..femLtonv
elle eft fenfible de la tonique. Il faut donc lui
donner pour baffe l’une des notes de l ’accord
de tonique. Exemple :
au lieu de on fait.
La feptième diminuée eft l’accord qui favorife le
plus les paflages enharmoniques , en ce qu’elle
,©ftre une férié de tierces mineures. Chacune des
cordes qui la compofent peut être prife pour une
autre ; ainfi, avec une feptième diminuée, on peut
Il nous refte à parler d’une forme de baffe
extrêmement ufitée ; on la nomme pédale t, pointer
orgue ou bourdon. (V o y e z ces mots. ') C ’eft lorfque
la tonique fait une ténue fous les autres parties
qui changent plufieurs fois d’accord. Cette, tenue
peut durer plufieurs mefures , & finit ordinairement
par une cadence parfaite dans le ton, ou
par une modulation Lorfque vous employez cette
baffe, toute l’harmonie en devient indépendante r
| ce n’eft plus par rapport à elle que vous conû-
C O M
dérez Iss diftonances, mais par rapport h la plus
grave des parties fupérieurès ;.d e forte que telle
note qui feroit diffonattte-comparée à cette baffe,
& qui devroit defcendre par cet! e rai fon monte
ou refte en place , comme fi la baffe n’exiftoir
point; il en réfulte que fur une pédale on peut
faire tout ce qu’on veut. (Voyez l'ajio fo iq..)
Nous avons dit que la note qui fait cette tenue
eft la tonique; on fait tenir aufli la dominante; i
mais cette dominante eft alors une véritable tonique, j
Quelquefois on fait aufli une tenue dans les parties
fupérieures, mais alors la note tenue eft une v éritable
dominante, & on ne l’accompagne guère que ■
des accords avec lefqnels elle peut Faire liaifon ,
comme celui de la première , de la trdifjème &
de la cinquième du ton. Quelques auteurs , cependant,
ont traité avec fuccès la pédale dans
lès parties fupérieures comme à la baffe, & l’ont
accompagnée de toute efpèce d’accord ; mais il
faut être fobre de ce. moyen qui ne produit que
des dFet's un peu durs. (V o y e z Pédale, Tenue.)
On emploie le ta(lo-folo quand on veut fur-tout
faire remarquer les parties fupérieures, 8c ne pas
diftraire l’oreille par des changemens d’accords trop
fenfibles.
Quant aux accords ordinaires, on doit donner à la
baffe les cordes les plus caraél^riftiques ; comme la
fenfible,. lorfque vous pafîez à une nouvelle modulation
: la feptième de la gamme , portant triton
lorfque vous voulez que cette modulation foit plus'
fortement marquée : la fécondé du ton defeendant
fur la tonique, lorfque vous voulez indiquer un
repos fans faire de cadence parfaite. Après ces
notions générales, la meilleure chofe pour apprendre
à bien faire une baffe , c’eft de beaucoup
étudier les bons auteurs & de voir ce qufils ont fait.
L’homme fans idées s’y formera du moins à une
bonne routine. L’homme de génie verra , d’après
ce qu’on a fait, ce qui lui refte encore à faire.
Que le jeune muficien qui,. en lifant ce léger
expofé, fe fera exercé long-temps fur les chants
de diverfes baffes & fur les baffes de divers chants,
s’accoutume maintenant à concevoir à la fois l’un
& l’autre. En féparant dans fa penféé la mélodie
de l’harmonie , on n’acquiert jamais qu’un ftyle incohérent
, irrégulier 8c pénible. Le chant doit fortir
tout armé, comme Minerve de la tête de Jupiter.
Il eft bon aufli qu’il fe familiarife avec les imitations
, les fugues , les canons. (Voyez ces mots.')
Ce n’eft pas que ces morceaux Soient fort efti-
mables quant à leur effet ; mais en habituant l’élève
à vaincre des difficultés, ils le tiennent en haleine,
lui donnent des forces nouvelles & le rendent plus
maître de fes idées. 11 faut fe meubler la tête de
formes & de moyens ^harmoniques, avant de s’occuper
de l’expreflion.
Nous n’avons pas la prétention de croire que ce
fbible apperçu puiflç luffire à former un compofi-
C O N icf
tînt*; pour le devenir, il faut fur-tout une longue
pratique. Mais nous croyons y avoir préfenté
une méthode plus fi m pie & plus courte que celle
des autres traités. Si le le&eury trouve encore quelques
difficultés qui l’embarraftèm , i f les verra
( 0. Framery. )
éclaircies dans le refte de l’ouvrage.
CO MUS. Nom d’un air de da nfe des anciens.
' ( M. de Caflilhon. )
CONCERT, fi m. A flemblée de muficiens qui
exécutent des pièces de mufiqué vocale 8c inftru-
,mentale. On ne fe fert guères du mot de concert
que pour une affemblée d’au moins fept ou huit
niiifièens , & pour une mufique à plufieurs partie*-.
Quant aux anciens , comme ils ne connoiffoient pas
le contre - point, leurs concerts ne s’exécutoient
qu’à l’uniffon ou à l’oâave ; & ils en avoient rarement
ailleurs qu’aux théâtres & dans les temples.
( J. J. Roujfeau. )
C on cert. Affemblée. de -voix 8c d’inflrumens
qui exécutent des morceaux de mufique. On le dît
aufli pour exprimer la mufique même qu’on exécute.
Les Indes galantes font gravées en concert ;
c’eft-à-dire, qu’elles font difpofées dans la gravure
; pour former des concerts.
On fait des concerts d’inftrumens fans v o ix , dans
lefquels on n’exécute: que dés fymphonies. Dans
quelques villes confidérabies dé province , plufieurs
particuliers fe réunifient pour entretenir ài leurs
dépens des muficiens qui forment un concert. On
dit le concert de Marfeille, de Touloüfe , de Bordeaux
, de Rouen, 8ic. Celui de Lyon eft établi
en forme par lettres-patentes , 8c a le titre & /3ca-
. demie royale de mufique. ( Ces concerts ont ceffé
prefque par - tout : ils ont été facrifiés à l’opéra-
< comique. C ’eft feulement.comme monument hifto-
rique quexet article eft.confervé. )
Le 24 août, veille de S. Louis , on élève auprès
de la grande porte des Tuileries du côté du jardin ,
une efpèce d’amphithéâtre : tous les fymphoniftes
vde l’opéra s’y rendent'; 8c à l’entrée de la nuit
on forme un grand concert, compofé des plus
belles fymphonies des anciens maîtres François.
C’eft un hommage que l’académie royale -de
mufique rend au roi. On ignore- pourquoi l’ancienne
mufique , beaucoup moins brillante que
la nouvelle , & par cette raifôn moins propre
aujourd’hui à former un beau concert , eft pourtant
la feule qu’on exécuté dans, cette occafion :
peut être croit-on devoir la laiffer jouir encore de
cette prérogative, dans une circonftance où per-
; fonne n’écoute. ( Cahu^ac. )
* Gomme ce concert eft particulièrement deftine
au peuple, & que le peuple préfère toujours en
mufique les morceaux qu’il connoît & dont la
réputation eft faite, il n’eft pas étonnant qu’il y
tienne toujours à l’ancienne mufique. Les mort)
„ : :