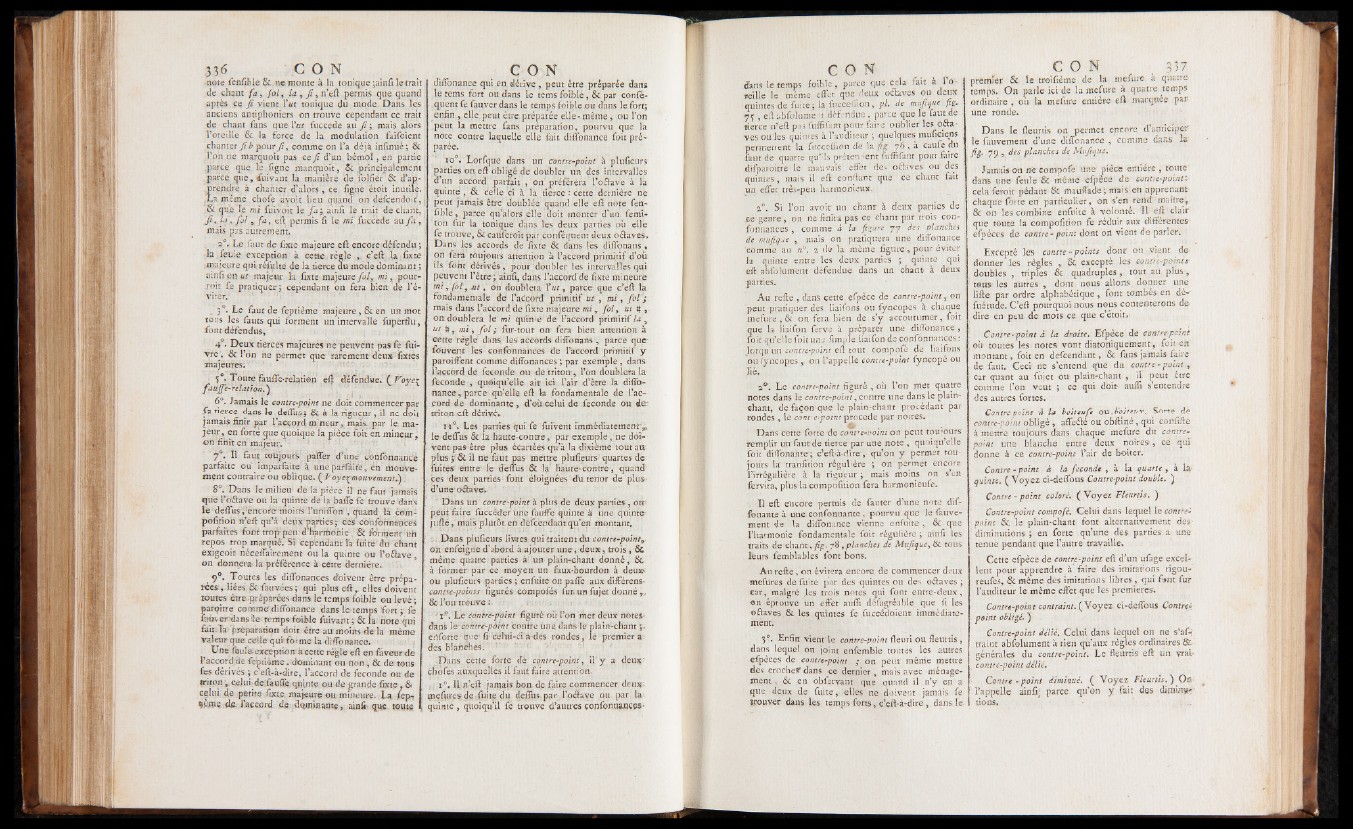
33 <5 C O N
note fenfible & ne monte à la tonique ;ainfi le trait
de chant f a f o l , la , f i , n’eft permis que quand
après ce f i vient Y ut tonique du mode. Dans les
anciens antiphoniers on trouve cependant ce trait
de chant fans que l’«r fuccede au fi', mais alors
l ’oreille & la force de la modulation faifoient
chanter f i t pour f i , comme on l’a déjà infinité; &
,1’ph ne marquoit pas ce f i d’un b émol, en partie
parce que le., ligne manquoit, ^principalement
parce que, Suivant la manière de folfiér & d’ap-
prèhdré à chanter d’alors, ce, ligne étoit inutile.
La meme chofç iayolt lieu quand on defcendoit, ;
& que le mi fuivoit le fa', ainfi le trait de chant,
fi,, la , f o l , fa , efi; permis fi le mi fuccede au fa ,
mais pas autrement.
2°. Le faut de fixte majeure eft encore défendu ;
la feule exception à cette règle , c’eft la fixte
majeure qui réfulte de la.tierce du mode dominant ;
ainfi en ut majeur la fixte majeure fo l, m i pourvoit
fe pratiquer; cependant on fera bien de l’éviter.
1 '
; 3°. Le faut de feptième majeure, 8i en un mot
tous les fauts qui forment un intervalle fuperflu,
font défendus,
4°. Deux tierces majeures ne peuvent pasfe fui-
v r e , & l’on ne permet que rarement deuxfixtès j
majeures.
5®. Toute faufle-relation eft défendue* {Voyez
faujfe-relation. )
6°. Jamais le contre-point ne doit commencer par |
fa tierce dans le defiiis ; & à la rigueur, il ne doit .
jamais finir par l’aeçord mineur, mais par le. ma-
Ie W* en forte que quoique la pièce Loir en mineur,
©n finit en majeur.
7°. Il faut toujours pafler d’une eonfbnnance
parfaite ou imparfaite à uné paffàite, eh mouvement
contraire ou oblique. { F oye^mouvementé)]
8°..Dans le milien de la pièce if ne faut jamais
que Fo&ave ou la quinte de la baffe fe trouve-dans
le deflus ^éneofè moirrs runifion ', quand. là cbm-
pofitioh n’eft qu’a deijx/parties } cés conformances
parfaites fontvroppeir d’harmonie & forment un
repos trop marqué. Si cependant fa fuite du 'cHant
exigeoit néceflairement ou la quinte ou l’oélave,
on donner» la préférence à cette dernière.- 1
* 9°« Toutes les diflonances doivent être préparées,.
liées. fauv-ées ; qui plus eft,. elles doivent
toutes être-préparées dans le temps foible ou levé ;
paraître comme diflonance dans le*temps ‘fort ;• fe
feüvei^dans 3e- tempsfoible fuivant ; & la. note qui
fait.là préparation doit êire au moins de la même
Valeur que celle' qui forme la diflonance.
Une Fauleexeèptiomà cette règle eft en faveur de
Pàccordtlë fèpiième . dominant ou non, & de tous
fes dérivés y c ’eft-à-dîre, l’accord de fécondé ou de j
U-itoncelui;de'f^uflè quinte ou.de grande fixte , &
Gçlui de petite .fixtA majeure ou mineure. La fep7
hpme dP- l’açexjrd de .dominante, ainfi que toute
CO N
diflonance qui en dérive , peut être préparée dans
le îems fort ou dans le tems foiblé, & par cônfé-
qpent fe fauver dans le temps foible ou dans le fort;
enfin , elle peut être préparée elle-même, ou l’on
peut la mettre fans préparation,, pourvu que la
note contre laquelle elle fait diflonance foit préparée.
io . Lorfque dans un contre-point à plufieurs
parties on eft obligé de doubler un des intervalles
d un accord parfait , on préférera l’oélave à la
quinte, & Celle ci à la tierce : cette dernière ne
peut jamais être doublée quand elle eft note fen-
fible,. parce qu’a lors e lle . doit monter d’un femi-
'toh fur la tonique dans les deux parties où elle
fe trouve, & caüféro'it par conféquent deux oéfaves,
; Dans les accords dé fixte & dans lés difîonans ,
on fera toujours attention à l’accord primitif d’où
ils font dérivés, pour doubler les intervalles qui
peuvent Fêtre; ainfi, dans l’accord de fixte mineure
mi y fo l, u t , on doublera Y u t , parce que c’éft la
fondamemafe de l’accord primitif ut-, mi, f o l ;
mais dans l’accord de fixte majeure mi , fol,, ut # ,
on doublera le mi quitiiede Faccord primitif la ,
ut fr, mi f o l ; for-tout on fera bien attention à
cette règle dans les accords diflonans , parte que-
fouvent les confonnances de l’accord primitif y
paroiflent comme diflbnances}par exemple, dans
l ’accord dé fécondé ou de triton*, l’on doublera la
féconde , quoiqu’elle ait ici. l’air d’être là diffo-
nance r parce qu’ellé eft la fondamentale de Fac-
^ tord de dominante, d’oiteelui de. fécondé ou de:
triton eft dérivé.-;
i i° . Les parties qui fe fuivent immédiatement"^
le deflus & là haute-contre, par exemple, ne doi-
• vent pas être plus écartées qu’à la dixième tout au
plus ;- & il né-faut pas mettre plusieurs- quartes de
fuites entre' le deflus & la Haute-contre, quand
ces deux parties font éloignées du. ténor de plus-
dàme'o&avêi-
Dans un contre-pointa, plus dé deux parties, ow
peut faire fuccéder une fauffe quinte à line quinte
Jufté, mais plutôt en défcendantqu’en montant.
Si Dans plufieurs livres qui traitent du contre-point
oii enfeigne d’abord à:ajouter une, deux, trois , &
même quatre parties à un plain-chant donné, 8c
à former par ce moyen un faux-bourdon à deux^
ou plufieurs parties ; enfuite on pafle aux différent
contre-points figurés compofés fur- un fujet donné
8c l?on trouve
' r°. Le contre-point figuré où l’on met deux notes*
danfc lè' coHire-poitit contre une. datis le plain-chant
ertfortè que' fi‘éelui-ci a-des rondes j lé premier a .
des blàhéhès. ' v
vDans çëtte forte clé contre-point, il y a deux-
cliôfes auxquelles il faut faire attention.
- ; ;i>. Il n’eft jamais b,on de faite, commencer deux-
meures de fuite du deflus par r-péfaye ou par la.
quintè , qtioiqu’il fé trouve d’autres confonnances*
C O N
Sans le temps foible, parce que cela fait à lo -
jteille le même effet que deux octaves ou deux
quintes de fuite ; la fucceflion, pl. de mufique fa.
, eft abfolument def.'ndue , parce que le faut de
tierce n’ eft pas fuffifant pour faire oublier les oéfa-
ves ou les quintes à l’auditeur ; quelques muficiens
permettent la fucceffion de la ftg 76 , à caufe du
finit de quarte qu’ils prétendent fuffifant pour faire
cîifparoi.tre le mauvais effet des oéiàves ou des
quintes, mais il eft confiant que ce chant fait
un effet très-peu harmonieux.
20. Si l’on avoir un cfiant à deux parties de j
,ee genre , on ne finira pas ce chant par trois con- ;
fonnances , comme à la faiire 77 des planches
de mufique , mais on pratiquera une diflonance .
comme au n°. 2 de: la même figure, pour éviter
la quinte entre les deux parties quinte qui
eft abfolument défendue dans un chant* à deux
parties.
Au refte , dans cette efpèce de contre-pointon
peut pratiquer des liaifons ou fyncopes à chaque
mefure, & on fera bien de s’y accoutumer, foit
que la liaifon ferve à préparer une diflonance ,
foit qu’elle foit une fiinple liaifon de confonnances :
Jorqu un contre-point efi tout compofé de liaifons
ou fyncopes on l’appelle contre-point fyncopé ou
lié.
20. Le contre-point figuré , où l’on met quatre
notes dans lé contre-point, contre une dans le plain-
«hant, de façon que le plain-chant procédant par
rondes , le conv e-point procédé par noires.
Dans cette forte de contre-point on peut toujours
remplir un faut de tierce par une note , quoiqu’elle
foit diflonahte; cfeft-à-dire, qu’on y permet toujours
la' tranfition régulière ; on permet encore
l’irrégulière à la rigueur ; mais moins on . s’en
fbrvira-, pltis la compofition fera harmonieufe.
Il eft encore permis de fauter d’une note dif-
fonante à une confonnante , pourvu que le fauve-
ment de la diflonance vienne enfuite , & que
l ’harmonie fondamentale foit régulière ; ainfi les
traits de chant, fig. 78, planches de Mufique, 8t tous
feurs femblables font bons.
Au refte, on évitera encore de commencer deux
mefures de fuite par des quintes ou des oélaves ;
car, malgré les trois notes qui font entre-deux,
on -éprouve un effet aufli défagréable que fi les
o&aves & les quintes fe fucoédoient immédiatement.
3?. Enfin vient le contre-point fleuri ou fleurtis ,
dans lequel on joint enfemble toutes les autres
efpèces de contre-point ; on peut même mettre
des croches' dans ce dernier , mais avec ménagement
, 8c en obfervant que quand il n’y en a
que deux de fuite, elles ne doivent jamais fe
trouver dans les temps forts, c’eft-à-dire , dans le
C O N 337
premier 6c le troifième de la mefure à quatre
temps. On parle ici de la mefure à quatre temps
ordinaire , ou la mefure entière eft marquée par-
une ronde.
Dans le fleurtis on permet encore d’anticiper
le fauvement d’une diflonance , comme dans la
fig. 79 5 des planches de Mufique.
Jamais on ne eompofe une pièce entière , foute
dans une feule & même efpèce de contie-point >
cela feroit pédant & mauflade ; mais'en apprenant
chaque forte en particulier, on s’en rend maître,
& on les combine enfnite à volonté. Il eft clair
que toute la compofition fe réduit aux differentes
efpèces de contre - point dont on vient de parler.
Excepté le's Contre - points dbnf on vient de
donner les règles , •& excepté les contre-points
doubles , triples & quadruples, tout au plus,
tous- les autres , dont nous' allons donner une
lifte par ordre alphabétique, font tombes en dé-'
fuétude. C ’eft pourquoi nous nous contenterons de-
dire en peu de mots ce que c’étonv
Contre-point à la droite. Efpèce de contrepoint
'où toutes les notes vont diatoniquement, foit en
montant, foit en defeendant, & fans jamais faire
de faut. Ceci rte s’entend que du contre-point ,
car quant au fujet ou plain-chant , il peut être
comme l’on veut ; ce qui doit- aufli s’entendre
des autres fortes.
Contre-point d la boiteufe où.boiteux. Sorte de
contre-point obligé , afle&é ou obftirté, qui confifte
à mettre toujours dans chaque mefure du contrepoint
une blanche entre deux noires., ce qui
donne à ce contre-point l’air de boiter.
Contre - point à la fécondé , à la quarte , à là^
quinte. ( V o yez ci-deffous Contre-point double. )
Contre - point coloré.- ( Voyez Fleurtis. )
Contre-point compofé: Celui dans lequel le contrepoint
& le plain-chant font alternativement des-
: diminutions ; en forte qu’une des parties a une
tenue pendant que l’autre travaille.
Cette efpèce de contre-point eft d’un ufage excellent
pour apprendre à faire des imitations rigou-
reufes, & même des imitations libres, qui font fur
l’auditeur le même effet que les premières.
Contre-point contraint. (V o y e z ci-deflous Contre«
point obligé. )
Contre-point délié. Celui dans lequel on ne s’af-'
traint abfolument à rien qu’aux règles ordinaires 8t
générales du contre-point. Le fleurtis eft un vrai-
contre-point délié.
Contre - point diminué. ( Voyez Fleurtis.') On
l’appelle ainfij parce qu’on y fait des dimins-r
tiens, - .. .