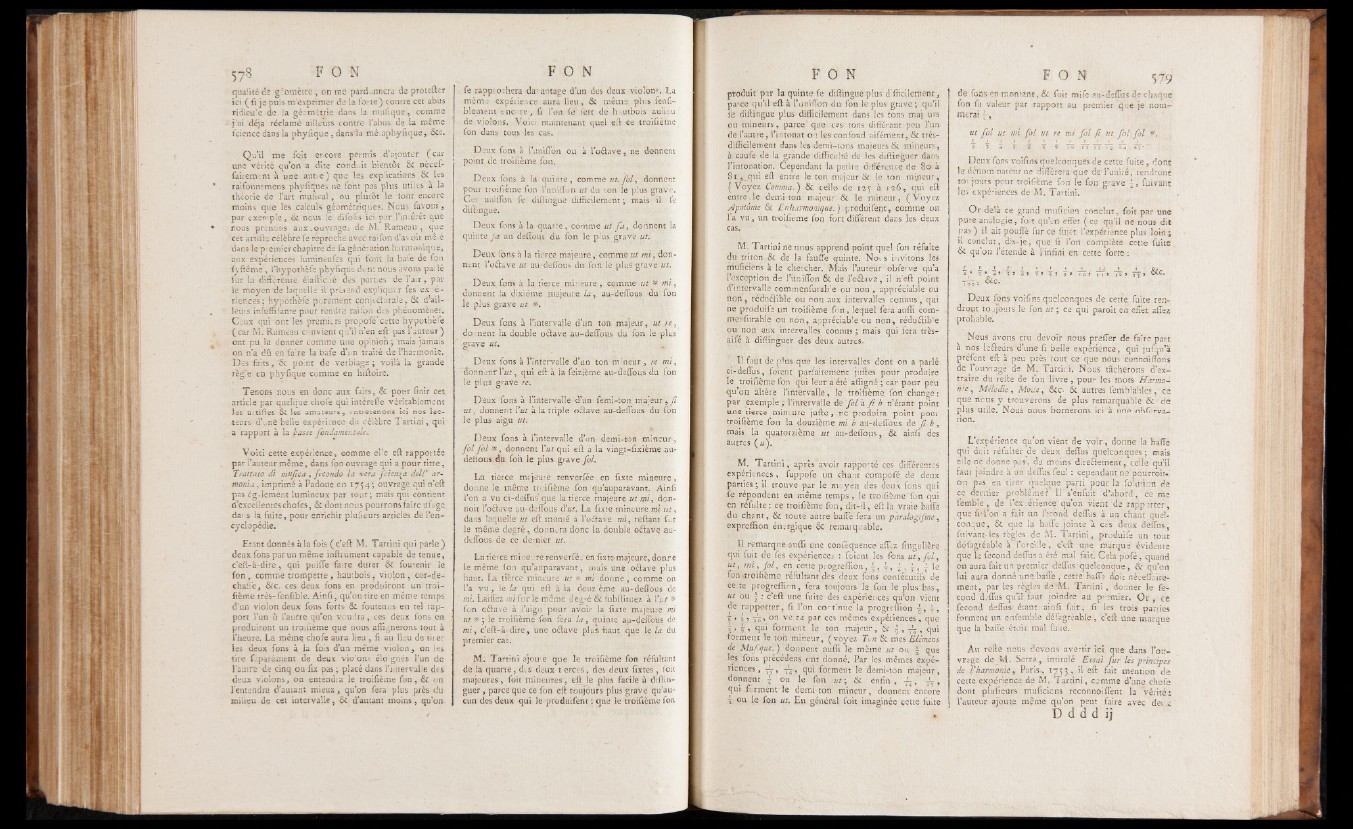
qualité de giomètre , on me pardonnera de protefter
ici ( fi je puis m'exprimer de la lorte) contre cet abus
ridicu’e de la géométrie dans la mufique, comme
j ’ai déjà réclamé ailleurs contre l’abus de la même
fcience dans la phyfique , dans la mé.aphyfiqüe, &c.
fe rapprochera davantage d’un des deux violon?. La
même expérience aura lieu, & même plus fenfi-
blement encore, fi l’on fe fert dé hautbois atilieu
de violons. Voici maintenant quel efb ce troifième
l'on dans tous les cas.
Qu’il me foit encore permis d’ajouter (car
une vérité qu’on a dite conduit bientôt ôc nécef-
fairement à une. aut> e ) que les exp'ications & les
raifonnemens phyfique s ne font pas plus utiles à la
théorie de l’art mufical, ou plutôt le lont encore
moins que les calculs géométriques. Nous favons,
par exemple, & nous le difoss ici par l’intérêt que
nous prenons aux .ouvrage^ de M. Rameau, que
cet artifte célèbre fe reproche avec rai fon d’avoir mê?é
dans le premier chapitre de fa génération harmonique,
aux expériences lumineufes qui font la baie de ton
f) fie me , l'hypothèfe phyfique don: nous avons pat lé
fur la differente éiaftic.ié des parties de l’air, par
le moyen'de laquelle il prétend expliqua r fes'expé riences;
hypothèfe purement conjecturale, & cPail-
lems infuffifante pour rendre raiion des phénomènes.
Ceux qui ont les premiers propofé'cette hypothèle
( car M. Rameau convient qu’il n’en eft pas l’auteur )
ont pu la donner comme une opinion ; mais jamais
on n’a dû en faire la bafe d’un traité de ^harmonie.
Des faits, point de verbiage ; voilà la grande
règle en phyfique comme en hiftoire.
Tenons nous en donc aux faits, & pour finir cet,
article par quelque chofe qui intérefie véritablement
les aitifles & les amateurs, entretenons ici nos lecteurs
d’unè belle expérience du célèbre Tartini, qui
a rapport à la basse fondamentale.
Voici cette expérience, comme elle eft rapportée
par l’auteur même, dans fon ouvrage qui a pour titre,
Trattato di mufica , fccondo la vera fcien\a dell’ ar-
monia, imprimé à Padoue en 1754 ; ouvrage qui n’eft
pas également lumineux par tout; mais qui contrent
d’excellentes chofes, & dontnous pourrons faire ufage,
dai s la fuite, pour enrichir plufieurs articles de l’encyclopédie.
Etant donnés à la fois ( c ’eft M. Tartini qui parle )
deux fons par un même inftrument capable de tenue,
c’eft-à-dire, qui puiffe faire durer & foutenir le
fon r comme trompette , hautbois f violon , cor-de-
ehaffe, &c. ces deux fons en produiront un troifième
très-fenfible. Ainfi, qu’on dre en même temps
d’un violon deux fons forts & foutenus en tel rapport
l’un à l’autre qu’on voudra, ces deux fons en
produiront un troifième que nous affignerons tout à
l’heure. La même chofe aura lieu , fi au lieu de tiier
les deux fons à la fois d’un même violon, on les
tire fjparément de deux vioons élo’gnés l’un de
l ’autre de cinq ou fix pas ; placé dans l’intervalle des
deux violons, on entendra le troifième fon, & on
l’entendra d’autant mieux, qu’on fera plus près du
milieu de cet intervalle, & d’autant moins, qu’on
Deux fons à l’uniffon ou à l’oâave, ne donnent
point de troifième fon.
Deux fons à la quinte, comme uu.fol, donnent
pour troifième fon l’uniiîon ut &n ton le plus grave.
Cet uniffon fe diftingue difficilement; mais il- fe
diftingue.
Deux fons à la quarte, comme ut fa , donnent la
quinte ja au deffous du fon le plus grave ut.
Deux fons à la tierce majeure, comme ut mi, donnant
l’oéhve ut au-deffous du fon le plus' grave ut.
Deux,fons à la tierce mineure, comme ut x mi,
donnent la dixième majeure, la, au-deffotjs du fon
le plus grave ut v
Deux fons à l’intervalle d’un ton majeur, ut re,
dorment la double oélave au-deffous du fon le plus
grave ut.
Deux fons à l’intervalle d’unvton rrvneur, re mi,
donnentrl’«r, qui eft à la feizième au-deffous du fon
le plus grave re.
Deux fons à,l’intervalle d’un femi-ton majeur',y?
ut, donnent Y ut à la triple oélave au-deffous du fon
le plus aigu ut.
Deux fons à l ’intervalle d’un demi-ton mineur ,
fo l folM, donnent Y ut qui eft à la vingt-fixième au-
deiious du fon le plus grave fol.
La tierce majeure renverfée en fixte mineure,
donne le. même troifième fon qu’auparavant. Ainfi
l’on a vu ci-deffus’ que la tierce majeure ut mif don-
noit l’oélave au-deffous d’ut. La fixte mineure mi ut,
dans laquelle ut eft monté à l’oéiàve mi, reftant fur
le même degré, donnera donc la double o&avç au-
deffous de ce dernier ut.
La tierce mineure renverfée en fixte majeure, donre
le même Ion qu’anpâravant, mais une o&ave plus
haut. La tierce mineure ut * mi donne, comme on
l’a v u , le Az qui eft à la donz ème au-deffous de
‘ mi. Laiffez mi fur le même degré & fubftituez a Y ut %
fon oélave à l’aigu pour avoir la fixte majeure mi
ut % ; le troifième fon fera la, quinte au-deffous de
mi, c’eft-à-dire, une oéfave plus haut que le la du
premier cas.
M. Tartini ajou e que le troifième fon réfultant
de !a quarte, dts deux t erces, des deux fixtes , foit
majeures, foit mineures, eft le plus facile à diftin-
guer, parce que ce fon eft toujours plus grave qu’au-
; cun des deux qui le produifent : que le troifième fon
produit par la quinte fe diftingue plus difficilement,
p a» cequ’il eft à l’uni (Ion du fon le plus grave ; qu’il
fe diftingue plus difficilement dans les tons ma) urs
ou mineurs, parce'que ces tons différant peu l’un
de l’autre, l’intonat o i les confond aifémènr, & très-.
difficilement dans les demh-tons majeurs & mineurs,
à caufe de la grande difficulté de les diftinguer dans
l’intonation. Cependant la petite différence de 80 à
81 , „qui eft entre lé ton majeur & le ton mineur,
(Voyez Gomma. ) & celle- de 125 à 126, qui eft
entreéle demi-ton majeur & le mineur, (V oy e z
Apotôme & Enharmonique. J prcduifent, comme on
l’a vu, un troifième fon fort différent dans les deux
cas. x
M. Tartini ne nous apprend point quel fon réfulte
du triton-& de la fauffe quinte. Noi s invitons les
muficiens à le chercher. Mais l’auteur obferve qu’a
l’exception de l’üniffon & de Tôétave, il n’eft point
d’intervalle commenfurab’e ou non, appréciable ou
non, rédnéHble ou non aux intervalles connus, qui
ne produife un troifième fon, lequel fera auffi corn*
menfurable ou non, appréciable ou non, réduéfib'e
ou non aux intervalles connus; mais qui fera très-
aifé à diflir.guer des deux autres.
Il faut de plus que les intervalles dont on a parlé
ci-deffus, foient parfaitement juftes pour produire
le troifième fon qui leur a été affigné ; car pour peu
qu’on altère l’intervalle, le troifième fon change :
par exemple ; l’intervalle de fo l à f i b n’étant point
une tierce .min:ure jufte , .ne produira point pour
troifième Ton la douzième mi b au-deffous dey? b,
mais la quatorzième ut au-deffous, & ainfi des
autres («).'
M. Tarti n i, apres avoir rappo'-té ces différentes
expériences , fuppofe un chant compcfé de deux
parties; il trouve par le moyen des deux fons qui
fe répondent en même temps , le troiffème'Ton qui
en réfulte: ce troifième fon, dit-il, eft la vraie baffe
du chant, & toute autre baffe fera un paralogifme,
expreffion énergique ôt remarquable.
Il remarque-auffi une conséquence- affez fingulière
qui fuit de fes expériences : foient les fons ut, fo l,
ut, mi, fo l, en cette progreffion, y , | le
fon «troifième réfultant des deux fons coniecutifs' de
ce.te progreffion, fera toujours le Ton le plus bas,
ut ou ^ ; c’eft une fuite des expériences qu’on vient
de rapporter, fi l’on continue la progreffion j , ÿ ,
î » 5 5 j on v e ra par ces mêmes expériences, que
s , | q u i forment le ton majeur, & , Tj » qui
forment le ton mineur, (voyez Ton & mes EUmens
de Mufique.) donnent auffi le même ut on || que
les fons précédens ont donné. Par les mêmes expériences,
— , — , qui forment le demi-ton majeur ,
donnent f o u le fon ut\ & enfin , ~ ,
qui forment le demi-ton mineur, donnent encore
â ou le fon ut. En général foit imaginée cette fuite
dé fons en montant, & foit tnife au-deffus de chaque
fon fa valeur par rapport au premier que je nommerai
I ,
ut fo l ut mi. fol ut re mi fo l fi ut fo l fo l
* T 4 ? ? S 9 TE TJ TJ Te TÂI, Tï’ "
Deux fons voifins quelconques de cette fuite, dont
le dénom:nateur ne différera que de l’uniîé, rendront
tou jours peur troifième fon le fon grave fuivant
les expériences de M. Tartini. v
Or delà ce grand muficien conclut, foit par une
pure analogie, foit qu’en effet (ce qu’il ne nous dit
pas ) il ait pouffé fur ce fui et l’expérience plus loin ;
il conclut, dis-je, que fi l’on complète cette fuite.
& qu’on l’étende à f infini en cette forte:
Deux fons voifins quelconques de cette, fuite rendront
toujours le fon ut ; ce qui paroît en effet affez
probable. ^
Nous avons cru devoir nous preffer de faire part
à nos leéteùrs d’une fi belle expérience, qui jufqu’à
préfent eft à peu près tout ce que nous connoiffons
de l’ouvragé de M. Tartini. Nous tâcherons d’extraire
du refte de fon livre, pour les mots Harmonie,
Mélodie, Mode, &c. & autres femblables, ce
que nous y trouverons de plus remarquable & de
plus utile. Nous nous bornerons ici à une obferva-
tion.
L’expérience qu’on vient de voir, donne la baffe
qui doit réfulter de deux deffus quelconques ; mais
elle ne donne pas-, du moins directement, celle qu’il
faut joindre à un deffus feul : cependant ne pourroir«
on pas en tirer quelque parti pour la Toludon dé
ce dernier problème ? Il s’enfuit d’abord, ce me
femble, de Tex:érience qu’on Vient de rapporter,
que fi'Ton a fait un fécond deffus à un chant quelconque,
& que la baffe jointe à ces deux deffus,
fuivant-les règles de M. Tartini.,,produife un tout
défagréable à l’oreille, c’eft une marque évidente
que le fécond deffus a été mal fait. Cela pofé, quand
on aura fait un premier deffus quelconque, & qu’on
lui aura donné une baffe , cette baffe doit néceilsire-
ment, par les règles de M. Tartini , donner le fécond
deffus qu’il faut joindre au premier. Or , ce
fécond deffus- étant ainfi fait, fi les trois parties
forment un enfemble défagréable, c’eft une marque
que la baffe étoit mal faite.
Au refte nous devons avertir ici que dans l’ouvrage
de M. Serre, intitulé Essai fur Us principes
de l ’harmonie, Paris-, 17*5 3 , il eft fait mention de
cette expérience de M. Tartini, comme d’une chofe
dont plufieurs muficiens reconnoiffent la vérité:
l’auteur ajoute même qu’on peut faire avec dei
D d d d ij