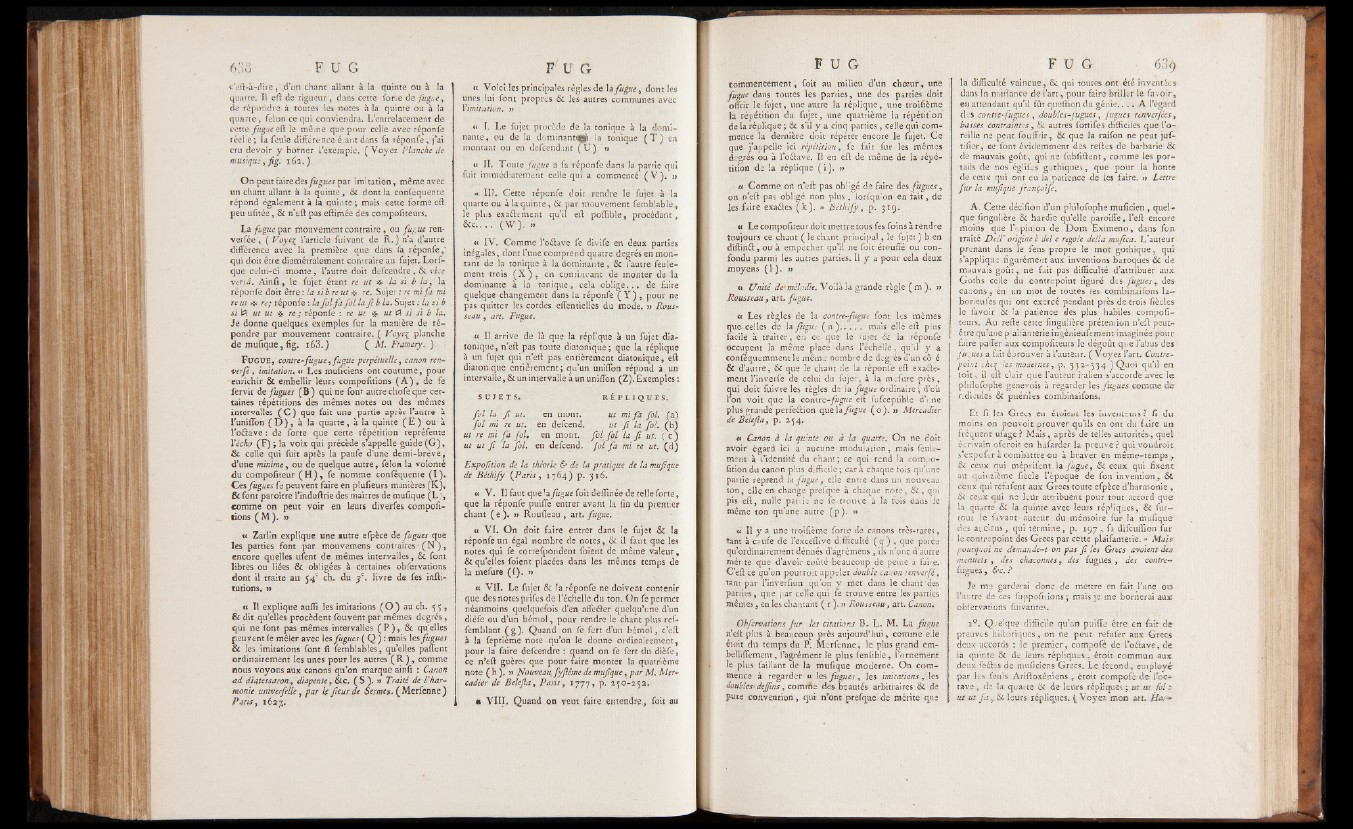
c ’e f t- à -d ir e , .d’un ch an t a llant à la quinte ou à la
quarte. Il eft de rigueur , dans cette fo r te de f u g u e ,
de rép o n d re à tou te s les notes à la quinte ou à la
q u a r te , fé lo n ce qui con v ien d ra . L ’entrelacement de
c e tte fugue eft le même que p o u r celle, a v e c réponfe
rée lle i la feu le d iffé ren c e é.ant dans fa r é p o n fe , j’ai
cru d e v o ir y b o rn e r l’e x em p le . ( V o y e z Planche de
musique, fig. 162.)
On- peut faire des fugues par im i ta tio n , m êm e av ec
u n chant allant à la q u in t e , & dont la co n féq u en te
rép o n d é g a lem en t à la q u in t e ; mais ce tte form e eft
p eu u f it é e , & n’e ft pas eftimée des comp ofiteu rs.
ha fugue par m o u v em en t contraire , ou fugue ren-
v e r fé e , ( Voye% l’a r tic le fu iv an t de R. ) n’a d’autre
différenc e a v e c la prem iè re q ue dans fa r é p o n fe ,'
q u i doit être diamétralement con tra ire au fu je t- L o r f -
q u e c e lu i- c i m o n t e , l’au tre d o it d e f c e n d r e ,& vice
versa. A i n f i , l e fu je t étant re ut ❖ la si b la, la
r ép o n fe do it ê tre : la si b re ut & re. Sujet : re mi fa mi
re ut # re; réponfe : la fo l fa fo l la f i b la. S u je t : la si b
si ut ut & re; réponfe : re ut & ut si si b la.
J e donne q u e lq u e s ex emples fu r la man ière de ré p
o n d re par m o u v em en t contraire. ( Veyeç planche
d e m u f iq u e , fig . i 6 3 . ) ( M. Framery. )
Fugue, contre-fugue, fugue perpétuelle, canon ren-
verfé y imitation, « L e s m u fk ien s ont c o u tum e , pour
-e n r ich ir & em b e llir leurs comp ofttions ( A ) , d e fe
f e r v i r de fugues ( B ) q u i ne fon t autre ch o fe que certaines
répé titions des mêmes notes o u des mêmes
in te rv a lle s ( C ) q ue fait une p a rtie après l’au tre a
l ’uniffon ( D ) , à la q u a r te , à la qu in te ( E ) o u a
l ’otftave : d e fo r te q ue c e tte répé tition repréfente
Y écho ( F ) ; la v o ix qu i précèd e s’ap p e lle gu id e ( G ) ,
& c e lle q u i fuit après la paufe d ’une d em i - b r è v e ,
d’ une minime, ou de que lqu e a u tr e , félon la v o lon té
d u com p ofiteu r ( H ) , fe nom m e conféqu ente ( I ) .
C e s fugues fe p eu v en t faire en p lufieu rs manières (K ) ,
& f o n t pa roître l’induftrie des maîtres de mufique ( L ) ,
com m e o n peu t v o ir en leurs d iv e r fe s cpm p o fi-
tions ( M ) . »
« Z a r lln e x p liq u e un e autre efpèc e de fugues que
le s parties fo n t p a r m ou v em en s c o n t ra ir e s • ( N ) ,
e n c o r e qu e lles u fen t d e mêmes in t e r v a lle s , & fon t
lib re s ou liées & ob lig ées à certaines o b fe rva tions
d o n t i l tra ite a u 54e ch , du f . l iv r e d e fes infti-
tu tio n s . »
« I l e x p liq u e su ffi les imitations ( O ) au ch . 5 5 ,
& dit q u e lle s p ro c èd en t fo u v e n t par mêmes d e g r é s ,
q u i n e fon t pas mêmes intervalle s ( P ) , & qu'elles
p e u v e n t fe m êler a v e c les fugues ( Q ) : mais les fugues
& les imita tions fon t fi fem b la b le s , qu’elle s pan en t
o rd in a irem en t les unes p ou r les autres ( R ) , com m e
n o u s v o y o n s au x canons q u ’on marqu e ainfi : Canon
ad diatessaron, diapente, & c . ( S ) . » Traité de l'harmonie
univerfelle, par U fleur de Sermes. ( M e r fen n e )
fa n s , 1627.
« Voici les principales règles de la fugue, dont les
unes lui font propres & les autres communes avec
Y imitation. »
« I. Le fujet procède de la tonique à la dominante,
ou de la dominant^ la tonique ( T ) en
montant ou en defeendant (U ) . »
« IL Toute j u gu e a fa réponfe dans la partie qui
fuit immédiatement celle qui a commencé ( V ) . »
« IIT. Cette réponfe doit rendre le fujet à la
quarte ou à la quinte, & par mouvement femblable,
le plus exaélement qu’il eft poflible, procédant,
& c . . . . (W ) . »
« IV . Comme l’oélave fe divife en deux parties
inégales, dont l’une comprend quatre degrés en montant
de la tonique à la dominante, & l’autre feulement
trois ( X ) , en continuant de monter de la
dominante à la tonique, cela o b lig e ... de faire
quelque changement dans la réponfe ( Y ) , pour ne
pas quitter les cordes effentielles du mode. » Rousseau
, art. Fugue.
« Il arrive de là que la réplique à un fujet diatonique,
n’eft pas toute diatonique; que la réplique
à un fujet qui n’eft pas entièrement diatonique, eft
diatonique entièrement; qu’ un uniffon répond à un
intervalle, & un intervalle à un uniffon (Z). Exemples :
SUJETS* RÉPLIQUES.
fol la f i ut. en mont. ut mi fa fol. (a)
fol mi re ut. en defeend, ut f i la fol. (b)
ut re mi fa fol, en mont, fo l fol la f i ut. ( c )
ut ut f i la fol. en defeend. jo l fa mi re ut. f d)
Expofition de la théorie & de la pratique de la mufique
de Béthifiy {Paris, 1764) p. 316.
« V . Il faut que la fugue foit deffinée de telle forte,
que la réponfe puiffe entrer avant la fin du premier
chant ( e ). »> Roufîeau , art. fugue.
« V I . On (foit faire entrer dans le fujet & la
réponfe un égal nombre de notes , & il faut que les
notes qui fe corrëfpondent foient de même valeur,
& qu’elles foient placées dans les mêmes temps de
la mefure (f). »
« VII. Le fujet & la réponfe ne doivent contenir
que des notes prifes de l’échelle du ton. On fe permet
néanmoins quelquefois d’en affeéler quelqu’une d’un
dièfe ou d’un bémol , pour rendre le chant plus refi-
femblant ( g ) . Quand on fe fert d’un bémol, c’eft
à la feptième note qu’on le donne ordinairement,
pour la faire defeendre : quand on fe fert du dièfe,
ce n’eft guères que pour faire monter la quatrième
note ( h ), » Nouveau fiyflême de mufique, par M. Mer*
cadier de Belefla, Paris, 17 7 7 , p. 250-25 2.
j « V I I I , Q u a n d on v e u t faire e n t e n d r e , fo it au
tommencement, foit au milieu d’un choeur, une
fugue dans toutes les parties, une des parties doit
offrir le fujet, une autre la réplique, une troifième
la répétition du fujet, une quatrième la répétition
de la réplique ; &i s’il y a cinq parties, celle qui commence
la dernière doit répéter encore le fujet. Ce
que j’appelle ici répétition, fe fait fur les mêmes
degrés ou à l’oâave. Il en eft de même de la répétition
de la réplique ( i ). »
ti Comme 011 n’eft pas obligé de faire des fugues,
on n’eft pas obligé non plus , lorlqu'on en fait, de
les faire exaétes ( k ) . » Bèthify, p. 319.
« Le compofiteu r doit mettre tous fes foins à rendre
toujours ce chant ( le chant principal, le fujet) b.en
diftinét , ou à empêcher qu’il ne foit étouffé ou confondu
parmi les autres parties. 11 y a pour cela deux
moyens ( 1 ) . »
u Unité de*mélodie. Voilà la grande règle (m ) . w
Rousseau , art. fugue.
« Les règles de la contre-fugue font les mêmes
que-celles de la fugue ( n ) ......... mais elle eft plus
facile à traiter, en ce-que le fujet & la réponfe
occupent la même place dans l’échelle, qu’il y a
confgquemment le même nombre de degrés- d’un co é
& d’autre, & que le chant de la réponfe eft exactement
nnverfe de celui du fujet, à la mefure près,
qui doit fuivre les règles de la fugue ordinaire; d’où
l’on voit que la comre-fugue eft fufceptible d’une
plus grande perfection que la fugue ( o ) . » Mercadier
de Belefla, p. 254.
« Canon à la quinte ou d la quarte. On ne doit
avoir égard ici à aucune modulation, mais feulement
à l’identité du chant; ce qui rend la compo-
fition du canon plus difficile ; car à chaque fois qu’une
partie reprend la fugue, elle entre dans un nouveau
ton, elle en change prefque à chaque note, & , qui
pis eft, nulle partie ne fe.trouve à îa fois dans le
même ton qu’une autre (p ) . »
« Il y a une troifième forte de canons très-rares,
tant à caufe de l’exceffive difficulté ( q ) , que parce
qu’ordinairement dénués d'agrémens , ils n ont d’autre
mérite que d’avoir coûté beaucoup de peine à faire.
C’eft ce qu’on poutroit appeler double canon renverfé,
tant par l’inyerfton qu’on y met dans le chant des
parties, que par celle qui fe trouve entre les parties
mêmes, en les chantant ( r ). » Rousseau, art. Canon.
Obfervations fur les citations B . L. M. La fugue
n’eft plus à beaucoup près aujourd’hui, comme elle
étoit du temps du P. Merfenne, le plus grand em-
belliffement, l’agrément le plus fenfible, l’ornement
le plus Caillant de la mufique moderne. On commence
à regarder « les fugues , les imitations y les
doubles-deflins, comme des beautés arbitraires & de
pute convention, qui n’ont prefque de mérite que
la difficulté vaincue, & qui toutes ont été inventées
dans la naiffance de l’art, pour faire briller le favoir,
en attendant qu’il fût queftion du génie.. . . A l’égard
des contre-fugues y doubles-fugues, fugues rtnverfèes,
basses contraintes, &. autres fottifes difficiles que l’oreille
ne peut fouffrir, & que la raifon ne peut juf-
tifier, se font évidemment des reftes de barbarie &
de mauvais goût, qui ne fubfiftent, comme les portails
de nos églifes gothique», que pour la honte
de ceux qui ont eu la patience de les faire. » Lettre
fur la mufique françoife.
A. Cette décifion d’un philofophe muficien, quelque
finguüère & hardie qu’elle paroiffe, l’eft encore
moins que l’opinion de Dom Eximeno, dans fon
traité Dell' origine e del é regole délia mufica. L’auteur
prenant dans le fens propre le mot gothique, qui
s’applique figurément aux inventions baroques & de
mauvais goût, ne fait pas difficulté d’attribuer aux
Goths celle du contrepoint figuré des fugues r des-
canons, èn un mot de toutes les combinaifons la -
bon eu fes qui ont exercé pendant près de trois fiècles
le favoir Ôl la patience des plus habiles compofiteurs.
Au refte cette finguiière prétension n’eft peut-
être qu’une plaifanterieingénieufement imaginée pour
faire paffer aux compofiteurs le dégoût que l’abus des
fu;ues a fait éprouver à l’auteur. ( Voyez l’art. Contrepoint
che{ les modernes y p. 332-334. ) Quoi qu’il en
lo it, il eft clair que l ’auteur italien s’accorde avec le
philofophe genevois à regarder les fugues comme de
r.dicules & puériles combinaifons.
Et fi les Grecs en étoient les inventeurs ? fi du
moins on pouvoit prouver qu’ils en ont du faire un
fréquent ufage? Mais, après de telles autorités, quel-
écrivain oferoit en hafarder la preuve ? qui voudroit
s’expoftr à combattre ©u à braver en même-temps ^
& ceux qui méprifent la fugue, & ceux qui fixent
au quinzième fiècle l’époque de fon invention y &
ceux qui réfufent aux Grecs toute efipècé d’harmonie,
& ceux qui ne, leür attribuent pour tout accord que
la quarte & là quinte avec leurs répliques, & fur-
tout le favant auteur du mémoire fur la mufique
des anciens, qui termine, p. 19 7, fa difeuffion fur
le contrepoint des Grecs par cette plaifanterie. » Mais
pourquoi ne demande-t-on pas f i les Grecs avaient des
menuets , des ckaconnes y des fugues ,. des contre-
fugues , &c. ?
Je me garderai donc de mettre en fait l’une ou
l’autre de ces fuppofrtions ; mais je me bornerai aux
obfervations fuivantes^
Quelque difficile qu’on puiffe être en- fait de
preuves hiftoriques, on ne peut refufer aux Grecs
deux accords : le premier, compofé de Toéiave, de
la quinte & de leurs répliques, étoit commun aux.
deux feéfes de mufieiens Grecs. Le fécond, employé
par les feuls Ariftoxéniens , étoit compofé de foe -
tave , de la quarte & de leurs répliques ; ut m fol :
ut ut fa y. & leurs répliques. (. Voyez mon art. Har