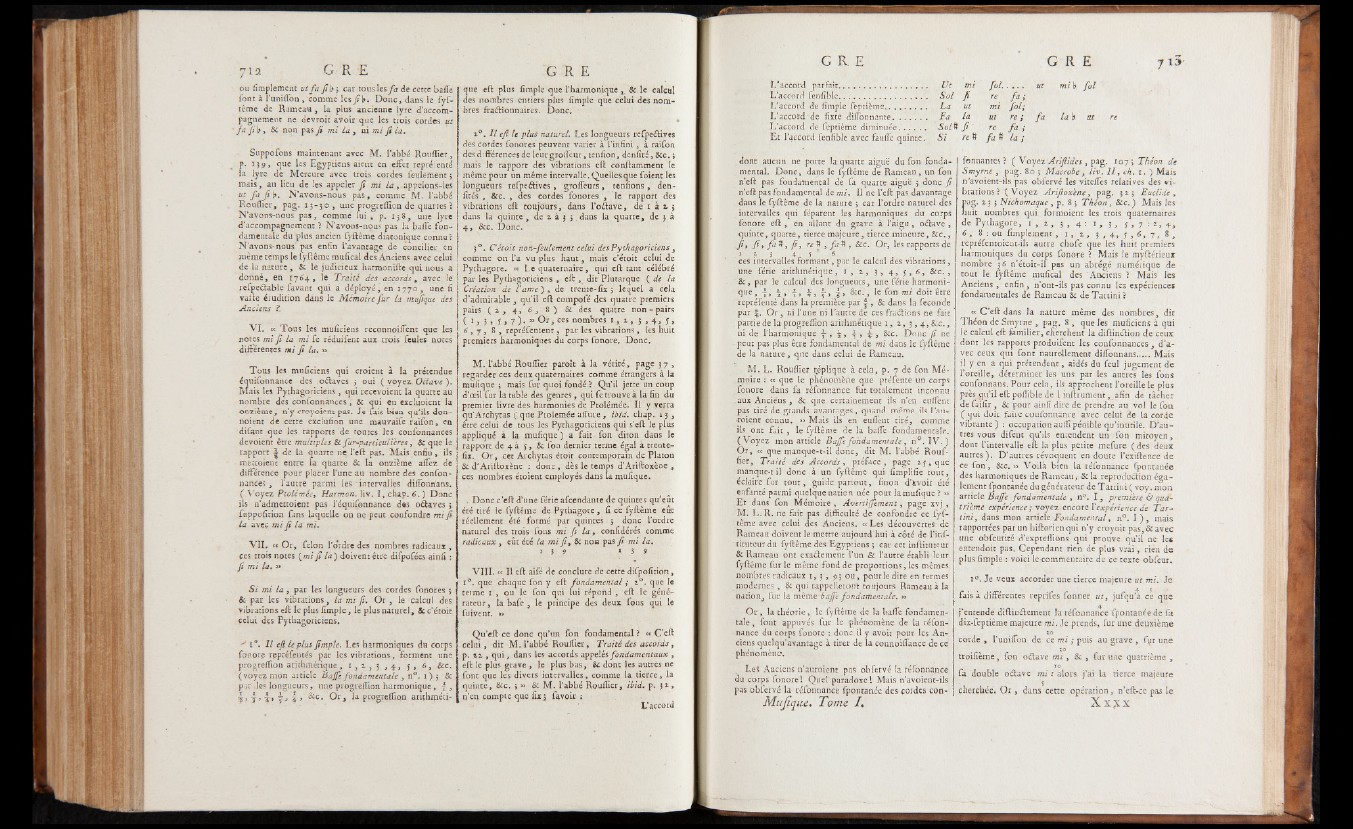
ou Amplement ut fa fi}}', car. tous les fa de eettc baffe
font à l’uni flon , ‘comme les f i b. D o n c , dans le fy f-
tême de Rameau 3 la plus ancienne lyre d’accompagnement
ne devroit avoir que les trois cordes ut
f a fi]}, & non pas f i mi La , ni mi f i La.
Suppofons maintenant avec M . l’abbé Rouflier,
p. 1 3 9 , que les Egyptiens aient en effet repréienté
la lyre de Mercure avec trois cordes feulement 3
mais, au lieu de les appeler f i mi La, appelonSr-les
ut fa fi]}. N ’avons-nous pa s, comme M. l ’abbé
Rouflier, pag. 13-30 , une progreflion de quartes ?
N ’avons-nous pa s, comme lu i , p. 138, une lyre
d’accompagnement ? N ’avons-nqus pas la baffe fondamentale
du plus ancien fyftême diatonique connu?
Navons-nous pas enfin l’avantage de concilier en
même temps le fyftême mufîcal des Anciens avec celui
de la nature , & le judicieux harmonifte qui nous a
donné, en 176 4 , le Traité des accords, avec le
refpeétable favant qui a déployé, en 1770 , une fi
vaite érudition dans le Mémoire fur La mufique des
Anciens ?,
V I . « Tous les muficiens reconnoiffent que les
notes mi f i La mi fe réduifent aux trois feules notes
différentes mi f i La. »
Tous les muficiens qui croient à la prétendue
équifonnance des oétaves 5 oui ( voyez Octave ).
Mais les Pythagoriciens ,- qui recevoient la quarte au
nombre des confonnances ; & qui en excluoient la
onzième, n’y croyoient pas. Je fais bien qu’ils don-
noient de cette exclufion une mauvaife raifon, en
dilant que les rapports de routes les confonnances
dévoient être multiples 8c fur-particulières, & que le
rapport | de la quarte ne l’eft pas. Mais enfin , ils
mettoient entre la quarte & la onzième affez de
différence pour placer l’une au nombre des confonnances
, l’autre parmi les intervalles diffonrians.
( V o y e z Ptolémée, Harmon. liv. I , chap. 6. ) Donc
ils n’admettoient pas l’équifonnance des oétaves 3
foppofition fans laquelle on ne peut confondre mi fi
la avec mi f i la mi.
V I I f ce O r , félon l’ordre des nombres radicaux ,
Ces trois notes (.mz f i là) doivent être difpofées ainfi ;
fi mi là. 9»
S i mi la , par les longueurs des cordes fonores 5
&• par les vibrations, la mi fi. O r , le calcul des
vibrations eft le plus fimple, le plus naturel, Sç c’étoit
celui des Pythagoriciens.
^ i ?. I l eft le plus fimple. Les harmoniques du corps
fonore rçpréfentés par les vibrations, forment une
progreflion arithmétique, 1 , z , 3 , 4 , 5 , 6 , Ôte.
(vo y e z mon article baffe fondamentale , n ° . 1 ) 5 &
par Jes longueurs, une progreflion harmonique , | ,
4 , j , f j | , & c . O r , la progreflion ariçhqiétique
eft plus fimple que l’harmonique *. & le calcul
des nombres entiers plus fimple que celui des nombres
fractionnaires. Donc.
20. I l eft le plus naturel. Les longueurs refpeétives
des cordes fonores peuvent varier à l’infini, à raifon
des différences de leur grolleur, tenfion, denfîté, &c. ;
mais le rapport des vibrations eft conftamment le
même pour un même intervalle. Quelles que foient les
longueurs refpeétivcs , groffeurs , reniions, den-
fités , ôte. , des cordes fonores , le rapport des
vibrations eft toujours, dans l’oétave, de 1 à i ;
dans la quinte, de z à 3 5 dans la quarte, de 3 à
4 , &c. Donc.
30. Cétoit non-feulement celui des Pythagoriciens 3
comme on l’a vu plus haut, mais c’étoit celui de
! Pythagore. ce Le quaternaire, qui eft tant célébré
| par les Pythagoriciens , e f t , dit Plutarque ( de la
I Création de Came) , de trente-fix 3 lequel a cela
! d’admirable 3 qu’il eft compofé des quatre premiers
{pairs ( z , 4 , 6 , 8 ) & des quatre non-pairs
! ( 1 3 3 » 5 s 7 )• ” O r , ces nombres 1 , z , 3 , 4 , 5 >
6 , 7 , 8 , repréfentent, par les vibrations , les huit
premiers harmoniques du corps fonore. Donc.
M. l’abbé Rouflier paroît à la vérité, page 37 ,
regarder ces deux quaternaires comme étrangers à la
mufique 3 mais fur quoi fondé ? Qu’il jette un coup
d’oeil fur la table des genres, qui fe trouve à la fin du
premier livre des harmonies de Ptolémée/Il y verra
qu’Archytas ( que Ptolemée aflure , ibid. chap. 1 3 ,
être celui de tous les Pythagoriciens qui s’eft le plus
appliqué à la mufique ) a fait fon diton dans le
rapport de 4 à y, & fon dernier terme égal à trente-
fix. O r , cet Archytas étoit contemporain de Platon
& d’Ariftoxènc : donc 3 dès le temps d’Ariftoxène ,
ces nombres étoient employés dans la mufique.
. Donc c ’eft d’une férié afeendante de quintes qu’eût
été tiré le fyftême de Pythagore, fi ce fyftême eut
réellement été formé par quintes 3 donc l’ordre
naturel des trois fons mi fi la , confidérés comme
radicaux 3 eût été la mi f i , & non pas J» mi la.
. . . . . . . . t 3 9 * 3 9
VIII. ce II eft aifé de conclure de cette difpofîtion,
1°. que chaque fori y eft fondamental y z°. que le
terme r , ou le fon qui lui répond , eft le générateur
, la bafe, le principe des deux fons qui le
fuivent. »
Qu’eft-ce donc qu’un fon fondamental ? ce C ’eft
celui, dit M. l’abbé Rouflier, Traité des accords,
p. zz , qui, dans les accords appelés fondamentaux 3
eft le plus grave , le plus bas, & dont les autres ne
font que les divers intervalles, comme la tierce, la
quinte, 8tc. 3 » 8 c M. l’abbé Rouflier, ibid, p. î 1 »
u’en compte que fixj favoir ;
L’accord
L ’ accord parfait.....................................
L ’accord fenfible.........................................
L ’accord de fimple ftptième....................
L ’acCotd de fixte diflonnante. . . . . . .
L ’accord de feptième diminuée.......... ..
E t l’accord fenfible avec fauffe quinte.
G R E
Ût mi fol. ut mi V fo l
Sol fi re fa;
La ut mi Joli
Fa la ut re ; fa la ]} at
Soli> fi re f a ;
S i fa n la }
re
dont aucun ne porte la quarte aiguë du fon fondamental.
Donc, dans le fyftême de Rameau, un fon
n’eft pas fondamental de fa quarte aiguë 3 donc f iK
n’eft pas fondamental de mi. Il ne l’eft pas davantage
dans le fyftême de la narure 3 car l’ordre naturel des
intervalles qui féparent les harmoniques du corps
fonore eft , eh allant du grave à l’aigu , otftave ,
quinte, quarte, tierce majeure, tierce mineure, & c .,
f i , f i , f “ %, fi,. re% , fa# , ôte. Or, les rapports de
- 1 • h H 4 y * 6
ces intervalles formant, par le calcul des vibrations,
une férié arithmétique, 1 , z , 3, 4, 5 , 6, & c . ,
& , par le calcul des longueurs, une férié harmoni-
que, -J, f-, %} j 3 -g, ôte., le fon mi doit être
repréfenté dans la première par | , & dans la fécondé
par O r , ni l’une ni l ’autre de ces fraéfcions ne fait
partie de la progreflion arithmétique 1 , z , 3,4, & c .,
ni de l’harmonique 7 , § , •§■ , £ , ôte. Donc f i ne
peut pas plus être fondamental de mi dans le fyftême
de la nature, que dans celui de Rameau.
M. L. Rouflier réplique à cela, p. 7 de fon Mémoire
: ce que le phénomène que préfente un corps
fonore dans fa réfonnance fut totalement inconnu
.aux Anciëns , & que certainement ils n’en euffent
pas tiré de grands avantages, quand même ils l ’au-
aroient connu. » Mais ils en euffent tiré, comme
ils ont fa it , le fyftême de la baffe fondamentale.
(Voyez mon article Baffe fondamentale , n°. IV. )
O r , ce que manque-t-il donc, dit M. l’abbé Rouf-
fier, Traité des Accords, préface, page z y, que
manque-t il donc à un fyftême qui Amplifie tout,
éclaire fur tout, guide partout, finon d’&voir été
enfanté parmi quelque nation née pour la mufique ? >3
Et dans fon Mémoire, Avertiffement, page xvj ,
M. L .R . ne fait pas difficulté de confondre ce fyftême
avec celui des Anciens, ce Les découvertes de
Rameau doivent le mettre aujourd hui à côté de l’inf-
‘ tituteur du fyftême des Egyptiens 5 car cet inftituteur
St Rameau ont exaétement l’un & l’autre établi leur
fyftême furie même fond de proportions, les mêmes
nombres radicau* 1, 3,95 ou, pour le dire en termes
modernes , 8c qui rappelleront toujours Rameau à la
nation, fur la même baffe fondamentale. »
O r , la théorie, le fyftême de la baffe fondamentale
, font appuyés fur le phénomène de la réfonnance
du corps fonore : donc,il y avoit pour les Anciens
quelqu’avantage à tirer de la connoiflance de ce
phénomène.
Les Anciens n’auroient pas obfervé la réfonna.nce
du corps fonore! Quel paradoxe! Mais n’avoient-ils
pas oblervé la réfonnance fpontanée des cordes con-
Mufique. Tome I.
fonnantes ? ( Voyez Ariftides 3 pag. 1073 Théon de
Smyrne , pag. 80 3 Macrobe 3 liv. I I , ch. 1. ) Mais
n’avoient-»is pas obfervé les viteffes relatives des vibrations?
(V oyez Arifioxène, pag. 323 Euclide,
pag. Z3 5 Nichomaque , p. 8 5 Théon, &c. ) Mais les
huit nombres qui formoient les trois quaternaires
de Pythagore, 1 , 2 , 3 , 4 : 1 , 3 , y , 7 : 2, 4,
6, 8 : ou Amplement , 1 , 2 , 3 , 4 , y , 6, 7, 8,
repréfentoient-ils autre chofe que les huit premiers
harmoniques du corps fonore ? Mais le myftérieux
nombre 36 n’étoit-il pas un abrégé numérique de
tout le fyftême mufical des Anciens ? Mais les
Anciens , enfin , n’ont-ils pas connu les expériences
fondamentales de Rameau & de Tartini ?
« C ’eft dans la nature même des nombres, dit
Théon de Smyrne , pag. 8 , que les muficiens à qui
le calcul eft familier, cherchent la diftinction de ceux
dont les rapports produifent les confonnances, d’avec
ceux qui font naurollement diflonnans.i... Mais
il y en a qui prétendent, aidés du feul jugement de
l’oreille, déterminer les uns par les autres les fons
confonnans. Pour cela, ils approchent l’oreille le plus
près qu’il eft poflible de 1 inftrument, afin de tâcher
de faifir , & pour ainfi dire de prendre au vol le fou
( qui doit faire confonnance avec celui de la corde
vibrante) : occupation aufli pénible qu’inutile. D’autres
vous difent qu’ils entendent un fon mitoyen,
dont l’intervalle eft la plus petite mefure ( des deux
autres). D’autres révoquent en doute l’exiftence de
ce fon, Ôte. *> Voilà bien la réfonnance fpontanée
des harmoniques de Rameau, & la reproduction également
fpontanée du générateur de Tartini ( voy. mon
article Baffe fondamentale , n°. I , première & quatrième
expérience ; voyez encore Vexpérience de Tartini,
dans mon article Fondamental, n°. I ) , mais
rapportées par un hiftorien qui n’y croyoit pas, & avec
une obfcurité d’expreflions qui prouve qu’il ne les
entendoic pas. Cependant rien de plus vrai, rien de
plus fimple : voici le-commencaire de ce texte obfcur.
i ° . Je veux accorder une tierce majeure ut mi. Je
fais à différentes reprifes fonner ut, jufqu’à ce que
j’entende diftinéfcement la réfonnance fpontanée de fa
dix-feptième majeure mi. Je prends, fur une deuxième
corde , i’uniflon de ce mi ; puis au grave , fyr une
troifième, fon oétave m i, 8c , fur une quatrième ,
fa double oélave mi : alors j’ai la tierce majeure
cherchée. O r , dans cette opération, n’eft-ce pas le
X x j c x