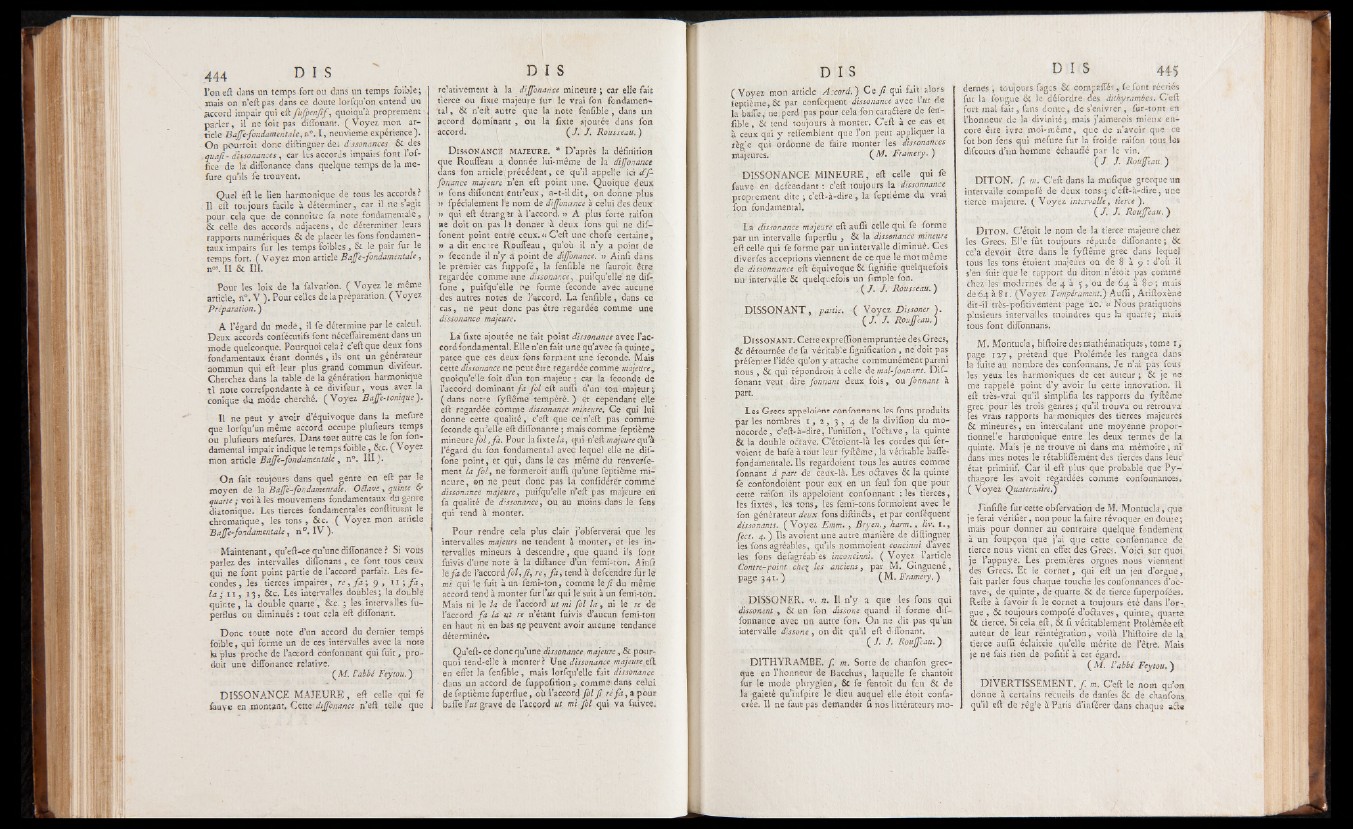
l’on eft dans un temps fort ou dans un temps foible ;
mais on n’eft pas dans ce doute lorfqu’on entend ira
accord impair qui eft fufpenfif » quoiqu’à proprement -
parler, il ne foit pas diffonanr. (V o y e z mon article
Baffe-fondamentale, n°. I , neuvième expérience).
On pourroit donc diftinguer des d ssonances & des
quafi- dissonances, car les accords impairs font l’office
de la diffonance dans quelque temps de la me-
fure qu’ils fe trouvent.
Quel èft le lien harmonique de tous les accords ?
Il eft toujours facile à déterminer, car il ne s’agit
pour cela que de connoître fa note fondamentale,
& celle des accords adjacens, de déterminer leurs
rapports numériques & de placer les fons fondamentaux
impairs fur les temps foibles , & le pair fur le
temps fort. ( Voyez mon article Baffe-fondamentale,
n°s. II & III.
Pour les loix de la falvatlon. ( Voyez le même
article, n°. V ). Pour celles de la préparation. (Voyez
Préparation. )
A l’égard du mode, il fe détermine par le calcul.
Deux accords confécutifs font néceflairement dans un
mode quelconque. Pourquoi cela ? c’eft que deux fons
fondamentaux étant donnés, ils ont un générateur
aommun qui eft leur plus grand commun divifeur.
Cherchez dans la table de la génération harmonique
t l note correfpondante à ce divifeur, vous avez la
conique du mode cherché. (V o y e z Baffe-tonique).
Il ne peut y avoir d’équivoque dans la mefure
que lorfqu un même accord occupe plufieurs temps
ou plufieurs mefures. Dans tout autre cas le fon fondamental
impair indique le temps foible, &c. (V oy e z
mon article Bajfe-fondamentale , n°. III).
On fait toujours dans quel genre on eft par le
moyen de la Baffe-fondamentale. OElavè , quinte &
quarte ; voi a les mouvemens fondamentaux du genre
diatonique. Les tierces fondamentales conftituent le
chromatique, les tons , &c. ( Voyez mon article
Baffe-fondamentale, n°. IV ).
Maintenant, qu’eft-ce qu’une diffonance ? Si vous
parlez des intervalles diffonans, ce font tous ceux
qui ne font point partie de l’accord parfait. Les fécondés
, les tierces impaires, re, fa', 9 , 11 ; f a ,
la ; 1 1 , 13 , &c. Les intervalles doubles; la double
quinte, la double quarte, &c. ; les intervalles fu-
perflus ou diminués : tout cela eft diffonant.
Donc toute note d’un accord du dernier temps
foible, qui forme un de ces intervalles avec la note
ki plus proche de l’accord confonnant qui fuit, produit
une diffonance relative.
(M. Vabbé Feÿtou.)
DISSONANCE MAJEURE, eft celle qui fe
fauve en montant. Ce»s diffonance n’eft telle que
relativement à la diffonance mineure ; car elle fait
tierce ou fixte majeure lur le vrai fon fondamental
, & n’eft autre que la note fenfible, dans un
accord dominant , ou la fixte ajoutée dans fon
Accord. t ( /. J. Rousseau, )
Dissonance majeure. * D’après la définition
que Rouffeau à, donnée lui-même de la diffonance
dans fon article,précédent, ce qu’il appelle ici d’f i
fonance majeure n’en eft point une. Quoique deux
» fons diffonènt/entr’eux, a-t-il d it, on donne plus
» fpécialement l e nom de diffonance à celui des deux
» qui eft étrangler à l’accord. » A plus forte raifon
ne doit on pas 1? donner à deux fons qui ne dif-
fonent point entité ceux.«C’eft une chofe certaine,
»> a dit enc -re Rouffeau , qu’oii il n’y a point de
» feccnde il n’y a point de diffonance. » Ainfi dans
le premier cas fuppofé, la fenfible ne fauroit être
regardée comme'une dissonance, jpuiCquelle ne dif-
fone , puifqu'elle (\e forme fécondé avec aucune
des autres notes de l ’accord. La fenfible, dans ce
’ cas, ne peut donc pas être regardée comme une
dissonance majeure.
La" fixte ajoutée ne fait pbint dissonance avec l’accord
fondamental. Elle n’en fait une qu’avec fa quinte,
parce que ces deux fons forment une fécondé. Mais
cette dissonance ne peut être regardée comme majeure^
quoiqu’elle foit d’un ton majeur ; car la fécondé de
l’accord dominant^ fo l eft auflî d’un ton majeur;
(dans not^e fyftême tempéré. ) et cependant elle
eft regardée comme dissonance mineure. Ce qui lui
donne cette qualité, c’eft que ce/n’eft pas comme
fécondé qu’elle eft diffonante ; mais comme feptième
mineure fo l, fa. Pour la fixte la, (jjui -n’eft majeure qu’à
l’égard du fon fondamental avec lequel elle ne difi-
fone point, et qui, dans le cas même du renverfe-
ment la fol, ne formeroit auffi qu’une feptième mineure
, ©n ne peut donc pas la confidérér comme
dissonance majeure, puifqu’elle n’eft pas majeure en
fa qualité de dissonance, ou au moins dans le fens
qui tend à monter.
Pour rendre cela plus clair j’obferverai que les
intervalles majeurs ne tendent à monter, et les intervalles
mineurs à descendre, que quand ils font
fuivis'd’une note à la diftance d’un femi-ton. Ainft
1 e f t de l’accord fo l, fi, re, fa , tend à defcendre fur le
mi qui le fuit à un femi-ton, comme le f i du même
accord tend à monter fur Ÿut qui le suit à un femi-ton.
Mais ni le la de l’accord ut rni fol la , ni le re de
l’accord fa la ut re n’étant fuivis d’aucun femi-ton
en haut ni en bas ne peuvent avoir aucune tendance
déterminée,
Qu’eft-ce donc qu’une dissonance majeure& pourquoi
tend-elle à monter? Une dissonance majeure,eft
en effet la fenfible, mais lorfqu’elle fait dissonance
dans un accord de fuppofition, comme dans celui
de feptième fuperflue, où l’accord fol f i ré fa ,* pour
baffe l’ut grave de l’acçord ut mi f i t qui va fuivre.
(V o y e z mon article A:cord. j C e f i qui fait alors
leptième,& par conféquent dissonance avec l'ut Ae
la baffe; ne,perd pas pour cela fon cara&ère de fenfible
, & tend toujours à monter. C ’eft à ce cas et
à ceux qui y reffemblent que l’on peut appliquer la
règ’e qui ordonne de faire monter les dissonances
majeures. ( M. Fr amer y. )
DISSONANCE MINEURE , eft celle qui fe
fauve en dofcendant : c’eft toujours la dissonnance^
proprement dite ; c’eft-à-dire, la feptième du vrai
fon fondamental.
La dissonance majeure eft auffi celle qui fe forme '
par un intervalle fuperflu , & la dissonance mineure
eft celle qui fe forme par un intervalle diminue. Ces
diverfes acceptions viennent de ce que le mot même
de dissonnance eft équivoque & fignifie quelquefois
un intervalle & quelquefois un fimple fon.
( J . J. Rousseau. )
DISSONANT, partie. ( Voyez Dissoner ).
( 7. 7. Rouffeau.)
D issonant. Cette expreffionempruntée des Grecs,
& détournée de fa véritable fignification , ne doit pas
préfe'mer l’idée qu’on y attache communément parmi
nous , & qui répondroit à celle de mal-Jonnant. Diffonant
Veut dire fonnant deux fois, ou fonnant à
part.
Les Grecs appeloient confonnans les fons produits
par les nombres 1 , 2 , 3 , 4 de la divifion du monocorde,
c’eft-à-dire, l’uniffon, l’o&ave , la quinte
& la double oélave. C ’étoient-là les cordes qui fer-
voient de bafe à tout leur fyftême, la véritable baffe-
fondamentale. Ils regardoient tous les autres comme
fonnant à pan de ceux-là. Les o&aves & la quinte
fe confondoient pour eux en un feul fon que pour
cette raifon ils appeloient confonnant : les tierces,
lès fixtes, les tons, les femi-tons formoient avec le
fon générateur deux fons diftiri&s, et par conféquent
dissonants. (V o y e z Emm. , Bryen., harm., liv. 1.,
fect. 4. ) Ils avoient une autre manière de diftinguer
les fons agréables, qu’ils nommoient concinni d’avec
les fons défagréab'es inconcinni. ( Voyez l’article
Contre-point che£ les anciens, par M. Ginguené,
page 341.) ( M. Framery. )
DISSQNER. v. n. Il n’y a que les fons qui
dissonent , & un fon dissone quand il forme dif-
fonnance avec un autre fon. On ne dit pas qu’un
intervalle dissone, on dit qu’il eft diffonant.
( 7. J. Rouffeau.)
DITHYRAMBE, f . m. Sorte de chanfon grecque
en l’honneur de Bacchus, laquelle fe çhantôit
fur le mode phrygien, & fe fentoit du feu &. de
la gaieté qu’infpire le dieu auquel elle étoit confa-
crée. 11 ne faut pas demander fi nos littérateurs modernes,
toujours fagcs & compaffés, fe font récriés
fur la fougue & le défordre des dithyrambes. C ’eft
fort mal fait, fans doute, de s’enivrer, fur-tont en
l’honneur de la divinité; mais j’aimerois mieux encore
être ivre moi-même, que de n’avoir que ce
fot bon feris qui mefure fur la froide raifon tous les
difcours d’un homme échauffé par le vin.
( J J. Rouffeau. )
DITON. f . m. C ’eft dans la mufique grecque un
intervalle compofé de deux tons-.; c’eft-à-dire, une
tierce majeure. (V o y e z intervalle, tierce).
( J. J. Rouffeau. )
D iton. G’étoit le nom de la tierce majeure chez
les Grecs. Elle fût toujours réputée diffonante; &
cela devoit être dans le fyftême grec dans lequel
tous les tons étoient majeurs où de 8 à 9 : d’où il
s’en fuit que le rapport du diton n’étoit pas cômrnë
chez les modernes de 4 à 5 , ou de 64 à 80 ; mais
de 64 à 8 r. (Voyez Tempérament.) Auffi, Ariftoxène
dit-il très- p ofiti v ém en t page 20. « Nous pratiquons
plusieurs intervalles moindres que la quarte; mais
tous font diffonnans.
M. Montucla, hiftoire des mathématiques, tome r ,
page 12 7 , prétend que Ptolémée les rangea dans
la fuite au nombre des confonnans. Je n’ai pas fous
les yeux les harmoniques de cet auteur ; & je ne
me rappelé point d’y avoir lu cette innovation. 11
eft très-vrai qu’il simplifia les rapports du fyftême
grec pour les trois genres ; qu’il trouva ou retrouva
les vrais rapports harmoniques des tierces majeures
& mineures, en intercalant une moyenne proportionnelle
harmonique entre les deux termes de la
quinte. Mais je ne trouve ni dans ma mémoire, ni
dans mes notes le rétabliffement des tierces dans leur'
état primitif. Car il eft plus que probable que P y -
thagore les avoit regardées comme confonnances.
( Voyez Quaternaire.)
J'infifte fur cette obfervation de M. Montucla, que
je ferai vérifier, non pour la-faire révoquer en doute;
mais pour donner au contraire quelque fondement
; à un foupçon que j’ai que cette confonnance de
tierce nous vient en effet des Grecs. Voici sur quoi,
je l’appuye. Les premières orgues nous viennent
des Grecs. Et le cornet, qui eft un jeu d’orgue,
fait parler fous chaque touche les confonnances d’octave,
de quinte, de quarte & de tierce fuperpofées.
Refte à favoir ft le cornet a toujours été dans l’orgue,
& toujours compofé d’o&aves, quinte, quarte
& tierce. Si cela eft, & fi véritablement Ptolémée eft
auteur de leur réintégration, voilà l’hiftoire de la.
tierce auffi éclaircie qu’elle mérite de l’être. Mais
je ne fais rien de pofitif à cet égard.
( M. T abbé Feytou. )
DIVERTISSEMENT, f . m. C’eft le nom qu’on
donne à certains recueils de danfes & de cha.nfons
qu’il eft de règle à Paris d’inférer dans chaque acle